Markuspassion - Künstel
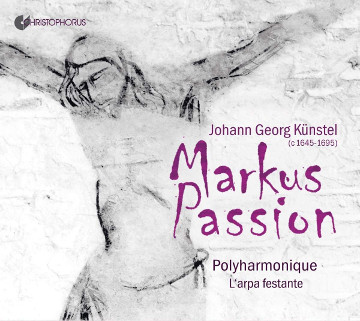 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec notice bilingue (allemand-anglais) de Julian Franke et Alexander Schneider, 2 CD, durée totale : 138 minutes. Christophorus Records -
Compositeurs
- Johann Georg Künstel (1645 ?-1695) :
- Markuspassion
Chanteurs/Interprètes
- Ensemble Polyharmonique :
- Hans Jörg Mammel, ténor (l’Evangéliste)
- Félix Rumpf, baryton (Jésus)
- Magdalene Harer, Joowon Chung (soprani)
- Alexander Schneider, alto (Pierre)
- Piotr Olech, alto (Judas)
- Johannes Gaubitz, ténor (un disciple)
- Sören Richter, ténor (un disciple)
- Torsten Voigt, bariton (le capitaine)
- Philipp J. Kaven, basse (le Grand Prêtre)
- Cornelius Uhle, basse (Pilate)
- Orchestre L’arpa festante :
- Violon solo : Christoph Hesse
- Violon : Angelilka Balzer
- Altos : Max Bock, Ursula Plagge-Zimmermann
- Violoncelle : Daniela Wartenberg
- Contrebasse : Haralt Martens
- Orgue et clavecin : Christoph Anselm Noll
- Luth : Michael Dücker
- Direction : Alexander Schneider
Pistes
Une dévotion incomparable de simplicité et de profondeurSouvent, les grands noms en cachent de plus humbles. Pour autant, ces derniers sont-ils dépourvus de talents ? Johann Georg Künstel (1645 ?-1695) compte administrer la preuve par l’exemple qu’une vie musicale inventive et raffinée prospère loin des fameux foyers culturels de l’Allemagne du Nord (Hambourg ou Lübeck) ou du Centre (Dresde ou Leipzig).
De prime abord, sa caution paraît bien fragile, tant le personnage est nimbé de mystère. Même le très documenté Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexicon (1901) de Robert Eitner (1832-1905) le délaisse. Il ferait donc partie de ces « compositeurs dont la trace se résume le plus souvent à une note de bas de page dans quelques publications savantes », résume Jean-Christophe Pucek dans sa chronique consacrée à cet enregistrement.
Alors, que savons-nous de lui ? En réalité, bien peu de choses. A peine quelques indices épars que nous fixerons sur le canevas proposé par Johann Gottfried Walther (1684-1746). Car, dans son Musicalisches Lexicon (1732), il est l’un des rares musicologues à le mentionner, même s’il ne lui consacre que huit lignes (sur les 763 pages de son dictionnaire).
Fils d’un meunier, Künstel passe son enfance à Weissenfels (Saxe-Anhalt). Une ville portant les stigmates douloureux d’une guerre de Trente Ans (1618-1648) qui prend fin alors qu’il entre à peine dans la petite enfance. Mais aussi le lieu dans lequel Heinrich Schütz (1585-1672) a grandi dans l’auberge familiale et qui l’accueillera au moment de sa retraite, de 1651 à 1672. Même si on se plaît à l’imaginer, aucun élément factuel ne vient confirmer que le Sagittarius ait influé d’une quelconque manière sur la vocation musicale de Künstel. Adulte, il épouse la fille d’un édile (Bürgers-Meisters Tochter) de la ville d’Ansbach (Moyenne-Franconie). Un indicateur de promotion sociale ? Quoi qu’il en soit, il y exerce les fonctions de maître d’école et d’organiste, comme l’indique, en 1667, l’avis de décès de sa belle-mère, Margaretha Meiner. Deux ans plus tard, son nom apparaît dans les registres paroissiaux d’Ansbach en qualité d’organiste de la cour du margrave Johann Friedrich von Brandeburg-Ansbach (1654-1686), le père de la future épouse du futur roi d’Angleterre, George II (1683-1760). Il y assure ponctuellement l’intérim du maître de la chapelle curiale. Enfin, nous retrouvons sa trace à Cobourg (Haute-Franconie), en 1684, comme organiste à la cour du duc Albrecht von Sachsen-Cobourg-Gotha (1648-1699). Si, en 1691, Künstel est nommé Hofkapellmeister, c’est probablement parce que ses talents de compositeur ont séduit ce protecteur des arts, au demeurant grand mélomane. Sa carrière de musicien, réalisée exclusivement dans un rayon d’environ 200 kilomètres autour de Frankfurt-am-Main, dans le Sud de l’Allemagne, prend fin quatre ans plus tard.
Cependant, son souvenir ne tombe pas immédiatement dans l’oubli. En effet, sa Passion selon saint Marc était populaire au point d’être interprétée régulièrement jusqu’au début du XVIIIème siècle. Elle plonge ensuite dans un long sommeil qu’une bien poétique expression allemande qualifiera de Dornröschenschlaf (littéralement : sommeil de la belle au bois dormant). Certes, son texte patientait sur les rayons des bibliothèques car il avait fait l’objet de plusieurs éditions (notamment en 1713 et 1741). En revanche, la partition a longtemps été déclarée perdue. Jusqu’à ce que l’autographe réapparaisse dans les années 1980 au moment de rejoindre une collection privée. Finalement, celle-ci a été retravaillée par Julian Franke (l’un des corédacteurs du texte de présentation de notre album) qui l’a transcrite en notation moderne pour être publiée par Ortus-musikverlag.
L’ensemble Polyharmonique, conduit par Alexander Schneider (l’autre rédacteur du livret), s’associe ici aux cordes de L’arpa festante pour réaliser le premier enregistrement connu de cet opus sauvé de l’amnésie. Voués à l’exhumation des partitions enfouies jusqu’aux tréfonds des archives, promoteurs vivifiants de la musique ancienne, particulièrement expérimentés et convaincants dans ce type de répertoire, ces deux ensembles offrent des gages de qualité et de vérité dans l’interprétation de ces joyaux baroques. C’est pourquoi nous guetterons la sortie de ces consolations en douze madrigaux (Zwölf madrigalische Trostsänge - 1670) de Wolfgang Carl Briegel (1626-1712) pour l’enregistrement desquels Polyharmonique recherche actuellement des souscripteurs afin de briser le cercle infernal enclenché par le coronavirus dans le monde de la culture.
Premier enregistrement, certes. Mais pas la première exécution. Car, en 2014 déjà, dans la ville même du siège social de l’Ortus-musikverlag, le Kantor de Beeskow (Brandebourg), Matthias Alward, l’avait offerte au public réuni à la Marienkirche, avec le concours du Potsdam Chamber Orchestra. A cette occasion, il expliquait : « Si nous interprétons à nouveau l’œuvre, les auditeurs pourront se convaincre de l’ingéniosité musicale et de la plasticité de l’expression artistique ».
Quel est donc l’objet de toute cette attention ? Une Markuspassion (Passion selon l’Evangile de Marc), renseigne la pochette de notre album. En réalité, bien plus que cela si l’on se réfère au titre exact imprimé en couverture du recueil publié en 1713. Nous traduisons : « L’histoire des souffrances et de la mort de notre Seigneur Jésus Christ/ comme le saint Evangéliste Marc l’a écrite/ à laquelle on a ajouté de nombreux soupirs (Suspiriis) extraits des cantiques spirituels d’église (Geistreichen Kirchen=Gesänge) ainsi que des arias édifiants modernes (neuen erbaulichen Arien). D’après l’ingénieuse (Kunstreichen) composition du bienheureux monsieur Georg Künstel qui fût maître de chapelle du prince de Saxe à Cobourg ». En résumé, une Historia probablement composée entre 1691 et 1695 pour clôturer la Semaine Sainte en la chapelle du château ducal de Cobourg.
Finalement, cet opus constitue une délicieuse synthèse de toutes les audaces qui ont secoué l’imagination créatrice des compositeurs de Passions, bien avant celles de Johann Sebastian Bach (1685-1750). D’abord, par l’introduction d’instruments (ici, des cordes) alors que, étant considérés comme des ornements agréables à l’oreille, ils étaient généralement prohibés pendant la période d’évocation des souffrances du Christ. Le dépouillement étant alors la règle, la voix humaine se présentait comme le seul instrument (parce que d’origine divine) toléré. Comme dans les Passions de Schütz (lire notre chronique). Ensuite, en combinant des passages du Nouveau Testament, des cantiques et des fragments poétiques, il mêle, en quelque sorte, des paroles d’inspiration divine à des textes d’origine profane. En l’occurrence, Künstel se glisse dans le sillage des novateurs, tel Thomas Selle (1599-1663). Celui-ci, dans sa Johannespassion con intermediis (1642), est probablement le premier à insérer dans le récit évangélique conventionnel des textes non-évangéliques destinés à le résumer ou le commenter. Enfin, cette approche est à mettre en relation avec une évolution des pratiques spirituelles encourageant la dévotion individuelle plus qu’une vénération collective de la sacralité du texte. De plus en plus, les Passions comportent donc des pauses contemplatives accompagnées musicalement.
Enfin, Künstel se singularise en choisissant le récit de la Passion livré par Marc, bien avant la composition (1707) attribuée à Reinhard Keiser (1674-1739). Celle que Bach recopiera avant de produire sa propre version BWV 247 (voir notre compte-rendu). En différenciant les modalités de leur narration, l’Eglise a, dès les premiers siècles, hiérarchisé les récits de la Passion. Jacques Chailley (1910-1999) rappelle fort justement que, à la fin du Moyen Age, l’Evangile des Passions selon Matthieu et Jean bénéficie d’une lecture chantée (respectivement le Dimanche des Rameaux et le Vendredi-Saint) tandis que ceux de Marc et Luc (le Mardi-Saint et le Mercredi-Saint) sont simplement « psalmodiés par le prêtre (ou le diacre) sur un timbre uniforme ». Et d’ajouter : « Cette répartition liturgique devait avantager Saint Matthieu et Saint Jean pour l’histoire musicale, car dans l’espace séculier, seul propice au développement polyphonique, les offices du mardi et du mercredi sont un peu sacrifiés » (Les « Passions » de J.S.Bach, 1984). Après Schütz et peut-être quelques autres, Künstel réhabilite donc un récit généralement négligé par les compositeurs.
L’écriture musicale se range ostensiblement dans la catégorie des œuvres d’inspiration moderne, mariant le stile concertato à la manière madrigalesque. En revanche, la distribution vocale se présente, à première vue, sur un mode plutôt traditionnel. Ainsi, un ténor prête sa voix au narrateur (l’Evangéliste) quand le Christ s’exprime par le truchement d’une basse, la Vox Christi. En revanche, Künstel rompt avec la répartition traditionnelle pour caractériser les soliloquentes (personnages individuels) en référence à une symbolique des voix en usage à cette époque : la soprano incarne l’amour (les femmes au pied de la croix), l’alto représente l’âme meurtrie (Pierre et Judas), le ténor suggère l’espérance (deux autres disciples) quand la basse figure l’autorité (Pilate, le Grand Prêtre, le capitaine). Les chœurs, enfin, évoquent la foule (turba) ou prolongent la prédication, faisant office de caisse de résonance pour la diffusion des messages-clés de la théologie luthérienne. Les chorals, en revanche, sont confiés aux solistes pour mettre en perspective les enseignements évangéliques.
Sa composition accompagne l’assemblée curiale de Cobourg pendant le parcours mystique qu’elle va effectuer à l’occasion des cérémonies du Jeudi (Gründonnerstag : le terme « grün » étant dérivé de grunen qui, en ancien allemand littéraire, signifie « pleurer ») et du Vendredi (Karfreitag : le terme « kar » qui, en ancien allemand littéraire « chara », renvoie à « gémir ») Saints. Selon le plan musical dressé par Künstel, elle franchira huit étapes pour s’incliner finalement au pied de la croix. Huit étapes car, pour chacun de ces deux jours, quatre séquences sont proposées : deux s’appliquent aux célébrations du matin (avant et après le prêche) et deux autres concernent le service de l’après-midi (encadrant également un sermon).
Une Sonata instrumentale en trois courtes parties, suivie d’un mouvement choral, sonnent le départ du cheminement spirituel qui mènera la communauté jusqu’aux fêtes de Pâques. Les violons sanglotent, les basses exhalent de longs soupirs, les altos halètent d’émotion. De discrètes dissonances et de douloureux silences plongent l’âme dans l’atmosphère sombre et angoissante du récit qui va s’ouvrir.
Dès le chœur d’entrée, à vocation pédagogique, Künstel dévoile une dimension de son imposant savoir-faire. Il découpe le texte poétique en trois segments reliés par une ritournelle instrumentale. Une ouverture chorale souligne d’abord que le sacrifice dont il va être question échappe à toute raison humaine. Deux procédés s’y conjuguent : la répétition lancinante des mots clés (Kein menschlich Sinn/ aucun entendement humain) sur un mode homophone pour affirmer le primat de la foi sur la raison ; la polyphonie dont le riche contrepoint qualifie la nature complexe du don de soi (als er sich gibt zum Tode an/ lorsqu’il s’abandonne à la mort). Le segment central est dominé par les solistes. Les formes se succèdent. D’abord, un trio énonce les enjeux (dass sein Geschöpf nicht ewig soll verbleichen/ pour que sa créature ne soit pas éternellement abandonnée) sur le mode de l’imitation, reprenant en cascade le message de façon à submerger l’esprit de chaque auditeur. Ensuite, le tutti appelle le cœur de chacun à exprimer sa gratitude (bedenk, mein Herz) pour la preuve incomparable d’amour que constitue le sacrifice suprême. Enfin, la basse s’abîme dans les enfers, révélant, par des images suggestives, le destin diabolique auquel Höllenkind (l’enfant de l’enfer) pourra désormais échapper. Dans la séquence finale, le chœur renoue avec sa formule initiale pour enjoindre l’assemblée à se montrer désormais à la hauteur de ce sacrifice. Toute la théologie de la croix de Martin Luther (1483-1546) se trouve condensée dans ce bref mais fervent propos liminaire.
Dans un initium imprégné d’affliction, un duo (soprano-alto) annonce au public le début imminent de la narration. Celle-ci fera alterner de courtes interventions solistes et chorales selon une répartition des rôles déterminée en fonction des effets recherchés. Les premières, de nature foncièrement madrigalesques, accompagnent les mouvements de l’âme et guident l’introspection individuelle : le recitativo secco (monodie d’inspiration italienne de l’Evangéliste avec le soutien du seul continuo perlé par le luth), le recitativo accompagnato (Jésus enveloppé dans un halo de violons) ou l’aria pour les séquences spirituelles. Pour mémoire, Bach utilisera les mêmes procédés, trente ans plus tard, lorsqu’il charpentera sa Matthäus-Passion BWV244. A l’inverse, les chœurs scandent les étapes majeures du récit et traduisent les effets de masse ou les émotions collectives. Dans ces deux genres musicaux, Künstel fait preuve d’une ingéniosité expressive, tant dans le lissage des lignes mélodiques que dans la manière raffinée de les ornementer. Au-delà des aspects techniques, il excelle dans l’art d’attiser les affects par le seul effet de sa musique. Avec le concours, on ne le soulignera jamais assez, d’interprètes qui magnifient littéralement sa partition.
Le matin du Jeudi Saint, avant le prêche
L’Evangéliste énonce les premières lignes du chapitre 14 de l’Evangile de Marc traduit par Luther en 1545. Celles-ci révèlent qu’une machination ourdit contre Jésus. Si l’Evangéliste s’exprime avec une sobriété indispensable à la compréhension du récit, l’austérité de la psalmodie est délibérément écartée. Ponctuellement, certains mots sont soulignés par de prudents ornements, comme ce tremblement sur töteten (le tuer) pour ne laisser aucun doute sur les intentions des Grands Prêtres. Plus loin, dans l’épisode de l’onction de Béthanie, des vocalises ascendantes puis descendantes figurent le flacon de parfum qui se brise (zubrach) et le parfum qui se répand (goss). Une narration dont la tonalité réfléchie tranche avec la vivacité du chœur intervenant à deux reprises pour laisser s’exprimer la conscience de la foule des gens du commun. La première fois pour prédire un soulèvement populaire si le procès se tient en pleines fêtes de Pâques ; la seconde, pour admonester la servante maladroite qui gaspille un riche parfum dont le produit de la vente aurait soulagé les pauvres. Au passage, la répétition lourdement insistante de und den Armen gegeben werden (et qui pouvait être donné aux pauvres) sonne comme un rappel du devoir de charité adressé au public privilégié de la chapelle ducale de Cobourg.
Dans le texte évangélique, l’incident du flacon brisé donne l’occasion à Jésus d’annoncer sa mort prochaine. Künstel commente la parole christique en l’enserrant entre un aria et un choral. En deux strophes soudées par une ritournelle instrumentale, deux duos (soprano-alto) aux accents séraphiques rappellent d’abord que les événements à venir ont été décidés en conscience par Dieu (bei Gott war gut beschlossen). Le tempo est léger, les voix célestes, les instruments scintillants. Manifestement, une mise en scène signifiant que le message provient de l’au-delà. Un au-delà que Jésus évoque maintenant dans un récitatif marqué par la dignité et la gravité : le parfum répandu préfigure sa mise au tombeau. Ses paroles glissent sur une onde paisible animée par les cordes et constellée par le luth. La première et troisième strophe d’un hymne habituellement chanté au chevet des mourants lui fait écho : Herzlich tut mich verlangen nach einem sel’gen end (Je désire de tout cœur une fin heureuse). Ce texte rédigé par Christoph Knoll (1563-1630) lors de la peste de 1599 est sublimé par la mélodie d’une chanson d’amour composée par Hans Leo Hassler (1564-1612), un ami de Giovanni Gabrieli (1557-1612), également élève de son oncle, Andrea (1533-1585). Mélodie qui se forgera d’ailleurs un second destin en s’habillant de nouvelles paroles, celles du O Haupt voll Blut und Wunden (O tête pleine de sang et de plaies) de Paul Gerhard (1607-1676). Ce passage est d’une touchante beauté car la première et troisième strophe du choral sont interprétés sur le mode de l’alternatim, une technique traditionnelle dans le domaine de la musique liturgique. Il confie respectivement les versets impairs et pairs à deux groupes distincts de chanteurs. Mais cette formule s’applique, cette fois, à un cantique initialement conçu pour être entonné par une communauté à l’unisson. Au demeurant, ce chant en forme de répons peut prendre des allures spectaculaires comme, par exemple, dans cette magnifique Messe luthérienne pour le matin de Noël de Michael Praetorius (1571-1621) dont nous avons rendu compte dans ces colonnes. Dans le chant alterné imaginé par Künstel, le pupitre des soprani énonce délicatement les versets impairs tandis que les autres pupitres lui répondent par les versets pairs. Sublime. Particulièrement ce simple trille qui, en faisant onduler süss (doux), modifie le ton de la seconde strophe sans rien changer à ses fondamentaux.
Juste avant le prêche, Künstel développe un dernier thème, celui de la prochaine trahison de Judas. La scène se déroule en trois temps. L’Evangéliste proclame d’abord les deux versets du texte de l’Evangile. Dans un aria au tempo enlevé et aux allures de chanson populaire, deux duos (ténor-basse) successifs tentent ensuite de le dissuader. Halt, Judas, Judas, halt, proteste le premier ; Verlorenes Teufelskind (enfant perdu du diable) l’insulte le second. Un bien terrible message porté par une ligne mélodique et rythmique enjouée. Irrésistible ! Ce contraste s’efface enfin lorsqu’une voix d’alto entonne amèrement la première strophe du choral O Mensch, bewein dein Sünde gross (O homme, pleure sur ton grand péché). Le texte a été composé par Sebald Heyden (1499-1561) sur un air imaginé par un ancien choriste de l’église St Etienne de Strasbourg gagné à la Réforme, Matthias Greiter (1495-1550). Dans une première moitié de la strophe, Künstel adopte à nouveau le procédé du répons. Il en aménage cependant la forme en attribuant au chœur les seuls versets qui soulignent la vocation salvatrice du Christ. Dans la seconde partie, en vertu du principe rhétorique de la varietas, les versets sont plus largement distribués entre les tessitures. Cependant, les deux lignes conclusives sont portées par le chœur, comme pour annoncer une première pause sur ce long chemin de croix.
Le matin du Jeudi Saint, après le prêche
Cette seconde étape de la matinée lève le voile sur un tableau au caractère intimiste : la Cène qui réunit Jésus avec ses disciples pour un dernier repas en commun. Cet événement constitue l’un des piliers de la doctrine luthérienne, en opposition frontale avec la théologie de la transsubstantiation catholique. Parce que « le corps et le sang du Christ sont réellement présents dans le repas du Seigneur » (La Confession d’Augsbourg, article X, 1530), l’Eucharistie doit se conformer strictement à la forme instituée par le Christ. C’est pourquoi Künstel privilégie ici le texte de l’Evangile et minimise les interpolations.
Deux personnages dominent donc logiquement cette séquence : l’Evangéliste (récitatif) et Jésus (récitatif accompagné par les cordes). De bout en bout, la forme est sobre. Tout juste quelques vocalises expressives pour figurer le départ de deux disciples à la recherche d’un lieu de convivialité (sandte/ envoyer) ou cette répétition pour jeter la malédiction sur le futur traître (wehe aber dem Menschen) en ne manquant pas d’y inclure tous les adversaires de la vraie foi selon Luther. Et déjà point une petite scène dialoguée discrètement glissée dans la narration de l’Evangéliste au moment de l’annonce d’une trahison prochaine. Manifeste-t-elle le goût du compositeur pour la théâtralité ?
En revanche, un seul chœur au contrepoint joyeux pour interroger Jésus : où veux-tu manger la Pâques ? De même, un seul aria dans lequel un soliste (contralto), tourmenté par le luth, commente nerveusement le propos de Jésus déclarant qu’il eut mieux valu que celui qui le trahira ne fût jamais né. A peine deux chorals pour saluer respectivement la distribution du pain et du vin selon l’esprit de la théologie luthérienne : « le Sacrement a été institué pour réconforter et pour ranimer les âmes épouvantées » (Apologie de la Confession d’Augsbourg, XXII, 1531). Pour le pain, il choisit, fort opportunément, la première et seconde strophe du choral de consolation d’un pasteur, Sigismund Scheretz (1584-1639), dont l’expérience personnelle (sept de ses enfants lui ont été ravis par la peste) inspire des vers d’une grande délicatesse : Mein Seel dich freu, und lustig sei (Mon âme, tu es heureuse et libre). Le second choral célèbre le sang du Christ sur des paroles de Justus Sieber (1628-1695), un autre pasteur particulièrement actif en Basse-Saxe : O teures Blut, du dienst zum Leben (O inestimable sang, tu aides à vivre). Ce choral adopte la structure strophique de ce chant ecclésiastique populaire (Lied) qui avait offert sa matrice au choral luthérien en gestation.
Jeudi Saint, après-midi, avant le prêche
Autant le tableau précédent privilégiait le texte de l’Evangile, autant ce début d’après-midi est consacré à la méditation. Il est vrai que la halte à Ghethsémani s’y prête singulièrement. Aussi, les récitatifs reposent-ils sur deux imposants arias qui proposent des espaces d’introspection à la communauté réunie pour le deuxième service de la journée.
Le premier aria ouvre une réflexion sur le thème de la présomption (Vermessenheit). La strophe d’entrée prend prétexte du reniement de Pierre pour souligner la faiblesse inhérente à la condition humaine : Pierre était préparé et il a pourtant failli ! Ce duo associant l’aigu et le grave, assortit un contrepoint sage à une figure de style poétique, l’épiphore. Dans le cas présent, les deux chanteurs appuient le dernier mot des deux derniers vers par des vocalises prolongées. Comme vermessen (mesurer) et vergessen (oublier) vibrant sur une rime en écho. Succédant à une ritournelle instrumentale dans laquelle le violon et le continuo reformulent la ligne mélodique, la seconde strophe élargit le propos en condamnant la vanité de ceux qui font étalage de leur dévotion en contradiction avec leurs actes. Cet aria au rythme mordant unit l’art poétique et la science musicale pour administrer un sermon en musique sans concession.
Le second aria est fondé sur une figure de style poétique à l’opposé de la précédente. Ici, l’anaphore se saisit du début de chacune des trois strophes pour marteler l’expression de la douleur ressentie par l’âme face à la mort (In Tod betrübte Seel). Application pratique de la mystique protestante, l’aria invite l’assemblée à intérioriser l’angoisse que Jésus vient de confesser (Meine Seele ist betrübt bis an den Tod/ Mon âme est triste à en mourir). Pour accompagner l’âme dans cette fusion des affects, un duo de dessus l’enveloppe dans un parfum de mélancolie. Par ailleurs, le choix des tessitures divulgue un message sous-jacent. Si, traditionnellement, la voix de soprano incarne la confiance et l’alto, l’âme meurtrie, Künstel délivre, par cette distribution, l’un des enseignements de la théologie luthérienne : la mort n’est pas une fin mais l’espérance d’une vie nouvelle. Dans le même ordre d’idées, le narrateur est assisté, durant toute la scène se déroulant sur le Mont des Oliviers, par une voix d’alto. Une fois encore, la symbolique des voix associe la confiance chantée par le ténor à l’affliction extériorisée par l’alto.
L’expression de la foi en la volonté divine couronne ce temps de réflexion par une note d’espérance. Pour la révéler, Künstel choisit la cinquième et la sixième strophe du choral Was Gott tut, das ist wohlgetan (Ce que Dieu fait est bien fait), sur les paroles apaisantes de Samuel Rodigast (1649-1708) et une mélodie réconfortante de Severus Gastorius (1646-1682), tous deux ses contemporains.
Jeudi Saint, après-midi, après le sermon
Le récit de l’arrestation de Jésus mêle l’opéra à la dévotion. Car, aux récitatifs s’ajoutent ici des ariosos d’une intense expressivité. C’est bien connu. La structure de l’arioso est plus libre que celle de l’aria. Aussi a-t-elle ici pour effet de rendre le récit plus dynamique. Déjà employé dans le tableau précédent pour objectiver le caractère incompréhensible, pour l’esprit humain, des événements prochains (Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zertreuen/ Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées, expliquait énigmatiquement Jésus), les deux ariosos personnifient maintenant deux affects : l’impatience de Jésus face aux disciples endormis et l’incompréhension de se voir interpelé comme un brigand.
Ce jeu dramatique en deux chapitres est régulièrement suspendu par des moments consacrés à la réflexion (aria) ou abandonnés à la contemplation (choral). Dans la première période, Jésus s’indigne de voir ses disciples appesantis. Une manifestation, explique le premier aria, de l’immense faiblesse de la chair humaine (Des Fleisches Schwachheit ist so gross). Le tempo est tourmenté, comme écartelé entre la velléité de l’esprit et la corruptibilité du corps. La voix ferme et tranchante de Magdalena Harer se déploie sur toute l’étendue de sa tessiture vocale, matérialisant ainsi l’écart séparant ces deux composantes de la constitution humaine. Dans le second aria, la voix affûtée de Cornelius Uhle secoue l’assemblée au rythme impétueux du continuo : il faut se réveiller car le Seigneur va être livré aux chiens (böse Hunde). Ces deux arias enserrent un choral particulièrement poignant. Künstel extrait les deuxième et quatrième strophes du cantique de pénitence composé par Bartholomaüs Ringwalt (1532-1599) et les façonne à la manière d’un répons. Mais, cette fois, il y ajoute une touche de commisération suggérée par le chant a capella de la partie soliste (soprano). Bouleversant.
La seconde période met en scène l’arrestation proprement dite. La symbolique des voix joue à nouveau un rôle signifiant. En effet, la narration est soudainement interrompue par Alexander Schneider dont la voix effilée de contralto tremble devant le forfait que vient de commettre Judas. Son indignation est attisée par la fébrilité du luth, injuriant ce Verfluchter Kuss (maudit baiser) qu’il a infligé à Jésus. Le texte multiplie les anathèmes en répétant inlassablement le terme Verflucht (damné). Afin de criminaliser cet acte, il y ajoute l’évocation d’armes contondantes (Dolch/ épée) doublée de l’accusation de trahison meurtrière (Mordverrat). Voilà un Judas vigoureusement envoyé au diable ! Les deux premières strophes du choral So gehstu nun, mein Jesu hin (Mon Jésus, tu y vas maintenant) de Kaspar Friedrich Nachtenhöfer (1624-1684) constatent douloureusement le résultat du forfait, aggravé par l’abandon de Jésus par ses disciples. Jésus marche désormais vers sa mort. La tonalité d’ensemble de ce choral lacrymal est à la repentance. L’émotion est à fleur de sons. Est-elle amplifiée par le souvenir de l’auteur du texte que Künstel a probablement rencontré au cours des derniers mois de son existence, lorsqu’il exerçait les fonctions de pasteur en la Moritzkirche de Cobourg ?
Vendredi Saint, matin, avant le prêche
Dans un souci manifestement didactique, Künstel segmente le scénario de cette première partie de l’office du Vendredi Saint en quatre plans-séquences. Ces plans défilent, image par image, pour créer l’illusion du mouvement. Chacun d’eux s’ouvre par un récitatif et se conclut sur un choral. Cette ingénieuse construction millimétrée permet à l’assemblée de revivre les différents moments de l’événement tout en tirant des enseignements pratiques pour vivre chrétiennement.
Le premier plan relate l’épisode des faux témoignages. Comme pour donner réalité à l’entrée en matière de l’Evangéliste, le chœur réunit les faux témoins qui rapportent des propos fallacieusement attribués Jésus. L’écriture en imitation figure les témoins à charge qui se succèdent. En revanche, leurs propos, débités sur un rythme nerveux et dardés de vocalises convulsives (notamment sur un crispant abbrechen (briser) fouetté par le pupitre des altos), exhalent l’odeur amère du mensonge. Pour marquer la compassion que suscite la peine endurée par le Christ, un choral dont nous n’avons pas trouvé la provenance (appartient-il au strict répertoire local ?) s’incline respectueusement devant la victime de l’ingratitude (Undank).
Lors de son interrogatoire, Jésus s’enferme d’abord dans le mutisme. Un aria se glisse dans cet espace pour inviter l’auditeur à s’interroger sur sa propre responsabilité dans le supplice infligé à Jésus : Aber meine Sünden, die den Heiland binden, sind nur allzu klar (Mais mes péchés, qui lient le Sauveur, sont trop clairs) déplorent deux solistes du dessus. Lorsque Jésus finit par rompre le silence, c’est pour annoncer qu’il va bientôt siéger à la droite de la Puissance (zur rechten Hand der Kraft). En écho, la première strophe du choral Es ist gewisslich an der Zeit (Il est certain qu’en son temps) de Bartholomaüs Ringwald sur une mélodie de Martin Luther (1529), prévient que sonnera alors l’heure du jugement.
Tandis que le Grand Prêtre fait appel au jugement populaire, Künstel laisse éclater un aria à charge. D’abord contre les lettrés qui ne comprennent rien au message de Jésus : comment, toi si savant, ne comprends-tu pas ce que Jésus te dit ? Ce texte militant évoque sans doute toutes les dérives théologiques qui éloignent les fidèles de l’enseignement du Christ tel que Luther l’a rétablit. Une seconde charge couvre le Grand Prêtre de honte et le tire mit deinem Volk zur Hölle reissen (avec son peuple, jusqu’en enfer). Un peuple (turba) dont l’écriture en imitation amplifie la revendication tandis que le Christ subit les coups de ses tortionnaires. Sur le mode du répons, la neuvième strophe du choral Jesu Leiden, Pein und Tod (Souffrance, douleurs et mort de Jésus) de Paul Stockmann (1603-1636), chantée sur une mélodie de Melchior Vulpius (1560 ?-1615), établit un parallèle entre les affronts subis par le viel fromme Gott (très pieux Dieu) et du, sündige Gestalt (toi, figure pécheresse).
Place maintenant au second reniement de Pierre. Dans cette scène, Künstel introduit une pastille lyrique dans le récitatif. Ainsi, comme à l’opéra, les différents acteurs s’invitent dans le récit de l’Evangéliste. Avant que le chœur, revêtu de l’habit de la turba (foule), n’explose pour affirmer l’appartenance de Pierre au cercle des intimes de Jésus. Dans ce passage véhément, aiguillonné par les coups d’archets, les musiciens parviennent à reconstituer une foule dont l’exaspération gonfle. Une dramatisation extraordinairement façonnée. Les première, seconde, cinquième et septième strophes du choral Herr, ich habe missgehandelt (Seigneur, j’ai maltraité) de Johann Franck (1618-1677) résonnent alors comme une véritable confession empreinte de piétisme : j’ai failli et veux me dissimuler ; mais je sais que tu me retrouveras où que j’aille ; pourtant, une seule goutte de ton sang pourrait me guérir. Afin d’affirmer l’importance d’un lien privilégié avec Dieu, Künstel confie à un soliste, de façon tout à fait exceptionnelle, la strophe qui évoque les flots de larmes que la mélodie de Johann Crüger (1598-1662) crible de ruptures en forme de sanglots.
Vendredi Saint, matin, après le sermon
Dans la scène du jugement de Pilate, Künstel se glisse dans le rôle d’un directeur de conscience. Pour guider le cheminement spirituel de l’assemblée, il croise deux récits portés par une dynamique inverse. Dans le premier, le texte de l’Evangile, le sort du Christ sombre vers sa condamnation à mort. Dans le second, trois arias jalonnent un chemin d’espérance pour l’âme du fidèle. Chacun d’eux fait écho à un propos ou une attitude de Pilate.
Sur un tempo martial battu par le continuo, la voix assurée et engagée de Philipp J. Kaven évoque tous ces hypocrites qui se fédèrent pour faire condamner le Christ. Parmi les premiers, ce clergé (Geistlichkeit) qui, pour les besoins de sa cause, se mue en délateur (Lügendichter). Mais aussi Ich aber ich und du (moi, mais également moi et toi) désignant tous ces pécheurs sortis de la couvée du diable (Teufelsbrut) et qui précipitent le Christ vers son martyre. Le luth fait vibrer la mauvaise conscience tapie dans le cœur des auditeurs. Une nouvelle fois, cet aria manifeste cet axe de la théologie luthérienne déclarant que « la nature humaine est réduite en servitude, elle est retenue captive par le diable qui… l’entraîne à des péchés de tout genre ». Cela pour mieux affirmer ensuite que, « de même que le diable ne peut être vaincu sans l’aide du Christ, de même, nous ne pouvons nous affranchir de cette servitude par nos propres forces » (L’Apologie de la Confession d’Augsbourg, II).
Dans le second aria, un duo du dessus se penche sur le corps martyrisé der Unschuld Lamm (de l’agneau innocent). Sur une tonalité d’ensemble mêlant la culpabilité à la compassion, l’âme invoque l’indulgence. La poésie de ce texte joliment rimé est transcendée par une musique d’une profonde commisération. Des notes longuement tenues et soutenues par un continuo duveteux projettent deux représentations de Dieu. D’abord, ce Dieu d’amour figuré par l’évocation du fiancé (Bräutigam). Ensuite, celle du Dieu de miséricorde auquel le duo s’adresse pour la délivrance immédiate de l’âme du fidèle (erlöse mich anheute).
Le dernier aria invoque le Ciel : Vois-tu ce que l’on fait à ton Fils ? Le duo du dessous s’en prend d’abord aux prêcheurs malfaisants (Pfaffenbrut). Notons que cet acharnement à l’égard des théologiens semble renvoyer l’écho d’une crise morale qui avive alors les antagonismes religieux (en France, en Angleterre ou en Allemagne). Probablement cette « crise de conscience européenne, 1680-1715 » décrite par Paul Hazard (1878-1944), exacerbée, en Allemagne, par l’effet d’aspiration provoqué par l’édit de Potsdam (29 octobre 1685) offrant l’asile aux protestants français confrontés à la révocation de l’édit de Nantes. Pourtant, reconnaît l’aria dans la seconde strophe d’une grande vivacité, ce sacrifice est volontaire car Jésus entend sauver cet homme, même lorsque celui-ci préfère le vent et l’ombre à la vraie joie de l’âme (der oft Wind und Schatten wählt, vor die wahren Seelenfreuden).
Ce développement exceptionnellement long, consacré au face-à-face de Jésus et de Pilate, renvoie peut-être au mythe de la conversion de Luther. En 1511, celui-ci se trouve à Rome. Afin d’obtenir une indulgence pour le salut de l’âme de son grand-père, « il monta sur les genoux l’escalier saint du Latran, l’escalier du palais de Pilate gravi autrefois par Jésus et qui, selon la légende, avait été transporté à Rome », raconte Mathieu Arnold (Luther, 2017). Au cours de cette ascension, la parole du prophète Habakuk le saisit subitement : « le juste vivra par la foi ». Aussitôt, Luther s’éloigne pour s’engager dans le combat de la Réforme.
Cette longue méditation s’achève sur une scène d’opéra. Avec la puissance accompagnant souvent une émotion populaire, le chœur exige la crucifixion du Christ. Ce mouvement choral, bref mais d’une intensité dramatique, reconstitue un effet de foule ingénieusement ordonné par la technique d’un maître ès écriture musicale. En revanche, la première et troisième strophe du choral Herzlibster Jesu, was hastu verbrochen (Mon cher Jésus, qu’as-tu fait de mal ?) de Johann Heermann (1585-1647) entend désigner le vrai coupable. Sur une mélodie introspective de Johann Crüger, il affirme l’innocence de Jésus et reconnaît la culpabilité de chacun de nous : meine Sünden haben dich geschlagen (mes péchés t’ont frappé).
Vendredi Saint, après-midi, avant le prêche
Cette station constitue probablement le moment le plus important (et le mouvement le plus long) du cheminement spirituel. En témoigne la profusion des chorals et des arias imposant un temps de réflexion ou de contemplation individuelle à chacune des étapes du calvaire qui conduit Jésus des portes du tribunal au bois de la croix.
Les récitatifs sont plus expressifs. Les turba toujours aussi vindicatives. Mais ce sont les chorals qui se distinguent par un éventail de formes largement ouvert.
D’abord, Künstel convoque trois strophes d’un même cantique pour accompagner Jésus jusqu’au Golgotha : Herr Jesu Christ, meins Leben Licht (Seigneur Jésus Christ, lumière de ma vie) de Martin Behm (1557-1622). Sur un tempo léger, sa cinquième strophe transcende les coups et les moqueries subies car ils ont pour effet d’effacer les péchés et de redonner aux hommes honneur et joie (lass sein meine Ehre, Freud und Wonn). Un bel exemple de ce clair-obscur poétique et musical juxtaposant l’image de la torture à celle du bonheur. Dans le même esprit figuratif, la dixième strophe de ce choral commente l’assistance qu’apporte Simon de Cyrène pour porter la croix. Le fidèle y réclame pour lui-même la croix afin de s’en servir de bâton de marche, le repos qui fera office de tombeau et le linceul du Christ dans lequel il s’enveloppera à sa propre mort. La sixième strophe, enfin, déclare que la boisson amère servie à Jésus se transforme en source d’énergie pour le croyant.
Ensuite, il adopte une forme hybride croisant le choral à une litanie (Choral-Litanei) pour s’incliner devant Jésus en croix. Cette forme archaïque était « chantée avec une intense dévotion par un peuple illettré », explique le théologien Johann Christian Wilhelm Augusti (1772-1841) dans ses Beiträge zur christlichen Kunst-Geschichte und Liturgik (1841). Le choral Das Leben für uns in den Tod geben (Donne-nous la vie dans la mort) a été composé par un ancien superintendant général de la principauté de Cobourg, Melchior Bischoff (1547-1614). Sa renommée survivait probablement au sein du palais, notamment en raison des oraisons funèbres qu’il avait prononcées lors de l’inhumation des plusieurs membres de la famille princière de Cobourg. Chacune des trois strophes est auréolée d’un Kyrie eleison, Christe eleison chanté par le pupitre des soprani avant que le chœur ne se saisisse du Kyrie eleison final qu’il enrobe dans de doux ornements. Un passage magnifique dans lequel un legato onctueux est appliqué sur les plaies du supplicié.
Les deux derniers chorals renouent avec une forme un peu plus traditionnelle. Le premier exprime la gratitude de l’assemblée envers celui dont l’humilité a expié nos fautes (deine Demut hat gebüsset). Künstel adopte, une nouvelle fois, la formule bouleversante de répons pour confier alternativement au ténor et au chœur le chant de cette septième strophe de l’hymne funèbre Jesu, meines Lebens Leben (Jésus, vie de ma vie) composé par Ernst Christoph Homburg (1607-1681). Enfin, lorsque Jésus lance un appel désespéré à Dieu, Magdalena Harer entonne la première strophe de l’émouvant O Lamm Gottes unschuldig (O agneau de Dieu innocent) de Nikolaus Decius (1480 ?-1541). Sa voix portée par un fragile continuo plonge droit au cœur, tant par l’émotion qu’elle dégage que l’envoûtement qu’elle produit.
Aux chorals s’ajoutent trois arias en forme d’oraisons. Ils imposent à la narration des temps d’arrêts permettant au fidèle d’établir un rapport personnel avec la divinité. Künstel les place à trois moments précis du récit : la montée vers le Golgotha, la crucifixion, la mort sur la croix. Dans le premier, un trio (soprano, alto, ténor) appelle l’âme du fidèle à aider le Christ à porter le fardeau de la croix. L’ensemble est interprété sur un mode homophone, hormis le dernier verset dont l’écriture en imitation fixe trois instantanés : le poids écrasant de la croix, Jésus méconnaissable dans la souffrance, la reconnaissance due pour ce sacrifice suprême. Dans le second aria, un duo (ténor, basse) contemple respectueusement le crucifié importuné par des quolibets. Avant d’appeler Dieu, dans un lamento rempli de tristesse mêlée de honte, à ne plus le laisser céder das Teufel, Welt und schändlich böse Sünden (au diable, au monde et à la honte du péché). Enfin, répondant au long silence de l’Evangéliste constant la mort de Jésus, un alto traduit le testament de Jésus adressé à ses fidèles : ma mission est accomplie ; la souffrance a pris fin ; regarde mes plaies et rappelle-toi : Vor dich stirbt der Gerechte (Devant toi meurt le Juste). Notons cette subtile et ingénieuse distribution vocale qui, du trio au solo, figure l’épuisement progressif de l’énergie vitale.
Vendredi Saint, après-midi, après le sermon
Voici venu le temps de l’inhumation du corps terrestre de Jésus. Le kapellmeister Künstel préside à ses funérailles. Le programme musical qu’il a conçu pour l’occasion revêt un caractère éminemment œcuménique dans la mesure où son chant d’entrée et de sortie associent des auteurs catholiques et protestants.
De fait, la célébration s’ouvre sur un hymne funéraire en latin probablement extrait de l’Opus Musicum (1587) de Jakob Händl, également désigné sous le pseudonyme Jacobus Gallus (1550-1591). Ce maître de chœur et cantor catholique propose ici un motet d’une harmonie et d’une profondeur saisissante. Chanté a cappella, son Ecce quomodo moritus justus (Voyez comment meurt le Juste) couvre d’un voile soyeux le corps du supplicié et étreint notre esprit. Cette déploration funèbre a particulièrement séduit les musiciens de toutes obédiences qui le convoquent régulièrement pour accompagner musicalement les services funèbres. Comme nombre d’entre eux, Georg Friedrich Haendel (1685-1759) l’intégrera dans sa grande élégie pour la reine Caroline (1683-1737), The Ways of Zion Do Mourn (Les chemins de Sion sont en deuil) HWV 264.
Deux récitatifs respectivement suivis d’un aria achèvent le récit en le soumettant à la méditation personnelle. Faisant d’abord écho aux cataclysmes qui s’abattent sur Jérusalem lorsque Jésus rend l’âme, un premier aria au rythme enjoué oppose l’incrédulité du cœur des juifs à l’espérance du croyant en une éternité heureuse. Sans cesse relancés par des ritournelles instrumentales, Piotr Olech et Sören Richter combinent leurs couleurs vocales radieuses pour différencier ces deux mondes que la foi sépare. Dans le second aria, Marie Madeleine et Marie, la mère de Jacques, adressent un discours de réconfort à Jésus qui repose maintenant au tombeau. Dans une berceuse d’une grande tendresse, Joowon Chung et Magdalene Harer souhaitent à Jésus un bon repos, assimilant le sommeil et la mort. Une analogie alors courante pour signifier l’adieu au monde et l’espérance du croyant d’être réveillé pour rejoindre la Cité de Dieu.
Enfin, deux mouvements chorals couronnent ce voyage spirituel dans le monde de la Passion du Christ. Le chœur tourne ostensiblement le dos à la foule (turba) pour adresser à Jésus, au nom de l’assemblée, un remerciement chaleureux. Il énumère, sur un mode en partie litanique, les nombreuses peines endurées. Ce court motet d’action de grâce ennobli par la polychoralité est salué par un Amen fugué flamboyant. Avant d’entonner l’intégralité du choral O Traurigkeit, O Herzeleid (Quelle douleur saisit mon cœur) dont la première strophe a été composée par le jésuite Friedrich Spee von Lagenfeld (1591-1635) et les sept suivantes par le luthérien Johann Rist (1607-1667). Ces huit strophes sont réparties entre le tutti instrumental et vocal pour les strophes encadrantes et une strophe médiane et des solistes successifs pour toutes les autres. Cette variété dans la distribution produit une stéréophonie acoustique qui, en renouvelant systématiquement la couleur sonore, accorde à chacune des strophes une égale valeur spirituelle.
Impressionnés. Ce mot qualifie l’heureuse disposition d’esprit dans laquelle nous nous trouvons après ces plus de deux heures d’écoute. Impressionnés par la connaissance encyclopédique des Gesang-Bücher (livres de cantiques) dont Künstel fait la démonstration lorsqu’il procède au choix toujours judicieux des chorals destinés à illustrer de manière sonore le texte de l’Evangile de Marc. Impressionnés par ces lignes mélodiques d’apparence simples et immuables mais qui se renouvellent en permanence. Impressionnés par ce parcours spirituel d’une cohérence qui révèle autant l’art de l’exégète que l’expertise du musicien. D’un musicien qui, au demeurant, renonce à l’ampleur et la virtuosité au bénéfice de la profondeur et d’une dévotion fermement ancrée dans la tradition luthérienne et pourtant caressée par une douce lumière italienne.
Fascinés. Nous le sommes par la qualité des interprètes. La diction exemplaire des solistes révèle l’importance préalable du travail qu’ils ont réalisé sur le texte dont ils nous dévoilent toutes les nuances littéraires et sensibles. Leurs voix séduisent par leurs timbres parfaitement exercés mais surtout par la générosité avec laquelle ils portent ce que le texte ne révèle pas d’emblée : l’émotion sous-jacente. Les instrumentistes, enfin, s’affirment comme de précieux partenaires des voix. Ils les soutiennent et les accompagnent avec une force mêlée de délicatesse. Mais, notamment dans les nombreuses ritournelles, ils s’installent comme d’habiles et inspirés compagnons de route. Ensemble, ces excellents interprètes nous entraînent sur le chemin de la découverte de ces pages qui élèvent ce compositeur méconnu au rang des précurseurs majeurs du baroque flamboyant.
Publié le 17 juil. 2020 par Michel Boesch
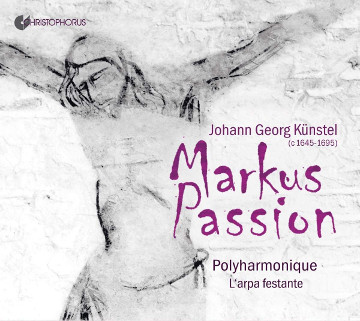 ©
©