Membra Jesu nostri, Cantatas - D. Buxtehude
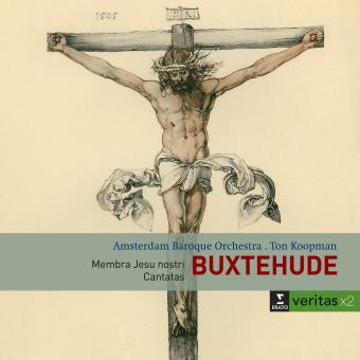 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret trilingue (anglais-allemand-français), deux CD , durée 62 et 61 minutes, Erato-VeritasX2 - 2017
Compositeurs
- Dieterich Buxtehude (1637-1707)
- Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes (BuxWV 77)
- Ihr lieben Christen, freut euch nun (BuxWV 51)
- Ich habe Lust abzuscheiden (BuxWV 46)
- Herr, wenn ich nur dich habe (BuxWV 39)
- Nun danket alle Gott (BuxWV 79)
- Membra Jesu nostri patientis sanctissima (BuxWV 75) :
- Ad pedes : Ecce super montes
- Ad genua : Ad ubera portabimini
- Ad manus : Quid sunt plagae istae
- Ad latus : Surge, amica mea
- Ad pectus : Sicut modo geniti infantes
- Ad cor : Vulnerasti cor meum
- Ad faciem : Illustra faciem tuam
Chanteurs/Interprètes
- Barbara Schlick, soprano I
- Monika Frimmer, soprano II
- Michael Chance, alto
- René Jacobs, alto
- Christoph Prégardien, ténor
- Peter Kooy, basse
- Chœur: Knabenchor Hannover
- Chef de chœur : Heinz Henning
- Orchestre : Amsterdam Baroque Orchestra
- Direction : Ton Koopman
Pistes
- 1.CD 1 : Cantates
- 2.CD 2 : Membra Jesu nostri
Sublimes accents de ferveur à la Marienkirche de LübeckPour le cycle de cantates Membra Jesu nostri, nous rendrons également compte du magnifique concert donné le 7 mars 2017 dans le cadre de la saison 2016-2017 Musique sacrée à Notre-Dame de Paris. La Maîtrise Notre-Dame de Paris (chœur d’adultes) et l’orchestre des élèves du Département de musique ancienne du Conservatoire de Paris étaient placés sous la direction d’Henri Chalet, chef de chœur principal de la Maîtrise Notre-Dame de Paris.
Connaissez-vous le retable achevé en 1555 par Lucas Cranach le Jeune (1515-1586) pour la Stadtkirche de Weimar ? Parmi les personnages représentés, Cranach et Martin Luther (1483-1546) se tiennent au pied de la croix. « Tandis qu’un jet de sang part du flanc du Christ pour atteindre le sommet de la tête du peintre, Luther, lui, tient une Bible ouverte et désigne du doigt un verset biblique » (Jérôme Cottin – Arts sacrés, n°7, septembre-octobre 2010). C’est ainsi que nous nous représentons Dieterich Buxtehude, absorbé dans la composition de son œuvre : le musicien prend la place du peintre, les sons remplacent les pigments. Le tableau peint présente des points communs avec la composition du tableau sonore de Buxtehude dont la page-titre porte la mention suivante : Membra Jesu nostri patientis sanctissima humissima totius cordis devotione decantata (Les très saints membres de notre Seigneur Jésus souffrant, chantés avec la plus humble dévotion de son cœur tout entier). Comme inspiré par Luther, un verset de la Bible ouvre chacune des cantates ; les couleurs musicales des différents mouvements reflètent l’émotion du compositeur en communion avec le Christ; la tonalité d’ensemble témoigne d’une intense dévotion envers le supplicié divin.
Sur les quelques cent trente cinq opus de musique vocale aujourd’hui connues de Buxtehude, Ton Koopman a retenu douze pièces qui, selon lui, pourraient caractériser le style du « Maître de Lübeck ». Pour cinq d’entre elles, le livret est en allemand ; pour les sept autres, il est en latin. Mais si les langues diffèrent, c’est un même génie musical qui les embrasse. Et bien qu’elles aient été enregistrées il y a trente ans, elles conservent toute leur fraîcheur ainsi qu’un pouvoir de séduction intact.
Nous nous intéressons principalement à l’œuvre que, dans son propos d’accueil, le 7 mars dernier, Monseigneur Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris a intitulé « la Passion selon Buxtehude ». En 1680, lorsque la composition des sept cantates du Membra Jesu nostri est finalisée, la Passion est un genre musical en pleine mutation. Johann Walther (1496-1570), ami de Luther et surnommé « le premier cantor luthérien », avait introduit le genre de la Passion-répons : une polyphonie à quatre voix portée par la turba (chœur de foule) tandis que des solistes psalmodient les paroles de l’Evangéliste. Avec la Passion selon saint Mathieu (1672) de Johann Sebastiani (1622-1683), le genre est en pleine évolution. Un grand nombre d’arias sont glissées dans la composition afin d’emporter la dévotion des fidèles. Le Membra Jesu nostri de Buxtehude se situe à mi-chemin. Il abandonne délibérément la forme des Passions-répons mais n’a pas encore adopté la forme en Oratorio à laquelle Reinhard Keiser (1674-1739), Johann Sebastian Bach (1685-1750) ou Georg Philipp Telemann (1681-1767) donneront ses lettres de noblesse. Buxtehude compose ce que nous nommerions aujourd’hui une « cantate concertante avec arias ».
Nous ignorons tout de l’événement précis pour lequel Buxtehude réservait la première exécution de sa composition. Plusieurs hypothèses sont en débat. Pour les uns, les sept cantates correspondent aux sept jours qui séparent Pâques des Rameaux. Elles pouvaient donc avoir été interprétées successivement, à raison d’une pour chaque jour. Notons toutefois que les offices de la Semaine Sainte franchissent les différentes étapes du chemin de croix alors que les sept cantates se focalisent sur le Christ en croix. C’est pourquoi, d’autres suggèrent qu’elles aient pu être exécutées au cours d’un long office, par exemple celui du Vendredi Saint, en alternance avec des séquences liturgiques. Cette option aurait comme point de référence la version initiale de la composition de Joseph Haydn (1732-1809) sur les Sept dernières paroles du Christ en croix (1785). Au demeurant, les Passions de Bach ne seront-elles pas, elles aussi, entendues lors des vêpres du Vendredi saint ? Mais alors, pourquoi sept cantates alors que la tradition ne vénère que cinq plaies ? Gilles Cantagrel analyse, dans des pages passionnantes, la symbolique numérique à laquelle se réfère Buxtehude et l’importance du chiffre « sept » dans cette représentation (Dietrich Buxtehude-Fayard-2006). Retenons simplement que le chiffre sept est celui de la création du monde racontée dans Le livre de la Genèse et que le sacrifice du Christ renvoie précisément à la perfection de cette création en effaçant l’épisode du péché commis par nos premiers parents.
En revanche, nous savons, par le manuscrit autographe conservé à l’université d’Uppsala, qu’il a dédié sa composition à son ami Gustav Düben (1628-1690), maître de chapelle de l’orchestre royal de Suède depuis 1663. Ce collectionneur de partitions est le sauveur de bien des compositions de Buxtehude, comme de bien d’autres compositeurs. Sans son engouement, elles seraient probablement perdues comme l’essentiel des partitions interprétées lors des Abendmusiken (veillées musicales durant le temps de l’Avent) de Lübeck. D’ailleurs, sa collection est considérée aujourd’hui comme l’une des sources les plus riches de la musique de la fin du XVIIème siècle.
Pour cette composition destinée au temps de la Passion, Buxtehude rédige probablement lui-même le livret. Il puise dans la Rhythmica Oratio d’Arnulphe de Louvain (vers 1200-vers 1250) le texte de ses arias. Ce poème médiéval connaît alors un succès d’édition. Il ne sera d’ailleurs pas le seul à exploiter cette longue méditation en vers latins sur les plaies du Christ en croix. Avant lui, Paul Gerhardt (1607-1676) avait trouvé dans le dernier poème de ce même recueil le texte de son célèbre choral O Haupt voll Blut und Wunden que Bach intégrera dans sa Passion selon St Mathieu (BWV 244). De même, cette célébration de parties d’un corps s’inscrit dans la grande tradition des blasons, ces pièces en vers à la mode au XVIème siècle dans lesquels un poète se concentre sur un détail anatomique, en l’occurrence le corps féminin, pour en faire un éloge souvent non dénué d’arrière-pensée érotique. Bien entendu, cette poésie amoureuse profane est ici transposée dans le domaine religieux et prend le corps du Christ pour sujet de vénération. Buxtehude suit l’ordre dans lequel Arnulphe de Louvain énumère les sept plaies marquant le corps du supplicié : les pieds, les genoux, les mains, le côté, la poitrine, le cœur et le visage. Cet ordre est celui qui correspond au mouvement naturel du fidèle agenouillé devant un crucifix. Son regard s’élève par étapes des pieds jusqu’au visage, dans une trajectoire ascensionnelle de la terre vers les cieux. Pour chaque blessure, Buxtehude sélectionne trois demi-strophes dans le poème médiéval et les coiffe d’un verset de l’Ancien Testament se rapportant à la partie du corps vénérée.
D’un point de vue musical, chacune des cantates est construite selon un schéma similaire donnant au cycle son unité d’ensemble: une sonata instrumentale en ouverture, un concerto à trois ou cinq voix avec accompagnement instrumental pour proclamer le verset biblique, trois arias réveillant les trois demi-strophes choisies, en général, dans la Rhythmica Oratio, des ritournelles instrumentales assurant une forme de transition entre chaque aria, une reprise du concerto vocal pour conclure la pièce. Nous reviendrons sur les quelques variations dérogeant à cette structure. Pour l’exécution de ces pièces, Buxtehude prescrit la nomenclature instrumentale souhaitée : deux violons, un violone et l’orgue assurant le continuo. La cantate Ad Cor fait cependant exception, les deux violons étant remplacés par quatre violes de gambe. L’effectif vocal est également indiqué : deux soprani, un alto, un ténor et une basse. Mais là encore, deux cantates se singularisent : Ad pectus retire les deux soprani et Ad Cor réintroduit les soprani mais éloigne l’alto et le ténor. Toutefois, les interprètes d’aujourd’hui prennent parfois quelques libertés avec la nomenclature indiquée. Sigiswald Kuijken dirigeant La Petite Bande se conforme plutôt aux prescriptions du compositeur (Accent – 2012). En revanche, en 1997, Diego Fasolis renforce l’effectif vocal (Choir of Radio Svizzera, Lugano) et révise l’instrumentation (Accademia Instrumentale Italiana et Sonatori de la Gioiosa Marca) dans le CD distribué par Naxos. Ton Koopman suivra sa trace, comme le fera Henri Chalet lors du concert donné à Notre-Dame de Paris. Ce 7 mars, les pupitres vocaux sont occupés par huit soprani, sept altos, sept ténors et quatre basses alors qu’un clavecin et une dulciane renforcent l’orgue pour le continuo. Finalement, les versions de Koopman et de Chalet se rejoignent pour séduire par leur sonorité ample et généreuse.
Une sonata ouvre la célébration des pieds meurtris (Ad pedes) par la plainte des violons apitoyés à la vue des blessures. Mais la déploration cède aussitôt la place à un air rasséréné préfigurant la délivrance annoncée. Ces premières mesures indiquent d’ores et déjà le message qui sera porté tout au long des sept cantates : on ne vénère pas les souffrances du Christ proprement dites mais on salue leur finalité, celle de laver l’humanité du péché des origines. Un concerto vocal développe ensuite le verset 2,1 du Livre de Nahum. Trois mots y sont soulignés en notes longues et sur une tonalité grave : Ecce (voici) et pedes evangelizantis (les pieds du messager), une manière subtile de désigner, à l’attention des fidèles, cette partie meurtrie du corps du Sauveur. Et là encore, la ligne mélodique s’éclaire soudain pour déclarer, dans une polyphonie empreinte de solennité, que ce messager annunciantis pacem (annonce la paix). La première aria déroge au schéma général : un soliste entonne la strophe par un Salve (Je te salue) rayonnant puis s’efface devant le chœur qui se réjouit de partager le sort du Sauveur. Loin d’adhérer au courant doloriste qui accompagne alors la Contre-Réforme catholique, Buxtehude semble pencher davantage en faveur du mouvement piétiste lancé vers 1675 par le pasteur luthérien Philipp Jacob Spener (1635-1705) : la prière plutôt que la mortification. Cette même strophe est ensuite reprise par une soprano, suivie par la seconde soprano pour la strophe suivante avant que la voix de basse ne développe la dernière. Dans cette distribution, le compositeur mobilise les registres vocaux extrêmes, alliant les voix de l’amour à celle de la sagesse. Le concerto vocal de départ conclut cette première cantate. Comparée à celle de Koopman, la version de Chalet se distingue par deux variantes : la première strophe est confiée à une voix d’alto (au lieu du chœur) tandis que la cantate s’achève par la reprise de la première strophe, confiée cette fois au chœur.
C’est sur une tonalité majeure que la seconde cantate vénère les genoux blessés (Ad genua). Marc-Antoine Charpentier (1636-1704) attribue à cette tonalité un affect « cruel et dur » (Règles de composition - 1690) alors que Johann Mattheson (1681-1764) signale que Bach n’a guère utilisé cette tonalité « très pathétique, jamais grave, ou plaintif ou exubérant » (Neu-eröffnete Orchestre - 1713). Dans son manuscrit, Buxtehude enjoint de jouer in tremolo (en tremblant) toute la sonate d’introduction. « C’est la figure de rhétorique musicale alors codifiée comme timor et tremor, la crainte et le tremblement. Devant la mort, et devant Dieu, maître de la vie et de la mort » signale Gilles Cantagrel. Le halètement des violons portés par le continuo était particulièrement saisissant sous la direction de Chalet, les violone ajoutant une gravité et une profondeur plus faiblement rendue dans la version de Koopman. La sonata s’éteint, presque apaisée, pour laisser place au concerto illustrant, sur un verset d’Isaïe (66, 12), la douceur prodiguée au nourrisson assis sur les genoux de sa mère. Commencé a cappella, il sautille dans une fugue souriante avant de s’assoupir dans un caressant blandicentur vobis. Emergeant d’une écriture d’une grande simplicité, quelques rares vocalises soulignent les mots qui représentent les craintes du croyant : la foi vacillante (caducis) à l’image des genoux fragiles et la double mort (duplo), physique et spirituelle. Mais la troisième strophe chantée en duo insuffle une note d’espoir, celle d’être purifié après avoir embrassé (complexus) le Sauveur. En somme, la souffrance du Christ est le signe d’une délivrance. Sur le plan musical, Buxtehude donne donc en partie raison à Mattheson, même si la tonalité d’ensemble n’a rien de véritablement pathétique. Mais il s’oppose à la dureté suggérée par Charpentier. Faut-il y voir un indicateur des chemins différents choisis par les musiciens germaniques et français en termes d’expression des affects par le moyen de la musique ?
Avec la cantate suivante, nous revenons à la tonalité mineure que nous ne quitterons plus jusqu’à la dernière pièce. Dans cette contemplation des plaies des mains (Ad manus), la sonata est plaintive, éplorée, interrogative comme le texte du verset de Zacharie (13, 6) que le concerto va développer. Les soprani s’interrogent mutuellement : Qui sunt plagae (Que sont ces plaies ?). Le chœur relaye leur interrogation avant que la basse et le ténor ne renouvellent la question. Ce concerto est construit en forme d’interrogation, plaçant le fidèle devant le mystère du sacrifice divin. Des trois strophes qui suivent se dégage une atmosphère doloriste qui pourrait parfaitement correspondre aux nombreuses scènes de crucifixion exposées alors dans les églises. Les répétitions et les vocalises accentuent la frayeur provoquée par la torture physique de la crucifixion, notamment les saintes mains écartelées (expansis sanctis manibus). Ces souffrances suscitent l’émotion du croyant, là encore soulignée par les vocalises sur les mots gemendo (gémir) et lacrimas (pleurs). Un émouvant trio raconte comment le fidèle est lavé par le sang du Christ, illustration musicale du retable de Weimar évoqué au début de notre chronique. Si, dans les deux versions, voix et instruments cisèlent les nuances, la gravité des violone lors des parties de soliste ajoute au continuo une gravité supplémentaire lors du concert donné à Notre-Dame. C’est sans doute dans cette partie que le luthérianisme de Buxtehude s’exprime le plus nettement. Martin Luther n’avait-il pas inscrit dans son Sermon sur la contemplation de la Sainte Passion du Christ (1519) que « ceux-ci méditent bien la Passion du Christ qui, en le contemplant, sont pris d’effroi au plus profond de leur cœur » ?
Les trois cantates suivantes se recueillent devant les plaies infligées sur le torse du Christ : le côté, la poitrine et le cœur. Dans les textes de l’époque, ces différentes parties sont souvent confondues. Ainsi, le Père Jean-Baptiste Saint-Jure (1588-1657) considère que « des plaies de Notre Seigneur, celle du côté est sans controverse la principale, non pour avoir été la plus douloureuse, parce qu’il l’a reçue après sa mort, mais pour avoir été la plus amoureuse, lui ayant été faite au cœur, où réside l’amour, et pour les grands mystères qu’elle contient » (Le livre de élus. Jésus en croix - 1643). Si Buxtehude distingue chacune d’elles, c’est probablement pour mieux exprimer une forme de gradation dans la souffrance endurée par le supplicié. Au demeurant, l’effectif vocal et instrumental sera exceptionnellement modifié pour chacune des pièces.
La plaie au flanc (Ad latus) est marquée par le ton grave de la sonata introductive. Elle est suivie par le concerto habituel reprenant cette fois un verset du Cantique des Cantiques (2, 10). Mais la forme musicale se distingue en se rapprochant de la forme grégorienne du repons qui fait alterner le chant d’un soliste avec celui du chœur. Dans les strophes suivantes, la méditation est guidée, pour cette partie seulement, par un texte de Bernard de Clairvaux (1090 ?-1153) dont Luther dira : « seul Bernard a saisi le Christ ». Plus guère de vocalises, à peine quelques modestes ornements : la forme est sobre et l’atmosphère vouée au recueillement. L’imploration se poursuit par l’examen des plaies à la poitrine (Ad pectus). Les tremolos agitent, une fois encore, la sonata d’ouverture. Pour la partie vocale, Buxtehude choisit de retenir les seuls pupitres qui, selon la tradition musicale de l’époque, caractérisent l’âme meurtrie (l’alto), l’homme souffrant de ses peines (le ténor) et la vox Christi (la basse). Sur ce point particulier, nous renvoyons à une longue communication de Gilles Cantagrel (Symbolique et rhétorique chez Jean-Sébastien Bach – 2008) devant l’Académie des Beaux-Arts. Le concerto est interprété à effectif vocal réduit, accompagné du continuo. Il chante le seul texte du cycle qui soit inspiré du Nouveau Testament (Deuxième épître de Pierre - 1, 2), mais dans une adaptation allemande en usage à l’époque de Buxtehude. Le compositeur y laisse libre cours à sa science du contrepoint. L’alto, le ténor puis la basse se succèdent pour interpréter les trois strophes suivantes. Les fins de strophes sont soulignées par des répétitions et quelques rares vocalises comme pour mieux signaler aux fidèles l’endroit du texte dans lequel se nichent les messages d’espoir. Dans la version Chalet, la reprise du concerto souligne davantage le climat de douleur car le chant des solistes est sèchement ponctué par un continuo dans lequel le violone ajoute sa couleur sombre. La célébration du cœur sanglant (Ad cor) achève cette triade tragique. Sa tonalité en mi mineur l’inscrit dans le registre affectif du « trouble et tristesse, mais de telle manière qu’on espère la consolation » (Mattheson). La sonata mêle la plainte à l’espoir, faisant alterner les sonorités lourdes du continuo avec les élans contenus des cordes. Buxtehude veut manifestement attribuer une place particulière à cette séquence car il modifie à la fois l’effectif vocal (réduit aux pupitres extrêmes, les soprani et la basse) et instrumental (quatre violes de gambe remplacent les violons). Cette mutation était cependant moins perceptible à Notre-Dame que dans la version Koopman. Le concerto pleure longuement sur le mot vulnerasti (tu as blessé… mon cœur). Même le texte du Cantique des Cantiques (4,9) s’abandonne à la plainte que le scintillement du clavecin, à Notre-Dame, rendait émouvante. Cette cantate, que Düben a nommée De Passione nostri Jesu Christi, constitue, en quelque sorte, le point culminant de la souffrance du Christ que Buxtehude veut faire partager aux fidèles.
La cantate concluant le cycle voit renaître l’espérance en même temps que les effectifs vocaux et instrumentaux se reconstituent. Le fidèle, quant à lui, achève le mouvement de bas en haut et regarde maintenant le visage (Ad faciem) du Christ en croix. Le Christ est mort. C’est maintenant à sa propre mort qu’il doit se préparer. Pour les strophes, un texte du prémontré Hermann Joseph von Steinfeld (1150 ?-1242 ?) fera office de fil conducteur. La sonata est plus enjouée. A l’appui du Psaume 30/31 (verset 17), le concerto demande, dans une fugue dynamique, à bénéficier de la miséricorde divine. Même le chant des strophes laisse davantage de place à l’expression collective : la première est chantée par un trio, la seconde est confiée à l’alto et la dernière est portée par le chœur qui, après avoir salué avec ferveur la cruce salutifera (la croix qui dispense le salut), se dirige vers un vibrant Amen qui ondule, comme enchaîné aux violons qui ont retrouvé leur fougue.
Ton Koopman et Henri Chalet nous font un véritable cadeau en proposant, l’un et l’autre, une interprétation envoûtante de ce cycle de cantates. Si le premier mobilise des solistes-vedettes, le second choisit ses solistes dans les rangs du chœur. Si les premiers brillent par leur expérience, les seconds nous ont totalement convaincus par leur fraîcheur, leur engagement au service de cette partition et leur capacité à se jouer des réverbérations d’un lieu exceptionnel par le volume. Dans les deux cas, la qualité des instrumentistes est à saluer. Si l’interprétation (ancienne) de Ton Koopman n’a pas pris une ride, la relecture de la nomenclature vocale et instrumentale par Henri Chalet mérite, selon nous, de figurer absolument dans la discographie.
En maître généreux, Ton Koopman nous réserve un bonus sous la forme de cinq cantates gravées sur un second CD intégré au coffret. Il s’agit de pièces isolées dont le livret est, cette fois, en langue allemande. Toutefois, l’absence du texte des œuvres interprétées semble indiquer que le CD vise davantage le plaisir des oreilles que la culture de l’esprit. Dommage, car ces deux finalités constituent pourtant un couple bien assorti.
Notre oreille découvre un échantillonnage des différents types de cantates composées par Buxtehude. Encore que le terme de « cantate » soit quelque peu usurpé. Au demeurant, il est rarement utilisé du temps de Buxtehude. En effet, ce genre ne prendra vraiment forme que dans les premières décennies du XVIIIème siècle. La rigueur sémantique nous conduirait à désigner les compostions de Buxtehude comme des « concerts avec arias ». Mais Gilles Cantagrel invite à l’indulgence et propose de « commencer à user du terme de cantate, dans la mesure où ces œuvres se présentent comme des mosaïques de divers morceaux, agencés selon le plan de la prédication spirituelle ».
Trois catégories de cantates ont été retenues par Koopman. La première relève de la fonction habituelle du compositeur : composer des pièces fonctionnelles pour les offices ordinaires. Ainsi, la cantate BuxWV 77 - Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes (Rien ne doit nous séparer de l’amour de Dieu) mobilise un effectif réduit : trois chanteurs et trois instrumentistes. Une courte sonata introductive annonce trois arias. Dans la première, la soprano et l’alto énoncent le thème. Le compositeur montre ici son savoir-faire de pédagogue en employant deux techniques : la répétition insistante de Nichts suivie d’un silence afin de marteler le message, la vocalise sensuelle sur le mot Liebe. Dans la seconde, la soprano puis l’alto commentent l’Epitre de Paul aux Romains. Leur enseignement est ponctué par des ritournelles lancées par les violons et la reprise obsédante du thème initial. La pièce se conclut par le concert initial, comme pour achever la leçon de catéchisme par le rappel des fondamentaux. Cette forme évoque la rhétorique de la prédication, avec ses répétitions pour faciliter la mémorisation.
Deux autres cantates peuvent s’inscrire dans cette même catégorie. Ich habe Lust abzuscheiden (Je désire m’en aller) BuxWV 39 mobilise globalement le même effectif et exploite, comme la précédente, les ressources de l’arsenal de la rhétorique musicale. Si elle vise également l’édification des fidèles, elle projette maintenant l’assemblée dans la perspective de la mort. Le violon domine le continuo. Il accompagne, en forme de complainte, le trouble exprimé par les solistes. L’écriture de l’ensemble est sobre et l’atmosphère qui s’en dégage plutôt sombre, éclairé ici ou là par quelques lueurs d’espoir. Dans la seconde, Herr, wenn ich nur dich habe (Seigneur, si je n’avais que toi) BuxWV 39, la soprano seule s’engage dans une longue méditation sur la vie après la mort. La perspective est cependant plus optimiste : le continuo s’anime progressivement, la mélodie prend des allures plus légères, le violon s’enhardit jusqu’à « l’Amen de conclusion (qui) pousse à son plus haut point l’exubérance jubilatoire virtuose de la partie chantée » analyse Gilles Cantagrel.
La cantate Nun danket Gott (Maintenant, rendez tous grâces à Dieu) BuxWV 79 relève, nous semble-t-il, d’une seconde catégorie, celles des concerts spirituels. L’effectif vocal et instrumental est renforcé. Le Knabenchor (chœur d’enfants) de Hanovre d’une part, l’intervention de cornets à bouquins, de trombones, de trompettes et de timbales d’autre part, donnent une allure majestueuse à cette pièce. L’influence italienne nous paraît imprégner l’ensemble de la composition, les cuivres et le recours à la polychoralité lui donnant même des couleurs vénitiennes. Nul doute que cette instrumentation et le caractère martial de certains de ses passages aient contribués au destin de ce choral qui deviendra, « au XVIIIème siècle…, le Te Deum allemand » (Gilles Cantagrel – Les cantates de Bach – Fayard – 2010). Et c’est avec bien des Te Deum que cette cantate pourrait rivaliser.
Nous inscrivons la cantate Ihr lieben Christen, freut euch nun (A présent, réjouissez-vous, mes chers chrétiens) BuxWV 51 dans la troisième catégorie, celle des vestiges probables des programmes perdus des Abendmusiken. Pour Gilles Cantagrel, cette pièce « combine en une subtile marqueterie les genres du concert, de l’aria et du choral ». L’effectif vocal et instrumental est important, comme dans la cantate précédente. A la suite d’une sinfonia d’ouverture réjouissante, le Knabenchor interprète le choral dans un envoûtant cantus firmus. La suite prend un caractère festif dans lequel se mêlent des chœurs resplendissants, des fugues fugitives, des ritournelles orchestrales et des récitatifs entraînants. Cette pièce, plus que les précédentes, mérite vraiment son titre de cantate et préfigure celles que composera Bach.
En fin de compte, les sept cantates du Membra Jesu nostri offrent une belle unité d’ensemble. Mais les cinq cantates gravées sur le second CD offrent un avant-goût de la variété des compositions qui ont pu animer la vie spirituelle de la communauté paroissiale de la Marienkirche de Lübeck dans le dernier quart du XVIIème siècle
Publié le 26 mars 2017 par Michel Boesch
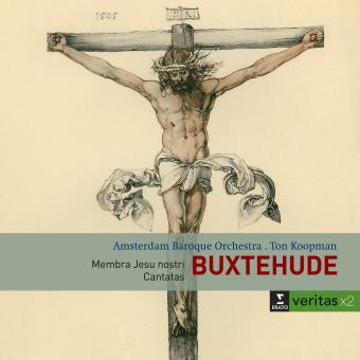 ©
©