The Paris album - Ensemble Diderot
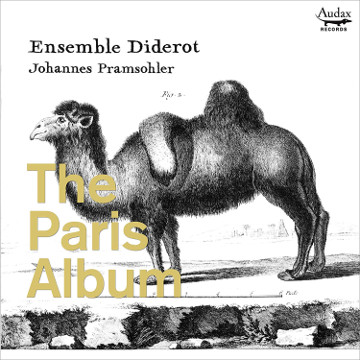 ©Audax Records
©Audax Records Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec notice quadrilingue (anglais-français-allemand-japonais), un CD, durée totale : 64 minutes. Audax Recors - 2019
Compositeurs
- The Paris album - The trio sonata in France before 1700
- Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729) : Sonate en trio en sol mineur
- Sébastien de Brossard (1655-1730) : Sonate en trio en la mineur « Detta La Primogenita »
- André Campra (1660-1744) : Sonate en trio n°1 en si bémol majeur
- François Couperin (1668-1733) : La Convalescente
- Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) : Sonate en trio en sol majeur, « La Félicité »
- André Campra : Sonate en trio n°2 en la majeur
- Sébastien de Brossard : Sonate en trio en ré majeur
- Jean-Féry Rebel (1666-1747) : Tombeau de Monsieur de Lully
Chanteurs/Interprètes
- Ensemble Diderot :
- Johannes Pramsohler, violon baroque, Pietro Giacomo Rogeri, Brescia 1713
- Roldan Bernábé, violon baroque, Roger Graham Hargrave, Bremen 1992 (d’après Gioffredo Cappa)
- Eric Tinkerhess, viole de gambe, Ambroise de Comble, Tournay 1750 (prêt de la Fondation Orpheon)
- Philippe Grisvard, clavecin, Matthias Griewisch, Bammental 2001 (d’après Aelpidio Gregori, c. 1700)
Pistes
Les sonates du ParnasseIl est des enregistrements qui font l’effet d’un coup de tonnerre. Celui-ci en fait partie. Après divers albums très remarqués consacrés à Londres, Dresde ou encore aux magnifiques concert de Montanari ( lire notre chronique), l’excellent Ensemble Diderot poursuit son voyage musical en explorant cette fois-ci le domaine passionnant de la sonate en trio en France à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Émergeant alors sous l’influence ultramontaine, sa forme encore mal stabilisée échappe à tout stéréotype, en particulier ceux de la sonata da chiesa ou da camera italiennes, donnant naissance à des pages souvent expérimentales, au sein d’un laboratoire de composition où les meilleurs plumes se distinguent, fusionnant des éléments relevant des styles italien et français (des traces de la suite de danse subsistent notamment) dans une sorte de synthèse pleine de caractère. Dans ce cadre règne une extrême liberté formelle, certaines œuvres étant marquées par une grande concision (moins de cinq minutes) quand d’autres atteignent le quart d’heure. En outre, certaines restent définies par leur tonalité principale tandis que d’autres se voient qualifiées de titres relatifs à leur ordre d’apparition dans la production du compositeur (Brossard) ou relèvent du portrait psychologique (Clérambault et Couperin) ou encore font référence à un illustre personnage auquel il s’agit de rendre hommage (Rebel). Fort intelligemment construit, le programme contient trois sommets (Jacquet de la Guerre, Couperin et Rebel) entre lesquels s’intercalent des pièces moins ambitieuses, leur écriture comme leur structuration étant moins élaborées.
C’est de manière assez péremptoire que débute cet album qui pourrait nous transporter aisément dans le cénacle d’un Sébastien de Brossard réunissant le temps d’une après-dînée quelques musiciens pour y jouer des sonates issues de sa collection. Je ne crois pas avoir déjà entendu la personnalité si attachante d’Élisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729) s’exprimer avec autant d’autorité. Sa Sonate en sol mineur nous lance dans une folle aventure en sept mouvements faisant preuve d’une virtuosité d’écriture stupéfiante. Le ton est donné avec le Grave initial s’enchaînant à deux mouvements rapides dont le second aux triolets qui passent à toutes les parties vous emporte dans un tourbillon proprement délicieux. Un récit de basse de viole très animé permet d’apprécier la dextérité d’Eric Tinkerhess, relançant le discours d’un trait plein d’allant. La courte et gracieuse Aria débouche sur un final assez endiablé venant conclure ce premier acte de haut vol.
Les sonates de Sébastien de Brossard (1655-1730), malgré l’érudition du compositeur ne font pas étalage de science, ce qui n’ôte rien à leur qualité. Celle en la mineur donne au début l’impression d’un concerto italien mais dont le premier mouvement guère développé s’enchaîne sur une autre section plus lente s’animant à nouveau pour retomber le temps de quelques mesures dans la gravité. Puis une sorte de gigue surgit avant de laisser place à un moment de grâce où les cordes jouent sans basse continue. Entrecoupée de soupirs, la fin vient apporter un apaisement émouvant. A contrario, celle en ut majeur débute en fanfare, tel un bruit de guerre avant de laisser s’exprimer les dessus conjointement et s’aventurer dans le mode mineur avec vigueur. La fin retrouve l’esprit du début, le triomphe étant célébré sans s’attarder. Enfin, celle en ré majeur est sans doute celle qui s’avère la plus française. Hormis son Allegro initial solaire, ses autres mouvements renvoient à l’univers de la danse. Le rondeau cache un Menuet en ré mineur auquel succède un rigaudon alerte retrouvant le mode majeur avant d’avoir son pendant en mineur. La Sarabande, habilement écrite, fait entrer successivement ses trois parties avant de céder la place à une gigue véloce.
À l’instar de celles du musicien de Bossuet, les sonates d’André Campra (1660-1744) ont été exhumées à Lund en Suède et constituent une réelle découverte dont on sait gré à Johannes Pramsohler. Outre son immense talent de violoniste, celui-ci est un chercheur à la main heureuse. Maurice Barthélemy, biographe de Campra n’en avait manifestement pas connaissance, ne citant guère leur existence dans son ouvrage consacré au grand aixois. Bien plus connu pour ses œuvres scéniques et ses grands ou petits motets, ce compositeur trop peu servi à mon goût par l’enregistrement livre ici deux sonates colorées d’un indéniable charme mélodique faisant sa marque de fabrique. Bien que peu développées et dépourvues d’effets spectaculaires, celles-ci touchent le cœur. Celle en si bémol s’ouvre sur un mouvement lent très gracieux avant de s’animer pour s’étirer lors d’un dialogue amoureux entre les deux violons et conclure sur une sorte de cavalcade. Celle en la majeur s’avère d’une facture similaire, enchaînant différentes pages peu développées mais soignées dans leur écriture.
Un peu plus ambitieuse, La Félicité, sonate de Clérambault, porte bien son nom. Baignant dans une douce lumière de sol majeur, celle-ci constitue un exemple accompli des goûts réunis. Mais on se méprendrait en voyant dans sa structure tripartite inaugurale une ouverture à la française, le Lentement étant très étiré et délicieusement paresseux avec son léger chromatisme (fa dièse puis fa bécarre). Le mouvement qui lui succède s’établit sur un contrepoint serré aux traits acérés des violons mais aussi de la basse qui emprunte les mêmes figurations avant de céder à la douceur du début. Un mouvement rapide aux nombreux sauts de sixte s’avère assez drôle d’esprit avant qu’une gavotte qui ne dit pas son nom permette aux dessus de dialoguer comme des personnages, ne se trouvant réunis que sur les toutes dernières mesures. Le final juxtapose une section rapide avec un curieux sujet déhanché et un motif en doubles croches provoquant un effet d’accélération irrésistible avant de conclure sur quatre mesures on ne peut plus françaises d’esprit.
Sorte de négatif de l’Apothéose de Lully (où règne la plupart du temps un sol majeur serein), le Tombeau que Rebel consacre à celui qui fut son maître est une page sombre, oscillant entre mélancolie et fureur, sans doute deux traits de caractère du fougueux florentin. Le ton d’ut mineur confère à cette sonate d’une ampleur inaccoutumée une grandeur digne de son sujet. La déploration ouvre et referme cet hommage avec des enchaînements harmoniques saisissants, dont Jean-Féry se souviendra lors de l’écriture de son chaos des Éléments. Par exemple, la mesure 16 se termine en sol mineur. Après un soupir déchirant, le propos repart en fa mineur (mesure 17). Le mouvement rapide qui suit est particulièrement habile, avec des tensions marquées par des retards et des chromatismes tantôt descendants, tantôt ascendants, sans compter les puissantes dissonances sur des pédales d’ut, ré et sol, sorte de glas. Le Lentement suivant permet à la viole de chanter sa plainte, entrecoupée de motifs en gammes des violons qui tentent de s’élever pour retomber désespérés et sanglotant. Le 3/2 évoque un sommeil d’opéra, venant apporter quelque apaisement. Mais celui-ci ne dure guère, une agitation infernale convoque à la suite songes funestes (motifs martelés en croches puis agités de doubles croches) et furies (des triples croches à toutes les parties, sauf pour la basse continue) peignent un tableau cauchemardesque inoubliable, les deux violons jouant en doubles cordes sur une pédale de dominante (sol) avant que Les Regrets entendus au début de l’œuvre ne viennent laisser régner un silence éternel. Véritable chef d’œuvre, ce Tombeau a déjà fait l’objet de nombreux enregistrements parmi lesquels se distinguent celui de l’Assemblée des honnêtes curieux avec Amandine Beyer (option chambriste) ou celui de Marc Minkowski (option orchestrale). Plus économe de moyens, celle de l’Ensemble Diderot parvient néanmoins à gagner les cimes tant l’engagement des musiciens comme leur maîtrise laisse pantois.
Mais peut-être encore plus absolue est la réussite de La convalescente de Couperin. Si ce caractère n’est guère perceptible (l’ensemble Les Dominos lui conférant davantage de douceur), on n’en tiendra nullement rigueur à nos musiciens. En effet, attribuant ultérieurement un titre identique à l’une de ses pièces de clavecin dans son IVe livre (une splendide Allemande en fa dièse mineur), Couperin avait déjà pour la parution de ses Nations en 1726 rebaptisé cette sonate L’Impériale. Force est de constater que c’est ce tempérament altier qui lui sied le mieux. D’emblée, le ton est plein de vigueur. Johannes Pramsohler et Roldan Bernábé (dont je vantais il y a peu la qualité du duo qu’ils forment, lire mon récent compte-rendu) font chanter leurs violons avec une chaleur peu commune, tandis que la basse constitue de l’excellent Philippe Grisvard et Eric Tinkerhess constitue un moteur sans faille, conférant à cette sonate un sens dramatique rarement atteint avec autant d’évidence. Si le Gracieusement en fa majeur, que Bach connaissait et transcrivit pour orgue, apporte un bref moment de détente, le Vivement final avec son ambitieux sujet génère une fugue flamboyante où l’ardeur de nos musiciens fait merveille. Jamais on n’aura entendu un Couperin aussi viril et puissant. L’ardeur galvanisante du tempo adopté, la précision diabolique de la mise en place, la lumière qui émane de l’ensemble plonge l’auditeur dans une euphorie telle, qu’à peine parvenu à l’accord final, celui-ci, émerveillé, ne peut que s’exclamer : encore !
Publié le 23 sept. 2019 par Stefan Wandriesse
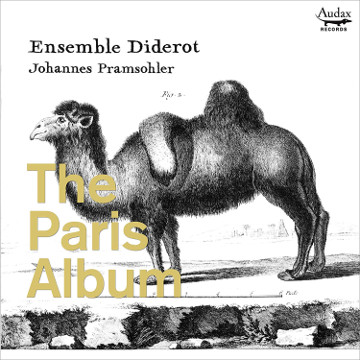 ©Audax Records
©Audax Records