Tyrannic Love - Les Surprises
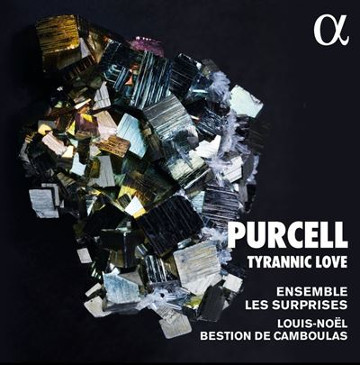 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret bilingue (anglais-français) et notices trilingues (français, anglais, allemand), un CD, durée totale : 60 minutes, 45 secondes. Alpha Classics - 2021
Compositeurs
- Tyrannic Love
- Henry Purcell (1659-1695) : extraits de King Arthur, The Prophetess or History of Dioclesian, The fairy Queen, The Indian Queen, The virtuous wife, The Yorkshire Feast Song, Anacreon’s defeat, Tyrannic Love or The royal martyr
- John Eccles (1668-1735) : extraits de The comical history of Don Quixote
- John Blow (1649-1708) : extraits de Loving above himself - Saraband for the Graces
- Jeremiah Clarke (vers 1664-1707) : extrait de Song on the Assumption
- Daniel Purcell (vers 1664-1717) : extrait de Pausanias, the betrayer of his country
Chanteurs/Interprètes
- Eugénie Lefebvre, soprano
- Etienne Bazola, baryton
- Ensemble Les Surprises :
- Violons : Gabriel Grosbard, Gabriel Ferry
- Viole : Lika Laloum
- Hautbois et flûte : Laura Duthuillé, Xavier Miquel
- Basson, flûte, taille de hautbois : Lucile Tessier
- Viole de gambe : Juliette Guignard
- Théorbe et guitare : Etienne Galletier
- Percussion (1 et 4) : Etienne Bazola
- Tambour (15) : Guy-Loup Boisneau
- Clavecin, orgue et direction : Louis-Noël Bestion de Camboulas
Pistes
- 1.Henry Purcell : Hornpipe (King Arthur)
- 2.John Eccles : I burn, my brain consumes to ashes (The comical history of Don Quixote)
- 3.John Blow : Poor Celadon, he sighs in vain (Loving above himself)
- 4.Henry Purcell : Dance of the Furies (The Prophetess, or History of Dioclesian)
- 5.Henry Purcell : There’s not a swain on the plain (Rule a wife and have a wife)
- 6.Henry Purcell : Hornpipe (The fairy Queen)
- 7.Henry Purcell : Dance for the Fairies (The fairy Queen)
- 8.Henry Purcell : Dance for the Green Man (The fairy Queen)
- 9.Henry Purcell : Ye twice hundred deities (The Indian Queen)
- 10.Henry Purcell : Symphony (The Indian Queen)
- 11.Henry Purcell : Seek not to know (The Indian Queen)
- 12.John Blow : Saraband for the Graces
- 13.Henry Purcell : There’s nothing so fatal as women (A fool’s preferment or The three Dukes of Dunstable)
- 14.Henry Purcell : Overture (The virtuous wife)
- 15.John Eccles : Sleep, poor Youth (The Dirge) - (The comical history of Don Quixote)
- 16.Henry Purcell : Slow air (The virtuous wife)
- 17.Henry Purcell : Air (The virtuous wife)
- 18.Henry Purcell : So when the glitt’ring Queen of Night (The Yorkshire Feast Song)
- 19.Henry Purcell : This poet sings the Trojan wars (Anacreon’s defeat)
- 20.Jeremiah Clarke : Ground in D minor (Song on the Assumption)
- 21.Daniel Purcell : My dearest, my fairest (Pausanias, the betrayer of his country)
- 22.Henry Purcell : Hark, my Damilcar (Tyrannic Love or The royal martyr)
- 23.Henry Purcell : Chaconne (King Arthur)
L’Amour dans tous ses étatsAfin d’entrer en résonance avec un fragment du passé, nous choisissons pour guides le plaisir esthétique et la pertinence historique. Au-delà des mots, davantage encore que les images, l’imagier sonore est un miroir dans lequel se réfléchit l’univers des émotions et des passions. Ici, le rideau va s’ouvrir sur une représentation des états amoureux au tournant du XVIIIème siècle britannique.
Le florilège confectionné par Louis-Noël Bestion de Camboulas parle d’abord d’une époque. Car la majeure partie des pièces sélectionnées ont été offertes au public londonien dans les toutes premières années du règne de Guillaume III d’Orange (1650-1702). Grâce à lui et à la Glorious Revolution (1688-1689) qui l’a porté sur le trône, la paix religieuse et civile retrouvée encourage la croissance économique et garantit la stabilité politique. A ce moment précis, « la nation britannique naissante est en pleine effervescence, et le besoin d’affirmer sa grandeur et de se débarrasser de ses complexes d’infériorité… s’exprime à tous les niveaux, y compris celui des arts », analysent Michel Baridon et Frédéric Ogee (Art et nation en Grande-Bretagne, Revue française de civilisation britannique, XIII-4, 2006).
Un milieu artistique qui avait bien besoin d’une révolution, si l’on en croit les continuateurs de L’Histoire d’Angleterre (Tome 6, 1839) de David Hume (1711-1776). Car « les compositions théâtrales de ce temps sont des monstres d’extravagance et de folie ». De fait, « au fur et à mesure que la cour débauchée et cynique, perdait son rôle d’arbitre de la mode londonienne, s’installait une culture bourgeoise qui allait triompher aux siècles suivants. Le règne de la raison commençait », explique Claude Hermann (Henry Purcell, 2009).
De l’aveu même de John Dryden (1631-1700), l’un des plus fameux librettistes de Henry Purcell (1659-1695), la musique anglaise accusait alors un retard notable sur les autres arts. Nous traduisons : « la poésie et la peinture ont atteint la perfection dans notre pays. En revanche, la musique est encore dans sa minorité (nonage), enfant précoce qui donne des espoirs pour l’avenir en Angleterre pour autant que les artistes (masters) y trouveront davantage d’encouragements» (préface du semi-opéra The Prophetess or The History of Dioclesian, cité par l’encyclopédie de vulgarisation Penny Cyclopaedia, volume 19, 1841 à l’article « Henry Purcell »).
Dans les cinq dernières années de sa courte vie, Purcell se dépense donc sans compter dans l’art de la composition. Jusqu’à en mourir de maladie et de surmenage, le 21 novembre 1695. Avec quelques-uns de ses amis compositeurs, il venait alors d’enrichir le répertoire des différents genres musicaux de l’époque. La sélection opérée par Louis-Noël Bestion de Camboulas atteste de l’étendue de leur savoir-faire et de la fécondité de leur esprit créatif. Ouvertures, intermèdes et danses extraits de semi-opéras (opéras dans la tradition britannique, avec parties parlées) ou chansons émaillant des pièces de théâtre y côtoient des pièces de circonstance, profanes et même religieuse.
Tous ces airs ont un point commun : ils parlent d’amour. Un sujet sensible alors que la révolution esthétique bat son plein. En témoignent nos auteurs de L’Histoire d’Angleterre : « L’amour était moins traité comme une passion noble que comme un simple appétit : l’un des deux sexes commençait à perdre le caractère national de chasteté, sans être capable d’inspirer à l’autre ce qu’on nomme sentiment ou délicatesse ». Eh bien, la musique fera office d’instrument de diagnostic autant que de remède pour civiliser les mœurs amoureuses.
Cette double finalité articule le projet de Louis-Noël Bestion de Camboulas. Tout autant qu’elle aiguillonne les talentueux interprètes de son Ensemble Les Surprises. Après avoir partagé des œuvres méconnues du répertoire baroque français, ils décident, dans le présent « hymne aux amours », de « prolonger cette démarche aux œuvres de Purcell et de ses amis… Forts d’une volonté de tisser des liens entre ces deux pays, nous voulons défendre ce répertoire à travers tout ce qu’il a de touchant, de grandiose mais aussi d’extrêmement dansant ».
Pour lors, deux chemins s’offrent à nous. Soit nous adoptons l’itinéraire tracé par le chef en référence à la varietas. Ce fameux principe de la rhétorique littéraire et musicale qui invite à enchaîner des pièces instrumentales à des compositions vocales. Nous considérerions alors l’amour à l’aune de l’esthétique.
Soit nous recomposons le programme musical et empruntons un trajet alternatif nous faisant pénétrer dans l’atelier des poètes, musiciens et autres passeurs culturels. A l’endroit même où ils façonnent les représentations sociales du phénomène amoureux. Ce détour nous amènerait à parcourir le cycle de vie de la relation amoureuse tel que le théâtre le donnait à voir à son public.
Quiconque souhaite emprunter le premier itinéraire trouvera dans le livret accompagnant le CD des indications utiles et instructives. En revanche, soucieux de ne jamais rompre les liens qu’entretiennent la musique et la société, nous choisissons la seconde voie et indiquerons le repérage des plages entre parenthèses.
L’Amour éclot
Notre parcours de découverte commence à l’heure de l’amour naissant (1). Ses premiers effets sont délectables. Comme l’explique le philosophe et médecin ordinaire de Louis XIV (1643-1715), Marin Cureau de La Chambre (1594-1669) dans ses Charactères des Passions (1640), l’amant « sent une nouvelle chaleur qui se répand en son âme, et un mélange de joie et d’étonnement lui cause un trouble si agréable, qu’il en est ravi ». Ainsi que nous le sommes lorsque l’exorde instrumental du programme musical nous agrippe fougueusement. Comme le médecin-philosophe, le musicien associe l’amour à la chaleur et à la gaieté. Cupidon et le Génie du Froid jaillissent alors de l’Acte III du King Arthur or The British Worthy (Z 628, 1691) de Dryden/ Purcell pour exalter les bienfaits de l’Amour. Un Amour qui nous a réchauffé/ Tis Love that has warm’d uns, exultait le chœur avant que notre Hornpipe (à l’origine, un air à danser sur une mélodie exécutée par un instrument à vent) introductif ne nous entraîne dans une sorte de gigue enfiévrée. Les vents gloussent de bonheur tandis que les percussions électrisent le tempo. Lorsque la danse s’enfièvre, ce sont les cordes qui mènent la danse. Nous en sortons ébouriffés.
Pour certains, l’amour est une fête permanente à laquelle s’invitent tous les âges. Même le vieillard Anacréon de Téos (vers 560- vers 478 avant J.C) qui aime tant aimer, boire et chanter (19). Sur un texte rédigé par un poète anonyme, Purcell compose l’une de ses rares pièces solistes pour la voix de basse qu’il publie dans The Banquet of Musick, sous le titre Anacreon’s Defeat (Z 423, 1688). Dans sa seizième Ode, Anacréon déclarait jadis : « je n’ai été vaincu ni par les cavaliers, ni par les fantassins, ni par les navires ; mais par une nouvelle armée qui lance des flèches par les yeux ». La chanson qui s’en inspire campe le tempérament d’un vert galant déclinant. Dans une première section au rythme alerte attisé par une vocalise ardente sur sings (chante), Anacréon envie ses confrères qui chantent les valeureux guerriers des Trojan wars (guerres de Troie) ou qui célèbrent les joueurs de gobelets de Thèbes (Theban jars). Guerriers qu’il encourage par des mélismes virevoltants emportant rattling (cliquetis) et joueurs-prestidigitateurs dont il applaudit l’audace en poussant un crescendo d’admiration sur dares (osé). La section suivante, balancée par un tempo fatigué, exprime la pondération du vieux sage. Car ses défaites sur le terrain amoureux ne lui inspirent plus guère que des soft and humble verse (vers doux et humbles). Un accès de sagesse pourtant bien éphémère car, sur un tempo revivifié, il brave tous les corps d’armées. Ne redoutant finalement que les killing eyes (yeux meurtriers) de la gente féminine. Par de multiples jeux de répétitions, il défie chacun de ces terrains d’opérations. Mais finit, sur une tonalité accablée, par céder aux flèches que lui lance sa dame. Cureau de La Chambre n’avait-il pas prévenu lorsqu’il signalait que « cette passion se rend maîtresse des plus sages hommes du monde » ?
D’autres s’inquiètent déjà de la résistance de la passion au temps qui passe. Telle Vénus qui, à l’Acte II de la Vénus and Adonis (1683) de John Blow (1649-1708), interroge son fils sur la manière de « rendre Adonis éternellement fidèle ». Avec ironie, Cupidon lui conseille de le « faire beaucoup souffrir ». La leçon terminée, il convoque les Grâces, déesses de la séduction et de la beauté, et leur demande de danser pour sa mère. Après une gavotte à la française, voici la Saraband for the Graces (12). Sur un tempo lent et vibrant, la ligne mélodique est sans cesse aspirée vers les aigus par les violons tandis que le théorbe égrène des accords mélancoliques. Une pièce émouvante en forme de transition vers l’Acte III au cours duquel Adonis meurt de ses blessures.
Il en est même qui subliment cette passion dans un amour sacré de la patrie (18). Tel ce court extrait du The Yorkshire Feast Song (Z 333, 1690) de Thomas D’Urfey (1653-1723) pour le texte et Purcell pour la musique. A la fin du XVIIème siècle, les expatriés de différents comtés avaient coutume de se retrouver pour un service religieux suivi d’une célébration caritative. Mais en 1690, la réunion des gentilshommes du Yorkshire prend une dimension particulière. Car Guillaume III d’Orange (et surtout son épouse, Marie d’York) est, depuis peu, leur nouveau souverain. La cérémonie vaut donc serment d’allégeance du Yorkshire au couple royal. L’ode raconte l’histoire du comté d’York, de l’invasion romaine au débarquement mouvementé de Guillaume III. Sous la forme d’une allégorie, les six vers sélectionnés évoquent, nous semble-t-il, la transition opérée par la Glorieuse Révolution. Cette période qui with black eclipse is shadow’d o’er (se trouve obscurcie par une éclipse noire, c’est-à-dire Jacques II contraint à l’exil) avant le retour de rayons de lumière plus ardents (Guillaume III et la reine Mary couronnés). Une transition politique que Purcell traduit par une sonorité en clair-obscur, à la fois angoissée et sereine. Un ostinato ombrageux guide un consort de cordes mélancoliques. Cependant, impavide, Eugénie Lefebvre réveille l’âme des mots porteurs d’espoir. Par de longues tenues de note, elle projette l’image du globe that swells with sullen pride (globe qui enfle de fierté sombre) puis laisse deviner, par des vocalises, la dazzling beams (la lumière éclatante) qu’il tente vainement de dissimuler. La répétition de little (petit) annonce que l’éclipse arrive à son terme. Car déjà, une vocalise ascendante sur brighter (plus lumineux) lève le voile sur un avenir plus radieux. Comme Malcolm dans le Macbeth (scène 4 de l’Acte IV) de William Shakespeare (1564-1616), la noblesse du Yorkshire semble dire à son roi : « A toi et à ma pauvre patrie, j’offre ce que je suis réellement ».
L’Amour face aux épreuves
En Angleterre comme en France, la mésalliance est un péché social. Qui entend le commettre, s’expose à une grosse déconvenue. Deux airs et une partie instrumentale vont en faire la démonstration.
La plainte amoureuse est l’une des thématiques de prédilection de John Blow. Il y excelle notamment dans celle qui s’apitoie sur le sort du poor Celadon, berger amoureux de la noble Eugénia (3). Dans cet air alangui à trois temps, Etienne Bazola applique délicatement un baume apaisant sur le cœur écorché du berger. L’âme en souffrance exsude une tendre mélancolie réellement communicative dans ce mouvement d’une grande beauté. La matière sonore, délicatement veloutée, s’épanche au rythme paisible d’un fleuve placide. A peine quelques affleurements pour révéler la profondeur de la douleur (un poignant Alas/ las) ou déplorer l’impasse dans laquelle se consument ses sentiments (une accélération nerveuse pour souligner que nor has a shepherd reason to complain/ un simple berger n’a nul droit de se plaindre). Le finale de la complainte est agrémenté d’un magnifique procédé poétique. En effet, pour matérialiser la distance sociale qui sépare le berger de sa dulcinée, le poète anonyme oppose deux images : celle des hautes montagnes (hills of greatest height) que gravit doucement la ligne mélodique et celle de l’humble vallon (lowly dale) dans lequel elle s’évanouit. Un exemple emblématique de word painting à l’anglaise élaboré avec les ingrédients du madrigalisme italien.
La passion peut être fatale au compositeur lui-même. Ainsi Jeremiah Clarke (vers 1664-1707), fameux organiste de la Chapel Royal de la reine Mary. Eperdument amoureux de l’une de ses élèves d’un rang plus élevé que le sien, confronté aux barrières sociales qui lui interdisent de vivre son amour, il estime que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue et met fin à ses jours. Il nous laisse des œuvres d’une grande beauté. Dont ce mélancolique Ground in D minor (20) extrait de son ode à la Vierge Marie (Song on the Assumption). L’ostinato scandé à la basse roule avec grâce au milieu de quelques étincelles échappées du théorbe. Quant aux flûtes, elles dessinent une ligne mélodique aux accents célestes dans lesquels se mêlent la dévotion (fort catholique en pays anglican) à la Vierge et la tristesse causée par son départ en Assomption. Une séparation inspirant un chagrin d’amour, mais de nature mystique.
Le semi-opéra The Indian Queen (Z 630, 1696) de Dryden/ Purcell inverse les rôles. A la scène 2 de l’Acte 3, la reine illégitime des Aztèques, Zempoalla, consulte le mage Ismeron (9). Elle est taraudée par un grave cas de conscience. Avant la bataille contre les Incas, elle avait juré aux dieux qu’elle leur immolerait tous ses prisonniers en cas de succès. Or, victorieuse, elle tombe éperdument amoureuse de l’un des généraux captifs : Montezuma. Bien que l’amour ne soit pas réciproque, son cœur et sa raison, l’amour et le devoir s’affrontent. Elle sollicite l’arbitrage du mage. Celui-ci se déclare incompétent. Dans un récitatif habité par une vénération craintive, il se tourne vers le God of dreams (dieu des rêves), le maître des destins. Comme écrasé par la sacralité de son interlocuteur, il épelle sentencieusement son invocation. Ici ou là, son discours est illustré par des images sonores, comme le ton caverneux enveloppant below (profondeur) ou les dissonances déchirant discord. Tout autant impressionné, le continuo laisse échapper des bourdonnements graves traversés par les frissonnements du clavecin. Isméron entre maintenant en contact avec l’univers occulte. Tourmenté par les stridulations des violons, son air empreint de frayeur dresse d’abord le catalogue des animaux qui grouillent dans ce théâtre lugubre. Particulièrement ces serpents qui glissent sur de longues vocalises. A cette scène descriptive succède une nouvelle invocation sur une tonalité soudain plus cérémonieuse. Sa voix gravit l’échelle chromatique pour s’approcher du dieu endormi. Puis s’adoucit pour ne pas le brusquer. Par les multiples modulations vocales qu’ils imposent, ce récitatif et cet air constituent un passage virtuose auquel Etienne Bazola donne ses lettres de noblesse.
Peu à peu, le dieu se réveille au son d’une symphony (10). Loin du spectacle d’épouvante auquel Isméron venait de nous faire assister, ce court passage instrumental décrit une atmosphère ensommeillée. Bassons et hautbois répandent une sonorité voluptueuse. La ligne mélodique égrène de longues tenues de notes suivies de brèves accélérations. Comme ce délicat ronflement d’un dormeur paisible alternant de profondes respirations et de courtes expirations.
Le dieu des rêves est enfin réveillé. Par la voix d’Eugénie Lefebvre, il déclare que le destin est secret et doit le rester (11). Cette fin de non-recevoir adressée au mage s’articule en trois parties. Dans une longue démonstration, le dieu s’attarde sur les conséquences qu’aurait la prescience des destinées individuelles. Pour s’assurer de l’attention de l’auditeur, il adopte divers outils didactiques : les modulations de la voix, la répétition de l’interdit (what must not/ ne cherchez pas à savoir) ou l’imagerie sonore (joy - joie) ou flow - coule, soulignés par des vocalises). La pédagogie s’allie à la séduction. Un aimable hautbois y apporte son concours, ornant la rhétorique pour la rendre plus désirable. Au moment d’afficher la morale de son intervention, le chant adopte subitement une allure plus solennelle et une tonalité évoquant la psalmodie. Pour que le message central puisse porter, le continuo se fait grave et discret. Enfin, sur un tempo plus alerte et en reconstituant son duo avec le hautbois, le dieu énonce le verdict : I am forbid by fate to tell the rest/ Le destin m’interdit de révéler la suite des événements.
Ce conflit perpétuel de l’amour et du devoir s’invite également dans le semi-opéra de Thomas Betterton (1635-1710), The Prophetess, or The history of Dioclésian (Z 627, 1690). Dans sa première partie, la prophétesse Delphia prédit à Dioclétien, alors simple soldat, qu’il deviendra empereur s’il tue un certain sanglier (Aper) et qu’il épousera alors la nièce de la prophétesse : Drusilla. Dioclétien vient à bout du sanglier mais s’éprend d’Aurélia, la sœur de son co-empereur. Le jour du mariage, Delphia provoque un orage qui reporte la cérémonie. C’est en cette fin de l’Acte II que les Furies se livrent à leur danse modelée par Purcell (4). Une danse bien peu furieuse, au demeurant. La tonalité d’ensemble évoque la « belle danse » à la française. A l’allure indolente de la marche d’entrée succèdent d’élégantes sections battues par un rythme pointé aux pulsations changeantes. Les variations de tonalité et de couleurs instrumentales agrémentent ce petit bijou musical.
L’Amour à en perdre la raison
Mais, plus encore lorsque l’amour devient passion, les plaisirs qu’il procure peuvent sombrer jusqu’au tréfonds d’un cœur brisé. Une passion « capable de toutes les folies qui peuvent entrer en un esprit égaré», diagnostique Cureau de La Chambre. Dans l’un des huit airs qui jalonnent le semi-opéra The comical History of Don Quixote de Thomas D’Urfey, John Eccles (1668-1735), élève et ami de Purcell, met en chanson le délire d’une jeune bergère qui se fourvoie dans un amour sans issue (2). D’aucuns considèrent, aujourd’hui, cet air comme un standard du mad song (air de folie). Ce genre musical pittoresque rencontrait alors un immense succès sur les scènes londoniennes. Un répertoire de prédilection pour les interprètes de l’époque, les comédiennes donnant libre cours à un jeu d’acteur souvent spectaculaire. Comme à la scène 2 de l’Acte V de notre pièce où la bergère Marcella est victime d’une hallucination. Dans un cauchemar, elle aperçoit Ambrosio, l’objet de son affection, transformé en dragon. De ses flammes, crie-t-elle, il « brûle mes veines et mon cœur ». De fait, elle est dévorée par le feu d’un amour sans réciprocité. A en perdre la raison. I burn, I burn, my brain consumes to ashes (Je brûle, je brûle, mon cerveau se consume en cendres). Dans cette bouffée délirante à forte intensité dramatique, l’actrice-vedette Anne Bracegirdle (1671-1748) avait fait sensation. « D’Urfey note que l’interprétation de Mrs Bracegirdle fut si brillante que les plus envieux comme les plus sincères s’accordèrent à reconnaître qu’il s’agissant de la meilleure pièce du genre », rappelle Philip Pickett dans sa note de programme publiée par la Philharmonie de Paris (Cycle « Fin des temps », 2009). Aujourd’hui, l’interprétation d’Eugénie Lefebvre légitime le même éloge tant elle joue magistralement sur tout le registre du langage musical de la folie. D’excès expressifs en convulsions rythmiques, elle explore la profondeur des troubles qui caractérisent la dépression amoureuse. Le texte poétique est astucieusement construit en une succession de courtes séquences dont la musique exaspère chacun des élans émotifs. De concert, ils animent une première image, celle du feu intérieur qui se propage, de la montée crescendo et accelerando de I burn (je brûle) jusqu’à l’incandescence des ashes (cendres) s’abîmant dans d’éblouissants (flashes) éclairs. Vient ensuite l’appel à l’aide adressé aux forces infernales. Notamment à ce vent attisé par les cordes qui se rapproche espressivo sur la répétition de blow (soufflez). Mais, ni lui, ni les eaux n’éteindront le brasier. Dans un bref instant de lucidité, Marcella scrute amèrement l’origine de son mal (pride hot as hell/ l’orgueil aussi brûlant que l’enfer) puis, en colère contre elle-même, ressasse ses remords (fool, that consider’d not when I was well/ insensée que j’étais de ne pas avoir vu mon bien-être). Mais son mal est manifestement sans remède. Elle fait donc ses adieux aux transporting joys (transports de joie), consciente qu’elle allait vivre plus durement encore qu’en enfer, dans un feu perpétuel. Instantanément, le mal est plus intense car for scorn is turn’d into desire (le mépris s’est mué en désir).
Quelques plages plus loin (15), nous retrouverons Marcella. En filigrane, cette fois. A la scène 2 de l’Acte II, se déroulent les funérailles de l’une des victimes de sa cruauté. Notre jeune et belle bergère « qui déteste l’humanité » venait de provoquer, par son mépris, la mort de Chrysostome. Dans un bouleversant hymne funéraire en forme de cantate de poche, Eccles accompagne les adieux que font deux amis bergers à celui qui est « mort pour l’Amour ». Extraite de la même veine que la canzona qui ouvre la Music for the Funeral of Queen Mary de Purcell (Z 860, 1695), l’ouverture instrumentale conjugue trois émotions : la solennité (le tambour), la tristesse (les vents) et la douleur (les cordes et l’orgue). Une bergère rejoint le trio pour poser des mots sur ces affetti. Dans un caressant requiem profane (sleep in peace/ dors en paix), elle envie pourtant le poor youth (pauvre jeune homme) désormais délivré de l’amour. Cette élégie fait alterner la voix et les instruments, comme pour laisser à l’émotion le temps de reprendre ses esprits. Sur un tapis de cordes, porté par un ostinato accablé, un berger s’attarde maintenant sur la sépulture de leur ami. Libéré des contingences humaines, il n’a plus à craindre la scornful beauty (dédaigneuse beauté) qui l’a mené au tombeau. Autant la complainte d’Etienne Bazola était teintée d’une triste tendresse, autant l’écriture musicale du plaidoyer d’Eugénie Lefebvre puise généreusement dans le registre du figuralisme pour décrire les calamités auxquelles échappera dorénavant le disparu. Si l’évocation des guerres (wars) adopte le rythme sauvage d’une charge de cavalerie, la répétition obsédante de far (loin) la tient à distance. Si les longues vocalises sont agitées (shake) par des tremblements de terre, la répétition de can’t rock (ne peuvent l’atteindre) entraîne des mélismes sur une ligne ascendante aux vertus auto-persuasives. Les solistes se rejoignent pour envelopper le défunt dans de délicieux mélismes cueillis parmi les charms of peace (charmes de la paix). Un duo homorythmique le met à l’abri des tourments tandis qu’un mouvement en imitation déroule une berceuse l’invitant au repos. Afin de finaliser la structure circulaire du texte, l’accompagnement instrumental initial fait son retour pour soutenir le duo d’adieu : the folly of the face is done (la folie de la farce est finie).
L’Amour et ses supplétifs
Pour que les amours contrariés ne mènent pas à une issue fâcheuse, l’amant éconduit use de stratagèmes. Pour certains, tous les moyens sont bons afin de forcer le destin. Y compris la magie (22). Dryden/Purcell nous prennent à témoin à la scène 1 de l’Acte IV de la tragédie Tyrannic Love or The royal Martyr (Z 613, 1694). Cette pièce s’inspire de la légende du martyre de la vierge Catherine d’Alexandrie (celle qui a peuplé les visions de Jeanne D’Arc). Placidius, un affidé de l’empereur Maximus, tente de persuader Catherine de devenir la maîtresse de l’empereur. N’y parvenant pas, il demande l’aide du magicien Nigrinus. Celui-ci n’ignore pas que « ce sont les Esprits qui dans l’Amour ont le pouvoir ». Il convoque donc deux « esprits aériens » : Nakar, esprit mâle qui dirige les cohortes des esprits mauvais et Damilcar, esprit femelle dont les armes sont la séduction et la persuasion. Voici justement que les deux esprits descendent dans les nuages. Cette petite fraction d’opéra burlesque à l’italienne se déroule en trois temps. Dans le premier, le duo s’empresse de répondre à l’appel du magicien. Le continuo est trépident et les voix s’entrelacent dans un effervescent jeu en imitation tant ils sont émoustillés par leurs tonifiants Tivy, tivy, tivy (chevauchons). Mais, pour que chacun puisse remplir sa mission, ils doivent agir séparément. S’ensuit un temps brièvement suspendu par d’attendrissants adieux échangés entre ces deux esprits-amants (Alas ! must leave thee, my love/ Las, je dois vous quitter mon amour). Déjà les voici repartis dans deux ardents solos pour finalement se rejoindre dans un air en hommage au little soft god (petit dieu tendre) qui aime à satisfaire les vœux des amoureux.
Plutôt que de recourir aux forces occultes, d’autres s’enferment dans le cynisme. Tel Lyonel se délectant du stéréotype de genre. Et sans la moindre finesse lorsqu’il déclare qu’une « belle femme est le courtier d’âme du diable ». Purcell transformera en chanson la diatribe que Thomas D’Urfey fait proférer à Lyonel dès la scène 1 de l’Acte I de sa pièce A fool’s preferment, or The Three Dukes of Dunstable/ La promotion des imbéciles ou Les trois Ducs de Dunstable (Z 571, 1688). Un air que l’expressivité du chanteur transforme en fulmination (13). Avec quelle belle assurance Etienne Bazola clame son manifeste sur le thème : there’s nothing so fatal as woman (il n’y a rien de plus fatal qu’une femme). D’accords frappés en trilles fébriles, le théorbe et la guitare nourrissent sa véhémence. Finalement, il ne trouvera d’apaisement qu’à l’évocation de la bouteille. Celle dont la vertu est de faire oublier the cheats of the fair (les tricheries de la belle). Une morale bien peu conventionnelle. Mais en parfaite concordance avec l’esprit de cette pièce mal accueillie par un public désorienté par son libertinage.
Amours arrimés
La passion amoureuse survit-elle à son entrée dans un cadre conjugal ? A en croire la sélection opérée par Louis-Noël Bestion de Camboulas, les avis semblent partagés.
Certes, dans les débuts, les amants déclarent que ever be happy, and ever be true (nous serons heureux et fidèles à jamais). Tel le duo chanté par un homme et une femme dans le semi-opéra Pausanias, the betrayer of his country (Pausanias, le traître à sa patrie). Les paroles sont du poète Thomas Norton (1666-1732) et la musique composée par Daniel Purcell (vers 1664-1717), frère cadet ou cousin de Henry (21). Nous ne sommes parvenus, ni à identifier les deux personnages énamourés, ni le moment de l’intrigue au cours duquel ils se produisent. Pour autant, ce duo d’amour chaleureux exprime la fusion sentimentale de ce jeune couple. Sur une charmante tonalité langoureuse, les deux âmes éprises s’échangent leurs affections réciproques. L’écriture musicale, d’une remarquable richesse stylistique, répand un parfum savoureux. De dialogues en unissons, de retards en accélérations, de vocalises voluptueuses sur I languish (je languis) en murmures attendris pour désigner la belle (my fairest), cet air charmant rayonne de bonheur. Mais un bonheur sans illusions tant l’expérience a montré que les love’s raptures (délices de l’amour) sont parfois de courte durée. Il faut bien cette répétition des no (non) pour conjurer l’apparition des difficultés amoureuses.
Difficultés sur lesquelles ironise Rule a wife and have a wife/ Diriger une femme ou avoir une femme (Z 587, 1694). Ce texte d’Anthony Henley (1667-1711) pour une pièce de John Fletcher (1579-1625) raconte l’histoire de deux couples. Dans l’un d’entre eux, Margarita épouse Léon à la condition qu’elle puisse avoir des amants. La chanson mise en musique par Henry Purcell ouvre l’Acte III, juste avant que Margarita ne se vante de dominer son époux (5). Une chanson sous tension. Des vers courts, un tempo agité et un continuo acéré, haché par la guitare. Le texte défile à l’allure d’une algarade proférée par un mari abusé. Eugénie Lefebvre y déploie une énergie frénétique sans jamais rompre la parfaite harmonie avec les instrumentistes qui l’accompagnent. Une prouesse dans cette pièce survoltée.
Quand les stéréotypes brouillent les regards que porte l’un sur l’autre, la friction se métamorphose en comédie. Comme celle dans laquelle Thomas D’Urfey doute de la vertu des femmes : The virtuous wife or Good luck at last/La femme vertueuse ou bonne chance enfin (Z 611, 1694). Purcell émaille la pièce de théâtre d’une Overture (14) à laquelle s’ajoutent huit autres airs. Une ouverture qui commence à la façon française (un mouvement lent, une marche solennelle dont le pas est dicté par des notes pointées). Elle se poursuit, toujours sur le même modèle, par un fugato enjoué. En revanche, la troisième partie renie le modèle au bénéfice d’une plaisante variation à la tonalité joyeuse. Preuve, s’il en faut, que la musique, comme l’amour, se complaisent dans de petits écarts ! Deux autres airs extraits de la même pièce s’invitent quelques plages plus loin. Un Slow air (16) s’étire langoureusement dans une atmosphère d’une douceur sucrée. Un adorable « air du sommeil » sans paroles. Aux antipodes, les cordes chahutent sur l’Air suivant (17). Dans une piquante alternance avec le tutti, elles agitent les sons comme la dispute pimente la vie d’un couple.
L’amour conjugal n’emprunte pas toujours le cours d’un long fleuve tranquille. Ainsi, la reine Titania fuit-elle la jalousie de son mari Obéron, le roi des elfes dans le semi-opéra The fairy Queen (Z 629, 1692) que Purcell a habillé de musique. Le roi ordonne à son lutin Puck de poser un philtre sur les yeux de la reine afin qu’elle tombe amoureuse de la première personne qu’elle apercevra à son réveil. A l’Acte III, Titiana se réveille d’abord comme dans un rêve. Deux cygnes apparaissent sur un étang, se transforment en fées puis engagent une danse, interrompue par le ballet de quatre sauvages verts. C’est ce passage fantasmagorique que Louis-Noël Bestion de Camboulas nous fait goûter. Juste avant que la reine, sous l’effet du philtre, ne s’éprenne d’un tisserand affublé d’une tête d’âne. Mais rassurons-nous : à l’Acte IV, les époux finiront par se réconcilier. Trois courtes séquences instrumentales s’enchaînent. D’abord (6), un ardent hornpipe fouetté par les guitares et agité par les violons s’élance pour une joyeuse farandole. La mélodie est obsédante et le rythme irrésistible. La danse des fées (7) est maintenant conduite par des flûtes guillerettes. Autant la mélodie précédente fleurait bon son essence populaire, autant celle-ci adopte le style des danses galantes aux allures Renaissance. Surviennent les sauvages verts soutenus par l’ensemble instrumental (8) pour danser une sorte de menuet. Manifestement, cette diversité de rythmes et de sonorités attise les vertus enchanteresses de l’amour.
Pour célébrer la fin de ce parcours dans l’univers des amants, quoi de mieux qu’une Chaconne ? Deux raisons à cela. D’abord, parce que la chaconne clôt habituellement les tragédies lyriques baroques. Mais surtout, car cette chaconne-là (23) couronne le semi-opéra King Arthur. Ce moment où Arthur parvient à délivrer sa bien-aimée Emmeline. S’ensuit une grande célébration de la victoire dans laquelle tous célèbrent l’Amour ainsi que Britannia. Une charmante manière de quitter l’un comme l’autre sur un mouvement de danse alerte conduit tour à tour par les hautbois et les cordes.
Que l’on suive l’ordre du programme ou que l’on emprunte l’itinéraire des amoureux, ce disque ravit par la diversité de ses atmosphères et la singularité des œuvres choisies. Il offre donc la double opportunité d’assouvir notre soif de découverte de nouveautés tout en prenant du plaisir à contempler des fragments d’œuvres parfois échappés des profondeurs de l’oubli.
Parce que le thème de l’amour est universel et intemporel, nous saluons l’initiative prise par Louis-Noël Bestion de Camboulas de proposer ici un échantillon de différents états amoureux qui s’exhibaient sur scène à la toute fin du XVIIème siècle anglais. Un siècle pour lequel « l’Amour n’est pas seulement la source de toutes les Passions, elle l’est encore de tous les biens et de tous les maux qui arrivent aux hommes », si l’on en croit Cureau de La Chambre. Une bien agréable manière d’entrer dans l’intimité des cœurs tels qu’ils battaient outre-Manche, voici plus de trois cents ans.
Mais une expérience sensible qui n’aurait pas trouvé d’écho bienveillant s’ils n’étaient servis par des musiciens parfaitement maîtres de leurs instruments. Qu’il s’agisse de la voix, tellement expressive, des deux solistes. Au-delà des textes proprement dits, ils mettent leur cœur et leur chant au service des différents degrés de passion qu’ils recèlent. Ou que nous considérions leurs compagnons instrumentistes qui les assistent avec justesse et empathie. Ils font sonner leurs instruments au diapason de l’émotion que le compositeur entend réveiller. Cette convergence de talents élève ce disque au rang de curiosité historique et de réussite esthétique.
Publié le 24 févr. 2021 par Michel Boesch
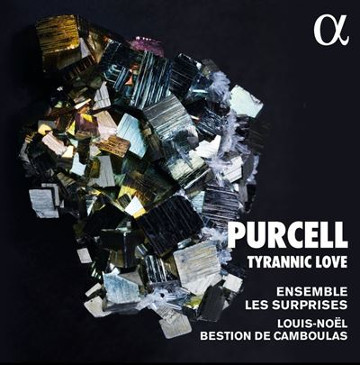 ©
©