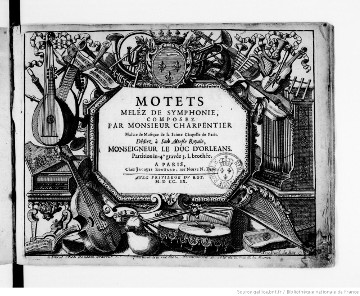Vêpres pour Saint Louis - Charpentier
 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec notice bilingue (français-anglais) de Catherine Cessac, un CD, durée totale : 71 minutes, 40 secondes. Alpha Classics - 2019
Compositeurs
- Guillaume Gabriel Nivers (1632-1714) : Prélude du 1er ton - Prélude du 2ème ton
- Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) : Vêpres pour saint Louis
Chanteurs/Interprètes
- Robert Getchell (haute-contre)
- Hervé Lamy (taille)
- Alain Buet (basse)
- Les Pages du Centre de Musique Baroque de Versailles : Ghislain Bataille, Pierre Blaise, Emmanuel Bommelaer, Anne-Cécile Caseau, Camille Chagnon, Côme Cladière, Alexis de Compreignac, Fabiola Dechin, Alexis Galli*, Augustin Gaudemer, Casimir Gosset, Romain Grimal, Noèmie Imbault, Natan Katz, Charlotte Kurz, Paul Libert, Antoine Mercier, Cécile Tournesac, Stéphane Ung*
- Les Chantres du CMBV :
- Dessus : Béatrice Gobin*, Magali Lange, Yukari Miyauchi, Sarah Szlakmann
- Bas-dessus : Jean-Sébastien Beauvais, Julien Freymuth, Arnaud Raffarin
- Tailles : Dominique Bonnetain, Edouard Hazebrouck, Lior Leibovici, Lisandro Nesis, Ludovic Redon
- Basses-tailles et basses : Nicolas Boulanger, Edwin Crossley-Mercer*, Arnaud Lasne, Ludovic Provost
- * : solistes
- Orgue (Grand orgue de la Chapelle Royale de Versailles) : Frédéric Desenclos
- Violes de gambe : Matthieu Lusson, Yuka Saïto
- Théorbe : Benjamin Perrot
- Basson : Alexandre Salles
- Direction : Olivier Schneebeli
Pistes
- 1.Guillaume Gabriel Nivers : Prélude du 1er ton
- 2.Marc-Antoine Charpentier : Vêpres pour saint Louis – Deus in adjuditorium
- 3.Domine quinque talenta, H. 33
- 4.Dixit Dominus, H. 197
- 5.Euge serve bone, H. 375
- 6.Confitebor tibi Domine, H. 220
- 7.Fidelius servus, H. 34
- 8.Beatus vir, H. 221
- 9.Guillaume Gabriel Nivers : Fugue grave
- 10.Charpentier : Vêpres pour saint Louis – Beatus vir qui inventus est, H. 376
- 11.Laudate pueri Dominum, H. 203
- 12.Serve bone, H. 35
- 13.Laudate Dominum, H. 214
- 14.In honorem sancti (motet pour saint Louis), H. 323
- 15.Magnificat, H. 76
- 16.Nivers : Prélude du 2ème ton
- 17.Charpentier : Vêpres pour saint Louis – Domine salvum, H. 292
Hommage vespéral aux rois Louis25 août 1618. Louis XIII (1601-1643) est « esveillé à sept heures et demie après minuict, doulcement. Prie Dieu. A neuf heures, entre en carrosse et va à la messe aux Jésuites à Saint Louis, y a communié… A deux heures, entre en carrosse, va à vespres et au sermon à Saint Louis, rue Saint Antoine ».
Mais qu’avait bien pu faire le roi à la maison professe parisienne des Pères Jésuites ? Pour son médecin personnel, Jean Héroard (1551-1628), rien qui méritât d’être enregistré dans le Journal de ce calviniste tôt converti au catholicisme.
Pourtant, c’est précisément à cette date et en ce lieu que « le 25 août devint journée d’hommage au roi saint et fête de la royauté » (Jean Biou, Le Saint-Roi et le Divin Marquis, Raison présente, 1972). Jusqu’au XVIème siècle, en fait de vénération publique, saint Louis IX (1214-1270) ne figurait pas au rang des favoris. C’est Henri IV (1553-1610) qui, « premier Bourbon sur le trône, affirme sa dévotion pour le saint ancêtre qui sert en quelque sorte de garant à sa conversion récente ». Aussi, son fils sera-t-il prénommé Louis, « prénom qui deviendra dès lors dynastique ».
Dans le premier Panégyrique du Roy S. Louys, sur le subject de la célébration de sa feste, ordonnée par notre S. Père, à la requête du Roy très chrétien Louys XIII, à présent régnant prononcé ce 25 août 1618, le théologien Etienne Molinier (1580-1650) admet que la France « ne pouvait sans ingratitude différer plus longtemps à lui (saint Louis) rendre ce tribut d’honneur payé si tard et dû si justement ». D’ailleurs, elle « méritait déjà le nom d’ingrate pour avoir tant retardé, s’il ne fallait reconnaître en ce retardement une particulière providence de Dieu, qui voulait réserver à notre siècle le fruit et à notre Prince la gloire de cette action ». A compter de cette date, sermons, panégyriques et discours académiques annuels rivalisent d’intensité et d’inventivité pour tisser les portraits croisés du « père des Bourbons » (comme le qualifie Voltaire dans le Xème chant de la Henriade) et de son descendant régnant.
Nombreuses sont les institutions qui célébreront ensuite cette fête avec le plus grand faste. Ainsi, la Ville de Paris, « sachant l’état où était ce Monarque (Louis XIV atteint de la « fièvre des tranchées » lors du siège de Calais, à l’été 1658), fit vœu pour le recouvrement de sa santé, et pour la conservation de ce Prince, de faire chanter tous les ans le jour de la fête de Saint Louis, une Messe solennelle… C’est pourquoi on les voit tous les ans le jour de la Saint Louis, traverser la Ville en procession en chapes, faisant porter beaucoup de reliques, au son de plusieurs instruments et particulièrement des trompettes » (Mercure Galant, septembre 1708). De même, « Messieurs de l’Académie Françoise, voulant honorer la mémoire de Saint Louis, à cause que ce Saint est Patron du Roy, font dire tous les ans le jour que l’Eglise en célèbre la fête, une messe accompagnée d’une grande Musique et ils choisissent un prédicateur d’une réputation établie et capable de se servir des plus beaux traits de l’éloquence pour faire le panégyrique d’un Saint dont la vie se trouve remplie d’une infinité de vertus morales et chrétiennes, que l’on voit tous les jours pratiquer au Souverain » (Mercure Galant, septembre 1707). Sur les indications testamentaires de Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654), c’est d’ailleurs ce même jour que, tous les deux ans, l’Académie remet aux lauréats un «crucifix ou un saint Louis d’or » (Mercure galant, décembre 1684) au cours d’une séance extraordinaire ouverte au public. Est-il utile de préciser que prêches apologétiques et éclats de musiques résonnent également, tous les 25 août, en cette église Saint-Louis-des-Jésuites qui avait été la matrice de cette célébration aussi hagiographique que politique ?
La dévotion particulière que voue la Compagnie de Jésus à saint Louis ne pouvait pas échapper à ses compositeurs attitrés. Au premier rang desquels Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) qui lui dédie quatre motets. Ce qui, dans ses œuvres, en fait « la figure du saint la plus honorée », dénombre Catherine Cessac dans sa biographie du musicien (Fayard, 2004).
Les vêpres en musique, au contraire des messes solennelles, ne rencontrent généralement pas d’échos dans la presse. Mais ne nous y trompons pas. Ces offices de fin d’après-midi structurent alors l’organisation sociale du temps dominical. A deux titres. D’abord, parce qu’il est du devoir de tout chrétien d’aller à vêpres. Un seul exemple suffira à le démontrer. Dans le Catéchisme du diocèse de Mirepoix (1699), Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) interroge, puis répond : « Quel service doit-on rendre à Dieu au jour du Dimanche ? Il faut assister à la sainte Messe…, entendre le Sermon et le Catéchisme…, assister aux Vêpres et à tout le reste du Service Divin ». Même la vie en société est ponctuée par l’heure des vêpres. Car celles-ci sont souvent prolongées par des assemblées au cours desquelles la communauté paroissiale répartit les impôts ou désigne ses représentants locaux. De même, certaines réunions académiques se tiennent « tous les Dimanches après Vêpres », comme les conférences publiques organisées par la Société Royale de Médecine (Nicolas de Blegny (1643 ?-1722) in Le livre commode contenant les Adresses de la Ville de Paris, 1692).
Pour le parisien qui poussait la porte d’une église à l’heure des vêpres, l’action liturgique n’avait pas de mystère. Et, en ce qui concerne la musique liturgique, le chanoine Martin Sonnet (16..-16..) avait répertorié, en 1656, les espaces dédiés aux voix et aux instruments. Voyez le chapitre XIII du cinquième Livre de son Directorium chori seu Ceremoniale sanctae et metropolitanae Ecclesiae ac Diocesis Parisiensi (La direction des chœurs ou Cérémonial de la sainte et métropolitaine Eglise et Diocèse de Paris). Résumons et traduisons : cinq psaumes vespéraux (nota : le chiffre cinq comme allégorie christologique faisant référence aux cinq plaies du Christ crucifié), antiennes et répons, hymne accompagné par l’orgue, Magnificat, antienne commémorative s’il y a lieu (ici, en hommage à saint Louis), oraison mariale (inviolata) à l’orgue et prière d’action de grâce. En revanche, du vivant de Charpentier, deux types de programmes musicaux pouvaient être inscrits à « l’affiche » du 25 août. Celui de L’Office de saint Louis Roy de France, pour le jour, l’octave de sa fête et pour la translation de son chef, suivant l’usage de Paris (1697). Mais, à bien des égards, son déroulé ne coïncide pas avec l’éblouissant programme musical enregistré par les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV). Le second est attaché au Commun des confesseurs non pontifes (saints n’ayant pas été évêques). Pour l’essentiel, il correspond au canevas retenu par Olivier Schneebeli.
Afin de construire le menu musical de l’office fictif qu’il consacre à la célébration de saint Louis, notre prestigieux chef remplace les pages grégoriennes par des motets prélevés dans l’opulent catalogue des œuvres de Charpentier. De même, voulant consacrer la place qui revient à l’orgue dans ce type de célébration, il emprunte à l’organiste de la paroisse de Saint-Sulpice, Guillaume Gabriel Nivers (1632-1714), quelques passages extraits du Troisième livre d’orgue des huit tons de l’Eglise (1675). Celui-là même qui vaudra au musicien sa nomination à la Chapelle Royale de Versailles.

Page de garde du 3ème livre de Nivers – source Gallica/ BNF
Le début de notre office est annoncé par le Prélude du 1er ton qui ouvre ce recueil. Un choix judicieux si l’on se souvient que, dans « les diverses affections que les modes ont accoutumé de produire dans les cœurs », le premier ton « est estimé propre à marquer la noblesse, la grandeur et l’importance d’une chose ; à témoigner une joie modeste et grave, à porter à la piété et à la vertu » (Pierre-Benoît Jumilhac (1611-1682), La science et la pratique du plain-chant, 1673). Le ton ecclésiastique choisi se trouve donc en concordance parfaite avec le portrait moral du saint roi auquel est dédié notre office. Dans l’intention de Nivers, cette pièce d’ouverture fait dialoguer le Positif et le Grand Plein jeu. Cependant, la registration choisie par Frédéric Desenclos nous semble réduire quelque peu les effets de contraste recherchés. Pour autant, le mouvement ascendant et descendant de la ligne mélodique tisse un lien spirituel entre le saint roi et son descendant tandis que son rythme pointé fait lointainement écho aux ouvertures d’opéra lullistes.
Déjà, le chantre entonne, a cappella, le premier verset du Psaume 70/69. Ce Deus in adjutorium meum intende (O Dieu hâte-toi de me délivrer) ouvre rituellement l’office des huit Heures canoniales (des Matines aux Complies, en passant par les Vêpres). Le tutti choral, appuyé par le Grand Plein Jeu de l’orgue de la Chapelle Royale de Versailles, lui répond par un imposant Domine ad adjuvandum me festina (Eternel, hâte-toi de me secourir). Le chantre psalmodie ensuite les premières mesures de la doxologie (Gloria Patri et Filio) à laquelle le chœur apportera tout l’éclat et la magnificence qu’impose cette invocation de la Trinité. L’écriture musicale de ce verset, retravaillée par Olivier Schneebeli, est caractéristique de la mue que le faux-bourdon subit dans le courant du XVIIème siècle. La mélodie principale est désormais fixée dans la partie supérieure (magnifiquement tenue par les Pages du CMBV) tandis que les autres voix évoluent en mouvements parallèles. « C’est la psalmodie des catholiques romains chantée à plusieurs parties », résume Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dans son Dictionnaire de Musique (1764). Avec cette entrée en matière étourdissante, cousine de l’ouverture des Vespro della Beata Vergine (1610) de Claudio Monterverdi (1567-1643), le faux-bourdon abandonne résolument le champ du grégorien pour s’épanouir dans celui des motets à grand chœur.
Nous entrons maintenant dans la séquence principale, celle des cinq Psaumes. Traditionnellement, chacun d’eux est encadré par une antiphona (antienne), reflet des paroles du Psaume auquel elle est associée. Mais ici, c’est l’Evangile du jour anniversaire de saint Louis qui préside au choix du texte. Non pas la lecture proprement dite (Luc, 19, 12-26) mais son exacte réplique, la « parabole des talents » racontée par Matthieu. Ce Domine, quinque talenta tradidisti mihi (Seigneur, vous m’avez confié cinq talents) H 33 est la première des trois antiennes que Charpentier destine aux Vespres d’un confesseur non pontife (H 33 à 35). Il attribue nominativement les trois lignes de chant à trois solistes masculins (dont deux castrats italiens de la Musique de la Chambre et de la Chapelle du roi) qui excellent dans le registre des « hauts-dessus », la catégorie des voix les plus aiguës. Ici, trois groupes de Pages du CMBV aiguillonnent ce verset (25, 20) de l’Evangile selon Matthieu dans lequel le serviteur méritant rend compte de la gestion des cinq talents qui lui avaient été confiés par son maître avant son départ. Dans son manuscrit autographe, le compositeur entendait que ce petit motet fût chanté sur une allure enjouée (« guay »). Une consigne parfaitement suivie par nos trois ensembles vocaux qui séduisent par la cadence juvénile qu’ils impriment à la partition. Ce petit bijou musical brille par ses subtils contrastes rythmiques amplifiés par un continuo trépidant. Un cérémonieux Domine (Seigneur) se prosterne d’abord avant qu’une guirlande de croches ne fasse tinter les quinque talenta (cinq talents). De même, l’écriture en imitation diffuse un sentiment d’abondance destiné à représenter la gestion lucrative du dépôt confié au serviteur. Enfin, Charpentier fait œuvre de pédagogue lorsqu’il isole deux expressions puis les exalte successivement dans chaque ligne de chant en les habillant d’ornements chatoyants. Ainsi, à l’instar d’un bilan comptable, il met musicalement en miroir le dépôt initial (tradidisti mihi/ vous m’avez confié) et le bilan final (superlucratus sum/ j’en ai gagné). Une belle manière de réconcilier la foi et l’argent bien gagné !
A cette antienne joviale répond un Psaume aux accents qualifiés de « sérieux et magnifique » (sol mineur) dans les Règles de compositions que Charpentier conçoit alors même qu’il travaille peut-être à la mise en musique du Dixit Dominus H 197 (1688-1690 ?). Sa partition, destinée aux Jésuites de la rue saint Antoine, mobilise trois solistes (haute-contre, taille et basse) ainsi qu’un chœur à la française à quatre parties. Une formation somme toute habituelle en France car elle « correspond très exactement à (celle) des maîtrises des grandes églises du royaume », précise Jean Duron (Des vêpres de Marc-Antoine Charpentier ? 1994). Les parties vocales sont soutenues par une basse continue qui varie selon qu’elle accompagne le chœur (le plein jeu de l’orgue) ou qu’elle soutient les solistes (viole de gambe, théorbe et basson). Mais la magnificence de ce Psaume tient surtout à sa nature constamment changeante. Dès la première strophe, le compositeur fait la démonstration du pouvoir expressif de la musique. Dans un mouvement d’amplification, l’intensité gravit trois paliers : la taille entonne ce Psaume de David (110/109) comme le ferait le Chantre d’une schola grégorienne tandis qu’une trinité vocale (taille, haute-contre puis basse) enjoint le Christ (et peut-être aussi le roi) à s’asseoir à la droite du Seigneur (sede a dextris meis). Ensemble, ils savourent le spectacle de l’asservissement des ennemis dont se réjouira le tutti. Sur le principe, la distribution vocale ne variera plus : aux parties solistes sont déléguées les évocations de la parole divine tandis que les masses sonores du tutti modèlent les descriptions dramatiques. En d’autres termes, la répartition des rôles est guidée par le texte. En voici deux exemples. La troisième strophe est confiée à un trio de solistes. Une manière subtile de projeter l’image de la Trinité pour signifier qu’elle est à l’origine de toute chose (ex utero ante luciferum genui te/ de mon ventre dès l’aurore je t’ai engendré). En revanche, le tutti prête sa voix à l’Eglise entière pour saluer la consécration du Christ (tu es sacerdos in aeternum). A cette attention portée au texte s’ajoute l’emploi de procédés figuratifs propres à mettre en scène certains passages. Comme ce rythme pointé, souvent associé à des figures royales, qui accorde la marche de notre prêtre (sacerdos). Ou cet implebit ruinas (remplira de ruines) emporté par une ligne mélodique chancelante. Mais également l’emploi du stile concitato (littéralement « style agité ») montéverdien pour ébranler confregit (il a brisé) et conquassabit (il fracassera). Enfin, dans la doxologie, ce sicut erat in principio (comme il était au commencement) magnifiquement scandé, comme pour procéder au décompte des siècles consacrés à la glorification de la Trinité. C’est sur sa tonalité grandiose et inspirée que s’achève ce motet taillé à la mesure de l’esthétique jésuite.
Egalement prélevée dans les Vêpres d’un confesseur non pontife, l’antienne suivante met en musique la réponse qu’apporte le maître au serviteur qui avait fait fructifier les cinq talents (Matthieu, 25-21). Le motet Euge serve bone (C’est bien, bon serviteur) H 375 est confié à deux solistes (haute-contre et taille). Observons au passage que ces deux motets sont construits selon un même patron : un distique borné par une brève ritournelle instrumentale. Dans les deux cas, le tempo enjoué est galvanisé par un continuo trépidant tandis que, conformément aux directives de Charpentier, les voix lui insufflent une allure gaie. Pareillement, les lignes mélodiques s’entrelacent pour former une guirlande lumineuse que les timbres finement taillés de Robert Getchell et d’Hervé Lamy font miroiter. Et toujours cette écriture musicale dont se sert Charpentier pour délivrer un message à son auditoire. Ici, il fait converger le langage des mots et celui des émotions. Ainsi, dans le premier stique, il isole, par le jeu de la répétition, l’expression euge, serve bone. Puis, dans le second, il réveille l’émotion correspondante en enveloppant gaudium (la joie) de liserés de doubles croches. Cette subtile l’association musicale des mots et de l’affect affirme que l’exercice de la vertu conduit inévitablement au bonheur.
Henry Desmarest (1661-1741) ne s’y était pas trompé. Opportunément, il ajoutera le Confitebor tibi, Domine (Seigneur je vous louerai - Psaume 111/110) aux motets qu’il joint à la supplique adressée au roi pour obtenir la fin de l’exil auquel il avait été contraint pour avoir enlevé puis épousé Marguerite de Saint Gobert (1678-1727). Car, pour le musicologue Jean-Paul Montagnier (Chanter Dieu en la Chapelle Royale, Revue de Musicologie, 2000), ce Psaume compte parmi ceux « qui se prêtent aisément au « détournement » de sens ». En l’espèce, cet éloge des œuvres divines publiait avant tout les louanges du roi. Celui de Charpentier, au contraire, est empreint d’une profonde spiritualité. Probablement mis en musique entre 1694 et 1696, il pourrait avoir été composé pour les Jésuites car les deux basse-taille de l’Académie Royale de Musique nommés dans la partition, Jean Dun (16 ?-1745) et Charles Hardouin (16..-17..), interviennent régulièrement dans leur église du Marais. Singulièrement, cette composition dresse le panorama des différents styles de musique vocale sacrée alors en usage. Commençons par les trois premiers versets. Ils exaltent les magna opera Domini (les grands ouvrages du seigneur) sur un mode inspiré de l’alternatim grégorien. Ici, le soliste (haute-contre) et le chœur interviennent en alternance, soit pour se partager le verset initial, soit pour développer successivement les deux versets suivants. Ce pudique balancement des blocs vocaux crée un effet d’hypnose. Les cinq versets suivants portent la marque des arias des cantates ou des oratorios à la façon italienne. Dans une subtile gradation sonore, les solistes célèbrent les œuvres divines. D’abord, la basse salue la miséricorde divine. Loin du Dieu qui suscite la frayeur, Charpentier souligne la tendresse qu’il réserve à ceux qui lui font confiance. Cette phrase délicieusement chantante diffuse un parfum apaisant même si, par le jeu de la répétition, Alain Buet rappelle que cette sérénité est réservée à ceux qui le craignent (escam dedit timentibus se). Sur la même tonalité rassurante, un duo faisant alterner la taille et le haute-contre atteste que Dieu reste fidèle à l’alliance conclue avec son peuple. La répétition d’annuntiabit (il fait connaître) manifeste sa détermination. Un trio salue maintenant, par des vocalises ascendantes, le peuple élu qui a reçu hereditatem gentium (l’héritage des nations) puis rend grâce, sur un ton grave, à la veritas et judicium (fidélité et la justice) que Dieu lui a témoigné. Une fidélité que le chœur magnifie avec des accents de félicité teintés d’un profond respect. Les arias s’ouvrent maintenant à la musique descriptive promue par la seconda pratica italienne. Notamment lorsque, à deux reprises, le chœur caractérise la personne divine par deux vocales : un sanctum (saint) enveloppé d’une douce dévotion et un terribile (redoutable) annoncé par un silence, enflammé par le plein jeu de l’orgue et dramatisé par une ligne vocale enfiévrée. De même, dans le dernier aria, le trémolo des cordes secoue nerveusement timor Domini (la crainte du Seigneur). Enfin, la doxologie évoque le style du motet à grand chœur. Un somptueux finale ouvert par la basse et qui s’achève dans un climat de jubilation générale. En fin de compte, ce motet nous paraît emblématique d’un style kaléidoscopique de Charpentier autant qu’il témoigne de la sincérité de sa religiosité.
L’antienne suivante est la troisième du recueil des Vêpres d’un confesseur non pontife. Du vivant de Charpentier, son texte, extrait de la parabole du majordome qui précède celle des talents dans l’Evangile de Matthieu (24-45), est associé aux vêpres pour la fête de saint Joseph. Le carme Léon de Saint Jean (1600-1671) explique ainsi cette affiliation : « Dieu a établi S. Joseph sur sa propre famille, il en a fait le Premier Ministre et l’Administrateur universel… Il contient éminemment toutes les grâces gratuites et sanctifiantes. Il les verses en tous les membres, il influe la vie, dirige et gouverne toutes les actions » (La somme des Sermons parénétiques et panégyriques, Troisième partie, 1674). C’est manifestement au père de famille que ce Fidelis servus et prudens (Serviteur fidèle et prudent) H 34 entend rendre hommage. Particulièrement, ici, au père de la lignée des Bourbons ? Ce petit motet, composé vers 1692-1693, est destiné à deux solistes (haute-contre et taille), à deux dessus de violon (ici, a priori, deux violes de gambes) et à la basse continue. La partition est caractérisée par une place plus importante accordée aux parties instrumentales. En guise d’ouverture, elles esquissent la ligne mélodique que vont développer les deux chanteurs. Ensuite, les instruments marquètent l’ensemble de la pièce par de tendres et fréquentes ritournelles. Quant aux deux lignes de chant, elles tressent finement et de manière récurrente, deux représentations isolées par le jeu des répétitions : celle du fidelis servus (serviteur fidèle) et celle du super familiam (sur sa famille). Ce qui transforme ce motet d’une grande délicatesse en un émouvant hymne à la Sainte Famille.
Une félicité familiale qui s’élargit à l’échelle de l’Eglise ou du royaume selon que Dominum (le Seigneur) désigne Dieu ou le roi dans l’esprit des auditeurs de l’époque. Cette seconde analogie est confirmée lorsque Jean-Paul Montagnier classe le Psaume 112/111 Beatus vir qui timet Dominum (Heureux l’homme qui craint le Seigneur) dans la catégorie des textes bibliques dont le sens peut être dérivé pour honorer « le Roi, juge de ses sujets et garant de la paix intérieure du royaume ». Ce qui explique d’ailleurs qu’il ait inspiré bien des sous-maîtres de la Chapelle Royale de Versailles. Charpentier n’était pas du nombre. Pour autant, ce texte l’a particulièrement intéressé car cinq versions différentes nous sont parvenues. Celle qui nous intéresse (H 221) a été composée dans la période 1694-1696. Sans doute une commande des Jésuites car Jean Dun et Charles Hardouin, sont, à nouveau, cités dans la partition autographe. Pour mettre en musique ce texte biblique, Charpentier ne se satisfait pas d’une lecture linéaire du texte. Il le relit, nous semble-t-il, au filtre des règles classiques de cette rhétorique si chère aux Pères jésuites. Charpentier recompose donc le Psaume dans lequel nous identifions cinq parties principales : l’exorde (portrait de l’homme heureux) et la péroraison (la doxologie) encadrent un corps de texte dans lequel se succèdent trois périodes oratoires. La première démontre la force tranquille de l’homme heureux. Dans la seconde, les solistes détaillent les obstacles que sa confiance en Dieu lui permet de franchir. La troisième, la plus expressive, exalte sa combativité. Chacune de ces parties brille d’une esthétique singulière.
Reprenons. Pour soutenir musicalement la péroraison, Charpentier opte pour la forme du rondeau. Comme Claudio Monteverdi avant lui (SV 268), l’Incipit devient refrain. Mais, contrairement au Beatus vir du maître italien, la tonalité de son ouverture est méditative et empreinte d’une douce sérénité. Voulait-il souligner que l’homme heureux est d’abord un homme en paix alors que la France souffre alors terriblement de la famine et des guerres ? La première période décrit musicalement le destin de l’homme qui s’extrait des ténèbres pour resplendir dans la lumière. Cette résurrection est figurée par un clair-obscur engloutissant exortum est in tenebris (tiré par les ténèbres) dans un grave lugubre puis propulsant lumen rectis (la lumière se lève) sur une ligne ascendante radieuse. Ce contraste est renforcé, conformément aux consignes du compositeur, par un subtil jeu d’écho sondant l’insondable profondeur de la nuit et un fortissimo duquel fuse l’éclat du jour. Dans cette plénitude retrouvée, le chœur énumère sentencieusement les qualités de cet homme nouveau : misericors et miserator justus (miséricordieux, compatissant et juste). Un homme qui jamais ne chancelle (non commovebitur), insiste le chœur. Dans un certain parallélisme des formes, la seconde période décline les bénéfices auxquels goûtera le beatus vir. En solo (haute-contre) puis en duo (haute-contre et basse), les solistes parviennent finalement à la même conclusion (non commovebitur) dont ils scandent un non fièrement affirmatif. Comme dans un mouvement qui va crescendo, la troisième période apporte une touche dramatique à l’énoncé des arguments. Cette dernière partie est parsemée de passages virtuoses. Ainsi, de redoutables vocalises aiguillonnent dispersit (dispense... des largesses aux pauvres) ou exaltabitur (il dresse… sa tête) lorsque les solistes magnifient la charité de l’homme juste. De même, par des procédés figuratifs remarquablement rendus, le chœur, dans un impressionnant passage piano, contrefait le grincement des dents des méchants et les voue à leur perte dans un fougueux peribit (ils périssent). Enfin, une succession de silences imprime à ce passage une tonalité particulièrement théâtrale. La doxologie jubilatoire suivie d’un Amen contemplatif constitue le point d’orgue de ce discours des béatitudes. L’apogée, aussi, d’un motet techniquement opulent, agrémenté d’un nuancier que les interprètes modèlent avec art et délicatesse.
Dans le Commun des confesseurs non pontifes, l’antienne suivante (Beatus ille servus/ Heureux ce serviteur) poursuit l’éloge du majordome tel que Matthieu (24,46) l’a rapporté. Or, ce verset évangélique n’a pas inspiré Charpentier. Olivier Scheebeli pallie donc l’absence de partition en lui substituant un petit motet dont le texte est celui du Capitule (courte lecture) des vêpres du jour. Et, contrairement à l’usage, il l’assortit d’une Fugue Grave du 1er ton, extrait du même Troisième livre d’orgue de Nivers. Cette courte pièce se conforme parfaitement aux directives que le chanoine Sonnet prescrit pour l’interprétation du chant liturgique. Lente et mensura gravi, écrit-il. En somme, une tonalité pour l’église qui invite à la dévotion et incite à l’introspection. Et c’est bien dans la méditation que nous plonge cette fugue paisible aux accents quasi mystiques.
Au terme de cette brève échappée spirituelle, nous voici immergés dans l’atmosphère de félicité qui se dégage d’un exaltant petit motet pour soliste : Beatus vir qui inventus est sine macula (Heureux est l’homme qui, créé sans péché) H 376. Initialement composé pour les fêtes de deux saints fondateurs de la Compagnie de Jésus (François Borgia et François Xavier), Jacques Edouard (1675 ?-1762), le neveu de Charpentier, le publie dans le premier livre posthume des Motets melêz de symphonie (1709). Preuve, s’il en faut, du pouvoir d’attraction de cette brève célébration de l’homme resté fidèle à Dieu. Les généreuses vocalises de Robert Getchell nous transportent littéralement tandis que la tonalité en si bémol majeur (« magnifique et joyeux » dans la classification de Charpentier) produit un irrésistible effet de plénitude.
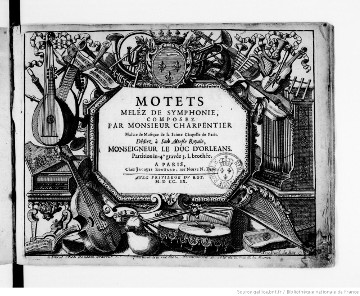
Page de garde du recueil Motets melêz de Symphonie – Gallica/ BNF
Ce motet fait office d’antienne préludant le chant du quatrième Psaume : Laudate pueri Dominum (Louez le Seigneur, vous qui êtes ses serviteurs) H 203. Il s’agit de l’un des vingt-trois Psaumes (sur 150) « élevés au rang des plus essentiels au cérémonial de la Cour », selon le décompte opéré par Jean-Paul Montagnier. Pour Charpentier, en revanche, nul besoin de couvrir le roi de louanges. Son inspiration s’imprègne davantage de l’esprit du texte tel que, par exemple, le résume l’auteur des Pseaumes de David. Traduction nouvelle selon l’Hébreu et la Vulgate (1679) : « David se répand… dans les louanges de Dieu, de ce qu’étant aussi élevé qu’il l’est, il ne laisse pas de rabaisser ses soins sur les moindres choses ». Exactement ce qu’expriment, dès les premières mesures, ces effets de reflets permanents entre le grave et les aigus. Charpentier développe ici ses talents de peintre sonore. L’imposante envergure de la voix d’Alain Buet convoque, dans le premier verset, les pueri Dominum (serviteur du Seigneur), les invitant à louer Dieu. Louanges aussitôt magnifiées par les timbres souples et aériens des pueri (enfants) d’un double chœur des Pages. Louanges qu’universalise enfin un chœur contemplatif dans lequel se miroitent deux traits en duo, l’un associant la basse et le dessus, l’autre le dessus et le haute-contre. Les trois versets suivants (4 à 6) opposent deux images divines : un Dieu souverain et lointain mais pourtant un Dieu attentif aux choses les plus viles. Dans un mouvement d’amplification progressive, la première représentation associe deux solistes, la haute-contre et la basse, avant de laisser le chœur apporter la dernière touche au portrait olympien. La seconde est marquée du sceau de l’humilité. Plus brève, seuls deux soliste, le haute-contre et la taille, suivent le regard compatissant de Dieu sur la misère humaine. Car ce sont plutôt les résultats de cette mansuétude que Charpentier entend célébrer. Il le fera d’abord en donnant de l’ampleur à deux versets (7 et 8). Le chœur y encadre un court passage soliste pour accompagner le miséreux jusqu’au siège qu’il partage désormais avec les princes. Moins solennel mais plus sensible, deux lignes de dessus se joignent au haute-contre pour se réjouir de la guérison de la femme stérile en faisant vibrer un affectueux laetantem (joyeux). Une tonalité affable que saluent également ces délicieuses combinaisons vocales faisant briller une doxologie joviale sans être jubilatoire. Car Charpentier avait parfaitement compris que ce Psaume était un hymne à la Providence divine plus qu’à sa majesté.
Nous retrouvons maintenant le déroulé habituel de la séquence psalmique avec la cinquième antienne composée pour les Vêpres d’un confesseur non pontife. Toujours sur le texte de Matthieu (25,21), Serve bone et fidelis (Serviteur bon et fidèle) H 35 félicite le serviteur habile en affaires. Ecrit pour deux dessus et basse continue, les lignes de chant sont confiées à deux Pages, probablement Alexis Galli et Stéphane Ung. Elles mêlent une voix assurée et une autre, plus frêle dans les aigus. Loin d’être un défaut, cet assemblage couvre ce motet ravissant d’un charmant parfum de naturel. Soutenues par un continuo rieur, ces voix délicates enchantent l’oreille et le cœur. Et, comme si la mélodie comptait davantage que le texte, Charpentier parvient à nous faire oublier la citation évangélique pour nous imprégner de son esprit. Son procédé est ingénieux : il isole les vertus du serviteur (bone et fidelis), nous en nourrit à longueur de motet puis les associe ponctuellement à l’émotion qui s’échappe d’ondoyantes vocalises (gaudium/ joie). L’effet de séduction opère instantanément.
Le cinquième et dernier Psaume (117/116), le plus court de la Bible, n’appartient pas au programme habituel des vêpres du dimanche. Il clôt, en revanche, la liste des Psaumes prescrits pour les Vêpres des confesseurs non pontifes. Ce Laudate Dominum omnes gentes (Louez le Seigneur, toutes les nations) est l’un des préférés de Charpentier car il nous en a laissé six versions différentes. La dernière (H 214), celle qui nous intéresse, date probablement des années 1698-1699. La mise en musique déclenche une dynamique d’amplification graduelle de l’intensité sonore et spirituelle. Ainsi, le premier verset est partagé entre deux solistes (la basse et le haute-contre) qui lui impriment une allure dansante. Dans le mouvement lent qui anime le second (et dernier) verset, les trois solistes prennent le chemin de la méditation. Ils en pétrissent chacun des termes dans un contrepoint fugué imprégné de cette tendresse respectueuse qui caractérise alors les passages évoquant Jésus. Car, explique notre traducteur de Pseaumes de David dans une savoureuse formule teintée d’anachronisme : « David exhorte tous les peuples à louer Dieu de ce qu’il a envoyé Jésus-Christ sur la terre ». C’est seulement à la doxologie qu’il revient d’introduire toute la solennité qu’impose cette prière d’action de grâce. Ce finale adopte, en quelque sorte, une dynamique inverse en trois temps. Dans le premier, le chœur illumine cet épilogue en hommage à la Trinité. Cette révérence est ensuite réitérée en rondo, les solistes interpolant de réjouissants Laudate Dominum dans le cours de la glorification trinitaire. Le motet s’achève sur un Amen dans lequel la liesse générale se convertit en joie spirituelle.

Page de garde du In honorem sancti Ludovici – Gallica/ BNF
Dans le cérémonial vespéral, un hymne et un verset sont chantés après la lecture du capitule. Ils sont remplacés ici par un canticum (ici, synonyme de « motet »). Selon Catherine Cessac, notre In honorem sancti Lucovici Regis Galliae Canticum tribus vocibus cum simphonia H323 pourrait avoir été interprété le 25 août 1679. Un rédacteur du Mercure galant (09/1679) était sur place : « Je reviens à la Fête de S. Louis. Mr Le Brun, premier Peintre de Sa Majesté, qui la solemnise tous les ans avec un zèle particulier, fit chanter une Messe en Musique ce jour-là, dans la paroisse de S. Hyppolite (nota : Le Brun avait dessiné les plans du maître-autel de cette église, aujourd’hui disparue, située dans le faubourg Saint-Marcel). La composition de la Simphonie était de M. Charpentier… (Les tapisseries) furent admirées aussi bien que la Musique ». Cette probable collaboration entre un intime du Roi et le maître de musique de Marie de Guise (1615-1688) ne pouvait qu’influer sur la partition. D’autant qu’en cette même année 1679, Charpentier parvient enfin à s’introduire à la Cour pour y composer la musique des offices du Dauphin. Sans doute avec le secret espoir d’obtenir les grâces du Roi ! Notre motet en l’honneur de saint Louis pourrait donc participer de cette stratégie de séduction des oreilles royales. De fait, pour Catherine Cessac, ce premier des quatre motets composés par Charpentier en l’honneur de Louis IX, est manifestement un hommage en trompe-l’œil rendu au Roi vivant. En témoigne la profusion des Ludovicus triumphet, Ludovicus regnet, Ludovicus vivat (Triomphe, règne et gloire éternelle à Louis) qui couronnent le motet. Un tel rapport d’identification ne doit cependant pas nous surprendre. Car, déjà du côté de l’Académie Française, à partir de 1677, un panégyrique de saint Louis est prononcé tous les 25 août. « Le prédicateur, choisi parmi (ses membres), devait évoquer les qualités de Louis XIV à travers celles de son ancêtre et établir une identité entre les deux règnes » (Matthieu Da Vinha, L’image et le mythe, Presses universitaires de Rennes, 2014). De même, Louis Bourdaloue, (1632-1704), prestigieux prédicateur à la cour, compose une prière à saint Louis dans laquelle il confond les deux Louis : « c’est votre fils, c’est le chef de votre maison, c’est l’imitateur de vos vertus, c’est la vive image de vos héroïques et royales qualités » (péroraison du Sermon pour la fête de saint Louis). Même l’iconographie s’intéresse au lien intime qu’établit la propagande royale entre ces deux souverains. Jusqu’à la fusion, comme dans le Saint Louis sous les traits de Louis XIV recevant la couronne d’épines (1745, Musée d’Arts de Nantes) du peintre Charles-Antoine Coypel (1694-1752).
C’est dans cette atmosphère de représentations allégoriques qu’il convient d’imaginer Charpentier lorsqu’il trace les premières notes sur son papier à musique. Son hommage à saint Louis (la partie centrale) nous paraît reposer sur deux piliers personnifiant Louis XIV. Une brève introduction instrumentale interprétée à l’orgue donne le ton, celui de l’allégresse. Le brillant du registre de la Trompette prélude, en fanfare, l’hommage royal. Dans une forme d’hyperbole, la première partie couvre d’une étoffe éblouissante la fonction royale. Initiée par la basse puis reprise dans sa totalité par le tutti, l’apologie vocale est amplifiée par les orgues qui claironnent le nom de Ludovicum. Le saint ou le régnant ? Sans doute les deux. Ce mouvement alerte s’articule autour de deux termes distingués par d’abondantes vocalises : sonantibus et celebrate. Ils résument, en quelque sorte l’esprit de la fête : proclamez la gloire de Louis. La partie centrale recense les vertus de Louis, le saint. Dans un effet de chatoiement permanent, les solistes et les ritournelles instrumentales portent un regard émerveillé sur ses vertus. Un duo de dessus (le dessus Béatrice Gobin et le bas-dessus Arnaud Raffarin) évoque la justice et l’humilité tandis que la basse se souvient de sa douceur et de sa chasteté. Puis, ce trio commémore le bâtisseur de la Sainte Chapelle et souligne, tout particulièrement, ses combats en faveur de la propagation de la foi. Pour l’auditeur de l’époque, les vocalises appuyées sur l’évocation des croisades extérieures (profide militantem) menées par le saint faisaient probablement écho aux croisades intérieures (contre les protestants mais plus particulièrement encore contre les jansénistes à partir de 1679) conduites par Louis XIV. Enfin, le chœur se saisit de ce bilan édifiant pour en souligner chacun des termes. Cet énoncé méthodique est scandé par des ritournelles instrumentales joliment cadencées. Dans un nouveau mouvement d’amplification, la péroraison entame, cette fois sans ambiguïté, un hymne à la gloire de Louis XIV. Un soliste du dessus ouvre cet hommage. Un trio associant les deux voix du dessus et la basse, le prolonge. Tandis que les croches exaltent les triumphet, regnet, vivat des voix du dessus, la basse les affermit par de longues tenues de note, à la manière d’un cantus firmus. Enfin, un tutti enflammé couronne ce chant de louange dans une déflagration de vivat. Le Roi Soleil règne, enveloppé de lumière et de sons.
Un faste bien éloigné de l’humilité que professent ensemble, la Vierge Marie et son fervent adorateur, Louis IX ! Car saint Louis voue un véritable culte à Marie. Un exemple tiré de sa légende dorée suffira à mesurer l’intensité de sa vénération mariale. Tous les samedis, jour traditionnellement consacré à la Vierge, il invitait des pauvres à sa table après leur avoir lavé les pieds. C’est précisément l’esprit de ce culte royal à l’humble servante de Dieu que ce Canticum B.V.M. (motet à la Beata Virginis Mariae) H 76 nous paraît réverbérer. Le grandiose de la piété royale imprimé par le chœur se confond avec la piété révérencieuse des parties solistes. En choisissant d’entonner ce Magnificat sur le cinquième ton ecclésiastique, Charpentier entendait probablement l’associer à un affect que Pierre-Benoît de Jumilhac décrit ainsi : « le cinquième (ton)… est semblable au son d’une trompette non pas qu’il appelle au combat, mais qui chante la victoire ; de sorte qu’il est rempli d’allégresse… propre à recueillir l’esprit et à le retirer des soins et embarras de la terre ». Sur un tempo enjoué imprimé par le continuo, le haute-contre enlumine le premier verset dans un exsultavit orné d’arabesques. Puis, par l’enlacement caractéristique de l’écriture en imitation, la basse et le haute-contre lèvent le voile sur la conception virginale du Christ. Un acte de foi que relaye cérémonieusement le chœur avant de se prosterner devant celui dont le nom est saint (sanctum nomen est). En alternance, le trio de solistes et le chœur décrivent maintenant les œuvres divines. Ici, l’imitation et la répétition symbolisent l’infini de la miséricorde divine (a progenie in progenies/ d’âge en âge). Puis, le chœur en célèbre la puissance dans un robuste passage homophone tandis qu’il disperse les orgueilleux en faisant tourbillonner des rafales de croches.
Ce même jeu de contrastes est reproduit dans le verset suivant quand le renversement des puissants s’accomplit au son des pénétrants accords amplifiés par le plein-jeu de l’orgue alors que les humbles exultent, exaltés par d’ardentes doubles croches. Effet encore plus subtilement rendu dans cet étonnant jeu de miroir auquel s’adonnent les solistes et le chœur : quand les premiers évoquent des situations (les affamés/ essurientes, les riches/ divites), le second énonce le sort que Dieu leur réserve (les uns sont comblés/ implevit bonis alors que les autres sont renvoyés les mains vides/ dimisit inanes). Avec, de plus, ce pittoresque petit jeu d’écho qui, dans une répétition de inanes, matérialise la vacuité de la fortune des riches. Le traitement réservé au dernier verset, le plus développé par Charpentier, n’est qu’un témoignage supplémentaire de sa parfaite maîtrise de l’écriture expressive. Ainsi, pour singulariser la miséricorde divine, le chant du soliste coule sur un tempo apaisé, bienveillant, presque affectueux. En revanche, dans une fugue exubérante, le chœur proclame la promesse faite à Abraham. Une fougue qui déborde sur la doxologie. Comme pour établir une jonction entre l’Ancien et le Nouveau Testament, entre Abraham et la confession de foi trinitaire de l’Eglise. De fait, ce Magnificat apparaît comme un chant qui préfigure une victoire. Pour Marie, dont la conception va permettre une prochaine victoire contre le Mal. Pour le croyant, qui surmontera les difficultés grâce au secours que lui apportera la Vierge. L’un et l’autre justifient donc bien l’emploi du 5ème ton.
Après le Magnificat et différentes antiennes, Martin Sonnet inscrit au programme musical un Inviolata ab organis. Nivers propose-t-il ici son Prélude du 2ème ton en lieu et place de cette courte pièce mariale ? Peut-être, si l’esprit de cette pièce d’orgue est de solliciter l’intercession de Marie. Car, explique Jumilhac, ce ton « est propre à exprimer l’aversion que l’on a du mal ; à exciter à la douleur et à la pénitence des péchés, à déplorer les misères de cette vie et à modérer ou apaiser la colère ». Nivers, une fois de plus, fait dialoguer le Positif et le Grand plein jeu. Un échange quelque peu tourmenté, agrémenté de fréquentes coulades mais toujours soutenu par des accords, soit à la main droite, soit à la main gauche. Un véritable remède contre le mal tant l’allure générale dessine le portrait de la Vierge de miséricorde.
Une majesté consacrée par l’un des vingt-cinq Domine salvum fac regem (Dieu préserve le roi) que nous a transmis Charpentier. A l’époque, cet hymne royal constitue le point d’orgue de tout office religieux dans le royaume de France. Charpentier mêle, dans ce dernier verset du Psaume 20/19, la ferveur et la déférence. L’ardeur, d’abord, se traduit par une explosion des coloris résultant de combinaisons vocales sans cesse changeantes. Entonné par un soliste, poursuivi par un trio, il est enflammé par l’embrasement du tutti. Les lignes de chant se conjuguent, se défont pour se recomposer dans un éclatant artifice sonore. Pourtant, le finale s’incline dans une supplication révérencielle caractérisée par un tempo grave et un tutti implorant. Remarquons, enfin, que ce chant final est dépourvu de doxologie. La Trinité s’efface donc devant un roi qui n’est plus le saint de la fête, mais le souverain qui trône en majesté dans son palais de Versailles.
C’est dans ce climat soudainement apaisé que le CD nous plonge dans le silence. Un silence propice au bilan. Un bilan flatteur, à bien des titres.
D’abord, nous voudrions rendre hommage à Olivier Schneebeli. Certes, pour ses choix musicaux qui nous permettent de savourer des pages de Charpentier qui n’appartiennent pas forcément au répertoire habituel des concerts. Plus encore pour les résultats remarquables de sa longue et patiente action pédagogique auprès de ces enfants et adolescents qu’il transforme en passeurs des beaux sons du passé. Leur maîtrise vocale et l’harmonie du collectif sont une gourmandise pour nos oreilles. Mais encore, et surtout, pour le choix du grand orgue de la Chapelle Royale de Versailles. Nous lui sommes particulièrement reconnaissant d’avoir écarté ces « coffres de bois d’où sort un petit pépiement » (comme le souligne fort justement Jean-Paul Combet dans le propos d’ouverture du livret du CD distribué par le label Alpha en 2004). Le grand orgue apporte un supplément d’âme et beaucoup d’ampleur à cette interprétation. Il nous permet surtout de nous rapprocher des sons entendus à l’époque de la création de ce chapelet de motets.
Pour en goûter l’excellence, l’auditeur dispose de deux versions. Un produit économique, véritable délice pour les oreilles mais qui laisse désespérément l’esprit au repos. En effet, cette version dont nous rendons compte ici propose un livret dans son plus simple appareil : la liste des plages et des interprètes à laquelle s’ajoute une présentation « grand public » de Catherine Cessac. Si la version plus ancienne offre le même plaisir à l’écoute, elle régale l’esprit grâce à une analyse fine de l’opus et de son contexte. Et surtout, elle livre les paroles chantées et leur traduction par des auteurs contemporains de Charpentier. Paroles sans lesquelles, nous semble-t-il, on ne fait qu’écouter sans comprendre.
L’esprit rassasié, les oreilles comblées, l’auditeur rangera, comme nous le faisons, ce CD dans ses favoris. Favori pour la beauté des airs, l’écriture inventive et l’intensité spirituelle qui s’en dégage. Favori pour la justesse des voix, leur art des nuances et leur science de l’alchimie musicale qui transforme les notes et les mots en émotions. Favori pour la précision des instrumentistes, à la fois parfaits auxiliaires et précieux partenaires des voix. Particulièrement Frédéric Desenclos qui sublime ces motets, leur donne puissance et profondeur. Favori parce qu’entendre les Pages et les Chantres du CMBV est toujours un plaisir autant esthétique que physique.
Publié le 15 juil. 2021 par Michel Boesch
 ©
©