Demoiselles de Saint-Cyr
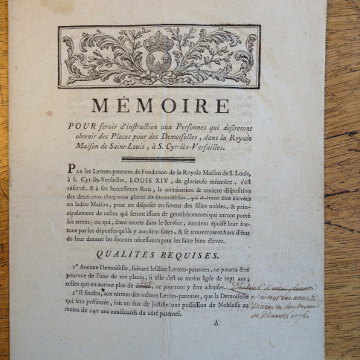 ©Archives Nationales
©Archives Nationales Afficher les détails Masquer les détails Date: Le 29 janv. 2016
Lieu: Chapelle royale - Versailles
Programme
- Pascal Collasse (1649-1709) – Les Cantiques spirituels (sur un texte de Jean Racine)
- Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714) – O sinus admirabilis - Beata es Maria Regina caeli - Magnificat du 6ème ton
- Louis-Nicolas de Clérambault (1676-1749) – Domine salvum fac regem
Distribution
- Orchestre : La Rêveuse
- Stéphan Dudermel, Olivier Briand - violons
- Serge Saitta, Olivier Riehl - traversos
- Florence Bolton - basse de viole
- Benjamin Perrot - théorbe
- Fabien Armengaud - orgue et clavecin
- Direction : Olivier Schneebeli
- Chœurs : Les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles :
- Vingt et un Pages, dont trois solistes principaux
- Et Clémence Carry, Jeanne Lefort, Danaé Monnie et Fanny Valentin - chantres-sopranos
Honneur aux musiciens de la maison Saint-Louis de Saint-CyrN’y avait-il pas une pointe d’inconvenance à proposer un concert « sans tambours ni trompettes » dans le cadre éblouissant de la chapelle du Roi Soleil ? Préjugé, a répondu
Olivier Schneebeli en faisant résonner les
Musiques pour Saint-Cyr sous les voûtes de ce lieu de prières et de célébrations que Louis XIV connut cinq années seulement avant d’achever son long règne. Sous sa direction attentive et énergique, le chef d’origine suisse a fait des merveilles avec un effectif orchestral réduit, un chœur composé de jeunes enfants et des solistes juste lancés dans la carrière musicale. Ensemble, ils ont façonné une musique d’une beauté presque intime, en contraste avec le cadre solennel dans lequel ils avaient pris place. Mieux encore : le maître a su exploiter toutes les ressources offertes par cet espace pour jouer avec les sonorités et composer des alliances de couleurs vocales. Ainsi, lors de l’exécution du
Regina caeli de
Nivers, une partie des Pages intervenait du haut de la tribune d’orgue, tout comme le firent les Chantres pour l’interprétation de son
Magnificat. De même, il repositionne les choristes pour ce
Magnificat, les filles au centre et les garçons des deux côtés, pour mieux mettre en valeur les nuances de leurs timbres respectifs. La conviction manifestée et l’énergie déployée par tous ces interprètes a séduit un public mis en relation avec un répertoire rarement entendu et dont la discographie est singulièrement pauvre.
Le programme de ce concert invitait à goûter à des œuvres composées par trois musiciens attachés de près (
Nivers,
Clérambault) ou de plus loin (Collasse) à la maison de
Saint-Cyr. Ce pensionnat pour jeunes filles de la noblesse pauvre tient une place centrale dans la musique du Grand Siècle. D’abord, parce que sa fondatrice,
Madame de Maintenon, est l’épouse secrète du Roi depuis la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683. A ce titre, elle exerce une forte influence sur les goûts musicaux de son royal époux. Plutôt attiré par la luxuriance des airs et la légèreté des maximes déployées dans les opéras à la mode de
Lully, le Roi finit par se convertir à la musique religieuse, aux sonorités plus dépouillée et aux paroles plus sévères. Cette rupture, certes progressive, est également sensible dans le répertoire de la maison de Saint-Cyr. « Institut-vitrine de la couronne », cet établissement se devait d’être exemplaire (Anne Piejus –
Madame de Maintenon et l’évolution de la musique à Saint-Cyr. In :
Albineana, Cahiers d’Aubigné, 10/11/1999).
Le chant y tient une place importante. Dans sa préface à sa pièce
Esther (1689),
Racine en témoigne : « On a soin aussi de faire apprendre à chanter à celles qui ont de la voix, et on ne leur laisse pas perdre un talent qui peut les amuser innocemment et qu’elles peuvent employer un jour à chanter les louanges de Dieu ». Mais cette activité n’était pas aussi innocente qu’il l’affirme si l’on en croit le scandale qui a suivi les représentations d’Esther. Les succès remportés par ces représentations ont rendu certaines pensionnaires « fières et hautaines, ne goûtant que l’esprit et les choses les plus raffinées, dédaignant la simplicité et la docilité » (
Lettre de Madame du Pérou). Aussi, le répertoire change-t-il radicalement dans les années 1689-1691. D’abord écarté pour les risques qu’il comportait, le chant revient en faveur, mais surtout pour animer les offices religieux (Nivers) et soutenir les textes édifiants tels que des cantiques spirituels (
Collasse). C’est dans cette ambiance sonore particulière qu’Olivier Schneebeli nous a plongés en ce soir du 29 janvier 2016.
Les quatre
Cantiques spirituels constituent l’ossature du programme. Aussitôt écrits, ils ont été mis en musique par
Jean-Baptiste Moreau (Cantiques I, III et IV) et
Michel Richard de Lalande (Cantique III). Le Roi a d’ailleurs « été fort content de M. Moreau » (
lettre de Racine à Boileau du 3 octobre 1694). Dès l’année suivante paraît une nouvelle version musicale des
Cantiques, celle de Pascal Collasse. La composition de cet ancien collaborateur de Lully annonce le style des cantates françaises pour petits ensembles. Dans sa dédicace à Madame de Maintenon, il signale que le thème « règne toujours dans la partie la plus haute » et que, par conséquent, ses
Cantiques peuvent se chanter à une seule voix, à deux et même à trois, le « troisième dessus » pouvant même être confié, en concert, à un Ténor. (Denise Launay –
La musique religieuse en France du concile de Trente à 1804 – p. 458). Cette précision indique que Pascal Collasse visait un public bien plus large que les seules demoiselles de Saint-Cyr. Le début du cantique
A la louange de la Charité est déclamé par une jeune Page avec un phrasé classique parfaitement maîtrisé. Pour célébrer cette vertu théologale et condamner les « Vices, enfants de l’Orgueil », les solistes s’attachent, avec une diction parfaite, à « émouvoir et convaincre », se mettant ainsi au service de la fonction rhétorique de la musique baroque rappelée par Olivier Schneebeli lors d’un entretien qu’il accorda le 6 avril 2014. Les violons scintillent, les voix s’envolent avec une belle uniformité. Dans un court passage, le théorbe et une soliste touchent le cœur des auditeurs en dialoguant sur le vers « Je livrerais mon corps aux flammes ». Le second cantique,
Sur le bonheur des Justes, et sur le malheur des Réprouvés, est porté par la voix cristalline des solistes. Ils nous font ressentir successivement le bonheur des Sages et les supplices infligés aux orgueilleux.

Dans le troisième cantique,
Plaintes d’un chrétien sur les contrariétés qu’il éprouve au-dedans de lui-même, la succession de silences et de reprises parfaitement coordonnés souligne le caractère tourmenté de l’homme écartelé entre l’amour de Dieu et l’attachement aux plaisirs terrestres. « Hélas » est crié de façon saisissante et le final « De cet esclave de la mort » fortement appuyé dans un bel ensemble. L’interprétation de ce cantique est riche en nuances d’expression et de couleurs, remarquablement rendues par les interprètes. Dans le quatrième cantique,
Sur les vaines occupations des gens du siècle, se succèdent des récitatifs aériens, des appels plaintifs lancés par des solistes accompagnés des deux violons et des séquences polyphoniques plus enlevées, notamment dans la seconde moitié du cantique « O Sagesse, ta parole fit écore l’Univers ». Cette partie a d’ailleurs été reprise en fin de programme, avec peut-être plus d’enthousiasme encore, comme encouragés par un public conquis.
Quatre pièces de Nivers se glissent entre chacun de ces
Cantiques, comme pour ménager une transition. Avec elles, nous pénétrons dans l’ambiance liturgique de cette fin du XVIIème siècle. Nivers est considéré comme le fondateur de l’école d’orgue française. Mais c’est un autre volet de son activité que nous découvrons, celui du maître de chant et de l’auteur de recueils de plain-chant (grégorien) et de motets destinés à différents couvents de religieuses, ainsi qu’à Saint-Cyr où il officie. Dans son
O sinus admirabilis alternent des parties de solistes et de chœur. La tonalité est aérienne. Le rythme est commandé par le texte, parfois méditatif, ailleurs plus enlevé. Le motet s’achève sur un final lumineux. Le
Beata es Maria invite davantage au recueillement, voire à la dévotion, notamment lors du passage chanté a capella. Le
Et mortis eieus est quasiment douloureux, contrastant avec les manières habituellement moins graves d’interpréter ce chant d’action de grâce à la Vierge Marie. La tonalité du
Magnificat est également dépouillée, un peu comme celui de
Charpentier mais bien loin de l’explosion sonore du chef d’œuvre de Bach. Avec ces quatre pièces, Nivers semble avoir respecté scrupuleusement les consignes d’une Madame de Maintenon indignée par ces couvents qui font « de leur église un opéra ». Il nous plonge dans une atmosphère pieuse, rigoureuse, évitant toute fantaisie vocale pour encourager à la contemplation. Les instruments choisis (basse de viole, théorbe, traversos, clavecins … à l’exception de deux violons) appuient cette intention de favoriser la méditation. En effet, ils sont encore considérés à cette époque comme des « instruments de repos destinés aux plaisirs sérieux et tranquilles, et dont la languissante harmonie est ennemie de toute action » (James R. Anthony –
La musique en France à l’époque baroque – p. 374). Ils doivent soutenir la voix et inviter à la piété intérieure.
Le programme s’achève sur un court motet
Domine salvum fac regem composé par Clérambault. Celui-ci succède à Nivers comme organiste et maître de musique à la maison de Saint-Cyr, en mars 1715. Cette pièce est essentielle dans la liturgie d’Ancien Régime. Elle s’inscrit dans une tradition multiséculaire de prière pour le roi, prière chantée lors de la célébration de la messe dans les églises de France. Au point d’être qualifiée « d’hymne national et royal » français (Wikipédia). Son interprétation mêle solennité et recueillement, dans un jeu d’une grande simplicité lorsque l’orchestre suspend son accompagnement.
Mesuré à la chaleur des applaudissements, le directeur et ses musiciens ont remporté un succès à un double titre. D’abord, par la qualité remarquable des interprètes. Le talent des instrumentistes, conjugué à la diction parfaite et à la justesse des voix des choristes et des solistes, a permis au public de pénétrer à l’intérieur d’œuvres réputées difficiles. Ensuite, parce qu’une bonne partie du public a partagé le plaisir de la découverte de partitions injustement oubliées. C’est d’ailleurs tout le mérite du
Centre de musique baroque de Versailles de réveiller ce patrimoine endormi de l’histoire de notre musique. Mentionnons enfin que ce concert a été enregistré par France Musique : la date de sa diffusion n'est pas connue à ce jour.
Publié le 04 févr. 2016 par Michel BOESCH
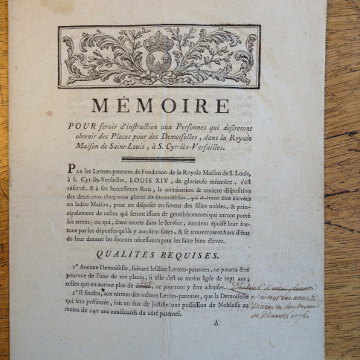 ©Archives Nationales
©Archives Nationales 