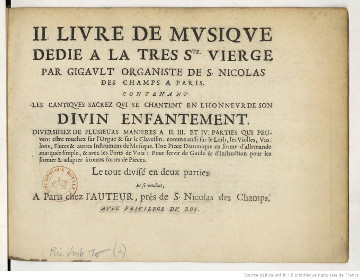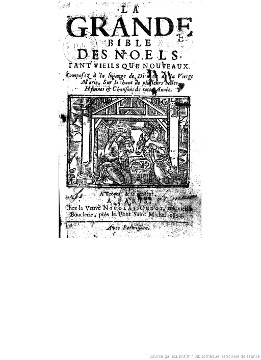Messe de Minuit - Charpentier
 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Date: Le 19 déc. 2021
Lieu: Chapelle Royale du château de Versailles
Programme
- Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) : Messe de Minuit
- Sub tuum praesidium H 28
- Or nous dites Marie (Ballard)
- Quam gloriosa dicta sunt de te (extraits) H 400
- In nativitatem Domini cantatum H 416
- Nuit (instrumental extrait de Dialogus inter angelos et pastores Judae) H 420
- O miraculum (Sébastien de Brossard)
- Messe de minuit - Kyrie
- Messe de minuit - Christe
- Messe de minuit - Kyrie
- Joseph est bien marié (instrumental) H 534
- Messe de minuit - Gloria
- Alma redemptoris H 44
- Messe de minuit - Credo
- Laissez paître vos bêtes (instrumental) H 534
- Te Deum H 147
- Messe de minuit - Sanctus
- Messe de minuit - Agnus Dei
Distribution
- Ensemble Correspondances :
- Dessus : Caroline Weynants, Caroline Bardot, Perrine Devillers, Marie-Frédérique Girod
- Hautes-contre : Vojtech Semerad, David Tricou
- Tailles : Antonin Rondepierre, Thibault Givaja
- Basses : Etienne Bazola, Alexandre Baldo
- Violon 1 : Simon Pierre
- Violon : Josèphe Cottet
- Basse de violon : Hager Hanana*
- Viole : Mathilde Vialle*
- Violone : Etienne Floutier*
- Hautbois : Renata Duarte
- Flûtes : Lucile Perret, Matthieu Bertaud
- Basson : Isaure Lavergne
- Théorbe : Thibaut Roussel*
- Orgue : Mathieu Valfré*
- * : continuo
- Direction et clavecin : Sébastien Daucé
Charpentier, l’enchanteur de NoëlFéerie pastorale. Hommage à l’humilité dans un écrin de majesté. Il y a tant de beauté dans la simplicité, semblent professer, de concert, Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) et son magistral serviteur, Sébastien Daucé. En cet après-midi du 19 décembre 2021, la Chapelle Royale de Versailles resplendit de tous ses marbres pour servir de théâtre à une étable. Une scène imaginaire sur laquelle prend place une magnifique troupe de conteurs : les musiciens et les chanteurs de l’Ensemble Correspondances. Ils ont fait le voyage de Caen pour nous faire revivre le récit de la Nativité tel qu’il aurait pu résonner rue Saint-Antoine, à Paris, au crépuscule du « Siècle de Louis XIV ».
Plus exactement, en l’église Saint Louis, la chapelle de la maison professe des Pères Jésuites. Un lieu de culte mais aussi de mondanités où « l’on entend autant de beaux sermons qu’en aucun lieu de France (et où) on n’entend jamais Vêpres, qu’une partie n’en soit chantée par l’Opéra ». Au point, poursuit Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville (1674-1707), que cette église « est si bien l’Eglise de l’Opéra, que ceux qui ne vont point à l’un, s’en consolent en allant en l’autre » (Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise, Troisième partie, février 1706). De fait, on s’y bouscule pour s’émerveiller des homélies de Louis Bourdaloue (1632-1707), surnommé « roi des prédicateurs, prédicateur des rois ». Ou se laisser emporter par les harmonies du « plus profond et le plus savant des musiciens modernes » comme Sébastien de Brossard (1655-1730) qualifie Marc-Antoine Charpentier (Catalogue des livres de musique théorique et prattique, 1724).
En 1694, l’année estimée de la création de notre Messe de Minuit à 4 voix, flûtes et violons pour Noël (Mélanges autographes, volume 25), Charpentier tente d’effacer le souvenir de son passage furtif sur les planches de l’Académie Royale de Musique (Médée, créé le 4 décembre 1693). Vilipendé par les lullystes traditionalistes, il fut déclaré « compositeur barbare » pour avoir voulu changer le « goût de musique naturelle » de Jean-Baptiste Lully (1632-1687) et « ne plus faire que de la musique très difficile », observent François (1698-1758) et Claude (1705-1777) Parfaict dans leur manuscrit relatant l’Histoire de l’Académie Royale de Musique. Au point que, poursuivent-ils, « Charpentier abandonna absolument le français pour composer en latin ».
Et c’est bien en latin que Charpentier va commémorer, en cette vigile de Noël, l’événement fondateur de la tradition chrétienne. Au XVIIème siècle, la célébration de Noël devient un temps fort du calendrier liturgique. Autant pour des questions religieuses que politiques, d’ailleurs. Car, pour les catholiques, elle offre un remarquable terreau spirituel pour affirmer le culte de la Vierge (en réaction à la théologie protestante) et imposer la thématique familiale (celle de Jésus étant érigée en modèle social du foyer chrétien). De fait, « entre tous les mystères de notre Evangile, il n’y en a pas un auquel nous apportions plus de dévotion qu’en la Nativité de Notre Seigneur » constatait déjà le magistrat Estienne Pasquier (1529-1615) dans ses Recherches de la France (Livre 4, chapitre XVI, 1621). Et de poursuivre : « En ma jeunesse, c’était une coutume que l’on avait tournée en cérémonie, de chanter tous les soirs presque en chaque famille des noüels, qui étaient chansons spirituelles faites en l’honneur de notre Seigneur. Lesquelles on chante encore en plusieurs églises pendant que l’on célèbre la grand’messe le jour de Noël, lorsque le prêtre reçoit les offrandes ».
Coutume à laquelle l’Eglise s’empresse de mettre un frein, en réaction aux débordements que suscite l’intrusion du profane dans le périmètre sacré de la liturgie. « Pour ôter tout sujet de distraction durant le divin service, nous faisons très-expresses défenses à tous curez et supérieurs des églises, sur peine d’excommunication, de faire ou souffrir… durant le service du jour de Noël chanter aucunes chansons » décrètent les Règlements faits de l’autorité de Monseigneur…cardinal de Retz, évêque de Paris (1er janvier 1620). Une directive diversement respectée. Ainsi, Marie de Rabutin-Chantal dite Madame de Sévigné (1626-1696) n’oubliera « jamais l’étonnement que j’eus quand j’y étais à la messe de minuit, et que j’entendis un homme chanter un de nos airs profanes au milieu de la messe : cette nouveauté me surpris beaucoup » (lettre à sa fille, 3 janvier 1676). D’ailleurs, la Cour ne brille pas par son exemplarité si l’on en croit le mémorialiste Charles-Philippe d’Albert de Luynes (1695-1758). A la Cour, « ce jour (de Noël), la musique exécute toujours des noëls pendant la première messe, ensuite un motet, après quoi les noëls recommencent » rapporte-t-il dans ses Mémoires du duc de Luyne sur la Cour de Louis XV (Tome 2, 1860).
Partout, des tactiques de contournement des interdictions canoniques sont élaborées. A commencer par les organistes. Les paroles des chansons de Noël populaires sont prohibées ? Qu’à cela ne tienne. On fera sonner leurs airs. Le premier, Nicolas Gigault (1627-1707), « organiste de Saint-Nicolas-des-Champs, a trouvé moyen de donner (aux noëls) un tour particulier qui les renouvelle et qui les rend très agréables à être touchés, non seulement sur l’orgue et le clavecin, mais aussi sur les violes, violons et flûtes » annonce le Mercure galant (octobre 1683). De même, bien avant les Noëls en trio avec carillon pour les flûtes, violons et hautbois composés par Michel-Richard de Lalande (1657-1726), Charpentier aura donné une forme concertante à ses Noëls pour les instruments (vers 1693).
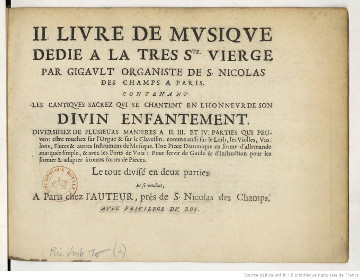
Nicolas Gigault, IIème Livre de musique dédié à la Très Ste Vierge, 1683, Gallica, BnF
Mais pourquoi ces chants populaires font-ils l’objet de tant de réserves ? L’abbé Antoine Arnaud (1827-1920) nous éclaire dans un article encyclopédique publié dans le Dictionnaire liturgique, historique et théorique du plain-chant et de la musique d’église (1854) sous la direction de Joseph d’Ortigue (1802-1866). Nous résumons son propos, bien plus détaillé et documenté. « L’usage des cantiques vulgaires qui se chantent en bien des provinces la nuit de Noël dans les églises… prit son origine environ dans le temps où le peuple cessa d’entendre le latin (au IXème siècle)… Il eût bientôt perdu le sens des mystères… si quelques-uns des usages liturgiques… n’avaient pas été remplacés quelquefois… par des pièces en langue vulgaire... C’est à cette sage tolérance qu’il faut assigner l’origine du noël… Cette espèce de cantique, d’un genre simple, familier et naïf excitait un engouement d’autant plus vif qu’il répondait à un besoin général, et que le peuple voyait s’y refléter, dans sa langue maternelle, tout à la fois l’objet de ses croyances religieuses, et la nature de son intelligence… Le noël prit peu à peu une physionomie… (et un) cachet de terroir qui constituait son individualité propre. Gravé par le chant dans toutes les mémoires, du temple il venait s’installer avec ses enseignements de vertu et de concorde au foyer domestique, où le père l’apprenait à ses enfants… Mais insensiblement (le noël) reçut l’empreinte des mœurs, des habitudes, des usages, de la manière de sentir et de parler des populations auxquelles il était destiné… Lors de cette première transformation du noël, les sentiments qu’il exprimait reproduisait la naïveté des mœurs épurées par la religion, leur simplicité, leur vulgarité même, (mais) n’offrait rien de discordant avec le caractère pieux et contenu qu’il tenait de la source où il avait puisé son inspiration… Mais une phase nouvelle s’ouvrit ensuite. Quand les mœurs se modifièrent par la marche des idées… Dès ce moment le noël, sans perdre le cachet religieux de ses origines,… se montra tour à tour alerte, familier, narquois, hardi et même quelque peu malin…. Le noël s’éloigna insensiblement de son institution primitive, et se dépouilla souvent du caractère religieux, pour chanter des sujets profanes ».
D’autant que la simplicité de sa poésie naïve se greffe, dès le XVème siècle, sur l’air de chansons à la rusticité joviale. Souvent, des « Vaux de Villes (= airs prisés et populaires, faciles à chanter) ou des Airs communs et que tout le monde sçait », explique Sébastien de Brossard dans son Dictionnaire de Musique (1703). Notamment des chansons à danser ou à boire. Même des chansons grivoises lorsque Clément Janequin (1485-1558) parodie la chanson malicieuse Il estoyt une fillette/ Qui vouloit sçavoir le jeu d’amours pour la transformer en un noël fringant : Il estoyt une fillette/ Que le filz de Dieu voulut aimer (vers 1540). Cette pratique se développe au XVIIème siècle. Dans l’Avis aux âmes pieuses ouvrant son volume de Noëls nouveaux et cantiques spirituels nouvellement composés et mis en lumière sur les plus beaux airs de Cour et chants de ce temps (1665), François Collet (1628-1680 ?) en explique le mode opératoire : « je me suis avisé de convertir ces chansons de dissolution et de débauche que l’on oit tous les jours dans la ville de Paris, en Cantiques de piété ; afin que ceux qui ont offensé Dieu par le chant mélodieux de ces airs impudiques, se servent des mêmes airs pour le louer et pour reconnaître en même temps leur crime ».
Au cours des XVème et XVIème siècles, dans la plupart des provinces de France, des recueils de noëls sont imprimés à profusion. Tels ces Cantiques de noëls anciens les mieux faicts et les plus requis du commun peuple mis sous presse vers 1590 au Mans ou La grande Bible des Noëls tant vieils que nouveaux que Pierre Binard fait imprimer à Paris en 1699. L’un et l’autre nous livreront la plupart des textes des noëls utilisés par Charpentier dans sa Messe de minuit avec, souvent, la référence de la chanson populaire à laquelle ils empruntent la mélodie.
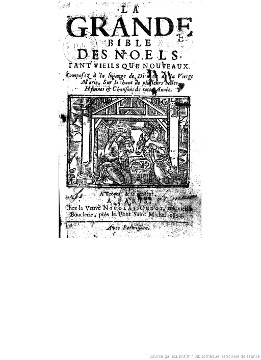
La grande Bible des Noëls tant vieils que nouveaux, 1699, Pierre Binard, Gallica, BnF
Si, par le canal des colporteurs, ces textes imprimés se faufilent dans les chaumières, ils pénètrent également des salons mondains déjà acquis aux bergeries depuis le succès des romans pastoraux. Certains d’entre eux sont si couramment chantés que leurs incipits s’insinuent dans le registre familier des épistoliers. Ainsi, Madame de Sévigné « loue le torticolis qui vous (sa fille) a empêché d’avoir la fatigue de manger avec ces gens-là ; vous avez fort bien laissé paître vos bêtes sans vous » (lettre du 3 janvier 1676). Près d’un siècle plus tard, Voltaire (1694-1778) adresse à Marie de Vichy de Chamrond, marquise du Deffand (1696-1780) un Noël pour un souper à sa façon. « Tout le monde fait aisément des noëls malins, parce que tout le monde les aime, mais on n’a jamais fait de noëls galants à la louange de personne, pas même à celle de la Sainte Famille, dont tous les chrétiens sont convenus de se moquer à la fin de décembre » (lettre du 2 décembre 1774). Il y joint un texte à entonner en chœur : Laissez paître vos bêtes/ Vous messieurs qui ne l’êtes pas. Comme l’analysera l’abbé Arnaud, « l’esprit français, (étant) dégagé des étreintes de l’ancienne civilisation », les noëls traditionnels les plus connus s’invitent désormais à la table des réveillonneurs.
Tel n’était, bien évidemment, pas l’esprit dans lequel Charpentier opère la fusion d’onze timbres (= dessins mélodiques) de noëls populaires avec les textes latins de l’ordinaire de la messe. Il n’est cependant pas le premier à tenter l’expérience. En 1694, Guillaume Minoret (1650-1720), sous-maître pour la Chapelle Royale de Versailles depuis le 1er juillet 1683, avait composé une Missa pro tempore Nativitatis Domini empruntant leur mélodie à neuf noëls populaires. L’un et l’autre s’inscrivent dans le prolongement d’une tradition née avec la Renaissance : celle de la missa parodia. Au lieu de puiser son matériel thématique dans le plain-chant, la « messe parodie » superpose un texte liturgique et une musique empruntée à une pièce préexistante : un motet, un madrigal ou une chanson profane, tous bien connus des fidèles. Ainsi, Clément Janequin, curé d’Unverre (Perche) qui préfère la chanson à la musique d’église, nous laisse deux messes. Toutes deux se greffent sur deux airs profanes qui décident de leur titre : la Missa la Bataille (1532) et la Missa L’Aveuglé Dieu (1554).
Pour achever cette brève généalogie de notre Messe de minuit, examinons l’instrumentarium retenu par Charpentier. Hormis les voix, il cite les flûtes et les violons. Ces deux instruments vont envelopper la liturgie d’une souriante tonalité pastorale. Pourquoi ces deux instruments ? Pour Amédée Gastoué (1873-1943), l’explication pourrait se nicher dans un nouvè (noël) extrait d’un manuscrit d’Avignon. « Des enfants de chœur s’en allant, suivant la mode du temps, saluer (moyennant quelques piécettes) les statues de la Vierge et de l’Enfant placées au-dessus des portes et des façades de maisons » s’équipent d’instruments en suivant les instructions de leur Maître : « Sortez la basse et le dessus de viole ; pour le cornet, nous ne le voulons plus, nous disons qu’il fait trop de bruit ; nous ferons mieux d’emporter avec nous la flûte, qui a un son si doux, et qui, pour sûr, plaît à tous. J’ai fait marcher le clavecin. La trompette et le tambourin pourraient réveiller le Dauphin (l’Enfant Jésus) ; le luth fera mieux son devoir » (L’Eglise et la musique, 1936). Sans le vouloir, Amédée Gastoué vient d’énumérer la plupart des pupitres qui composent l’orchestre constitué par Sébastien Daucé pour nous enchanter en ce dernier dimanche avant Noël 2021.
Son programme, en revanche, déborde du cadre strict de notre Messe de Minuit (H 9). Il se répartit en deux temps séparés par un entracte : une veillée suivie de la messe de la nuit proprement dite. Elle-même panachée de divers motets qui, s’ils lui font perdre son caractère sincère et naïf, plaident en faveur du mariage des musiques populaire et savante.
La veillée est placée sous le double patronage de la Vierge Marie et de Marie de Guise (ou de Lorraine) (1615-1688) pour laquelle Charpentier a composé au moins deux des quatre pièces interprétées. Elle s’ouvre sur une adorable Antiphona sine organo ad Virgine (Antienne sans orgue (= sans basse-continue) pour la Vierge), plus connue (et inscrite comme tel dans le livret programme) sous son incipit : Sub tuum prasesidium (Sous l’abri de ta miséricorde) H 28. Cette antienne chante a cappella un texte retrouvé à Alexandrie au IIIème siècle de notre ère. Si elle est tant populaire du temps de Charpentier, c’est parce que cette « prière à la Très-Sainte Vierge (est) particulièrement indiquée pour être chantée à la procession du jour de l’Assomption » en mémoire de la consécration du Royaume de France à Notre-Dame par Louis XIII (1607-1643), explique l’abbé Maxime Seguin de Pazzis (1767-1817) dans son Vœu de Louis XIII (1814). Sébastien Daucé nous l’avait déjà fait entendre car elle ouvre l’enregistrement de sa Messe à quatre chœurs (Harmonia Mundi, 2020). Mais lorsque les voix du dessus l’effleurent avec tant de tendresse sous les ors de Versailles, nous sommes littéralement plongés dans un bain de sérénité monacale. Le style de Charpentier révèle le caractère profond de ce court texte en agençant différents procédés d’écriture : des figuralismes (dissonance sur nostras deprecationes/ ne méprise pas nos prières) pour signifier la crainte de l’abandon, la technique de l’imitation afin de suggérer la multiplicité des fidèles comptant sur sa miséricorde ou le rythme contemplatif invitant à la dévotion. Ainsi apporte-t-il au texte un supplément d’âme tandis que les chanteurs l’enveloppent dans un voile de spiritualité. Jusqu’à ce tremblement attendri saluant Virgo gloriosa et benedicta (Vierge glorieuse et bénie).
Maintenant, Chantons je vous en prie sur la partition choisie par Sébastien Daucé dans le recueil de Chants des Noëls anciens et modernes de la Grande Bible publié par Christophe Ballard (1645-1715) en 1703. Nous l’avions déjà goûtée dans sa Pastorale de Noël, Grandes Antiennes O de l’Avant (Harmonia Mundi, 2016). Caroline Weynants entonne cette chanson de l’Avent en forme de dialogue. Des fidèles ingénus interrogent la Vierge sur les circonstances de la venue du Messie. Il se dégage de cette conversation une impressionnante puissance d’émerveillement. D’une voix veloutée et paisible, elle nous fait pénétrer, avec une exceptionnelle délicatesse, dans le mystère de l’Annonciation. Ce « cantique » traversera plusieurs siècles sous son incipit (Chantons je vous prie) ou son refrain (Or nous dites Marie). Ses paroles sont attribuées à Lucas le Moigne, curé (réel ou fictif) de Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde, en Poitou. Ecrites vers 1520, le recueil de Cantiques de noëls anciens (1590) précise qu’elles sont associées à un air profane plus ancien : Je l’ai perdue/ Celle que j’aimais tant. Cet air était toujours populaire au XVIIIème siècle. Par exemple, il servira de socle à une Chanson nouvelle sur l’accouchement de la reine (1727) lorsque Marie Leszczynska (1703-1768) donna naissance à deux jumelles royales : Henriette (1727-1752) et Louise-Elisabeth (1727-1759). Admirons la naissance/ Deux filles à la fois, chantait-on alors. C’est de manière bien plus recueillie que s’épanouit cette touchante poésie, au son d’une musique d’une grâce voluptueuse. Un crescendo placide berce ce texte qui, à chaque couplet, se métamorphose sous l’effet de coloris sans cesse changeants. Les instruments déroulent, avec délectation, la ligne mélodique sur laquelle la soliste pose délicatement la première strophe. La voix seule est amplifiée par les pupitres du dessus, relayés par ceux du dessous avant que le chœur ne carillonne le message de l’ange Gabriel. Marie-Frédérique Girod taille finement la mélodie du second couplet tandis que Perrine Deville nous attendrit avec son émouvant « par grande compassion ». Et c’est dans un finale exalté qu’il suspend son doux balancement que nous espérions sans fin, tant il diffusait un sentiment de bien-être. Jusqu’au rappel final lors duquel l’Ensemble Correspondances nous gratifie d’une reprise de cette page lumineuse.
Après nous avoir émus devant le tableau de la très humaine Vierge-Mère, Sébastien Daucé dirige maintenant notre regard intérieur vers la divina Mater, la Mère de Dieu. Pour la célébrer, il a retenu un extrait de son Canticum in honorem Beatae Virginis Mariae inter homines et angelos (H 400) qu’il avait composé vers 1680 « pour l’église de Notre-Dame de Liesse, dépendante du château de Marchais, près de Laon, appartenant à Marie de Lorraine », explique Catherine Cessac (Charpentier, Fayard, 2004). Dans son manuscrit (Mélanges autographes, volume 4), le compositeur indique que ce canticum (ou motet) pouvait être utilisé ad libitum afin d’animer toutes les festivités mariales, de l’Annonciation à l’Assomption. Son chant de louange se déploie sur deux chapitres. Dans le premier, les hommes interpellent les anges pour qu’ils leurs expliquent quid splendidius in excelso, quid pulchrium sub Deo (ce qu’il y a de plus splendide au plus haut, ce qu’il y a de plus beau sous Dieu). La seconde partie (Quam gloriosa dicta sunt/ Que de propos glorieux à ton sujet), celle qu’a retenue Sébastien Daucé, sublime le dialogue inter homines et angelos (entre les hommes et les anges) autour des vertus de la mère de Dieu. Sur le plan musical, cette page présente plusieurs caractéristiques du dialogo, conversation latine mettant en relation différents personnages (souvent célestes et humains dans les partitions italiennes). Par le jeu du rythme et de l’harmonie, Charpentier convertit la poésie en prière. Pour cela, il retravaille la structure du texte, la remodelant en forme d’arche coiffée d’un rondeau. Sur un tempo cadencé par des blanches et solennisé par les sonorités des cordes graves, le chœur des hommes et des anges invoque Marie, soulignant, par la répétition, sa maternité virginale (Virgo purissima). Dans le second mouvement exalté par des croches, les dessus de violons et les flûtes, les aigus (les anges) et les graves (les hommes) s’interpellent, se questionnent sur le mystérieux lien in qua partus et integritas (entre enfantement et virginité). Ils se rejoignent ensuite dans la tranquille sérénité d’une profession de foi en forme de rondeau dans laquelle le refrain assène, lors de ses multiples répétitions, un omnia, omnia dixit (tout, tout a été dit). Ecartant ainsi toute forme de contestation. Une affirmation véritablement militante, tant elle est insistante. Sans doute pour condamner la position calviniste sur le thème de la virginité perpétuelle de Marie qui resurgit périodiquement (dans une affaire judiciaire à Grenoble, en 1678, par exemple). Désormais confortées par leur profession de foi, les voix exaltent un chant d’action de grâce stimulé par un enthousiaste sociate voce (vos voix joyeuses). Un silence annonce la conclusion. Particulièrement expressive, celle-ci caresse onctueusement les suavi concentu (doux accords) et s’émeut des delectabili melodia (plaisantes mélodies) qui caractérisent ce motet baigné de spiritualité.
La veillée s’achève par un récit en musique de la Nativité. Entre 1671 et 1699, Charpentier a composé au moins six canticum ou dialogi (motets dramatiques en latin qui se distinguent en fonction de l’effectif mobilisé) consacrés aux événements commémorés à Noël. Pour notre plus grand plaisir, Sébastien Daucé a marqué sa préférence pour le plus développé d’entre eux : In Nativitatem Domini Canticum (H 416). Il paraît probable que ce motet ait été intégré dans la liturgie d’une messe du jour de Noël 1690 célébrée en l’église Saint-Louis des Jésuites. Le texte d’un auteur inconnu (peut-être un Père Jésuite de la maison professe) ne se limite pas à l’épisode relaté par les Evangiles. Suivant le fil conducteur adopté par Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) pour régler « l’enchaînement merveilleux » de son Discours sur l’Histoire Universelle (1681), le livret relie, dans une même narration, l’Ancien et le Nouveau Testament. Ainsi la dynamique narrative ajuste-t-elle, dans une parfaite symétrie, quatre périodes : une brève sinfonia, l’attente messianique, une Nuit instrumentale et l’accueil du Messie par les bergers. L’architecture du motet et l’abondance des didascalies (indications de jeu dans le manuscrit des Mélanges autographes, volume 9) pourrait indiquer qu’une homélie séparait le volet consacré à l’attente et celui illustrant la visite des bergers. Dans le premier, l’auteur du texte arrange des citations bibliques tandis qu’il puise, dans l’Evangile de Luc, l’essentiel du matériau littéraire pour le second.
La première partie du motet baigne dans une tonalité de do mineur que Charpentier qualifie de « obscure et triste » dans les Règles de composition rédigées cette année-là. L’histoire de la Nativité débute en ces temps sombres où le roi David manifeste à Dieu son sentiment d’abandon (Psaume 13/12). Une harmonie grave et veloutée se répand sous la nef de la Chapelle Royale. Arrosé par les larmes versées par les dessus de violons, le Preludium instrumental évoque le double geste de la supplication (ligne mélodique ascendante) et de l’accablement (chromatisme descendant). Alexandre Baldo traduit l’angoisse de David en soulignant, par des répétitions déchirantes, les deux mots-clés du message adressé à Dieu : usqequo (jusqu’à quand) et oblivisceris (oublieras-tu). Sur un mode homophone teinté d’affliction, le Chorus Justorum relaye son message anxieux, conjurant d’abord Dieu à se souvenir de sa promesse. Mais déjà, ces « justes » se réjouissent de leur libération prochaine dans un soudain élan d’exaltation illustrant remarquablement le verset 13,43 de l’Evangile de Mathieu : « alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père ». Un effet de contraste ingénieusement construit pour dépeindre la double nature (humaine et céleste) de ces élus du ciel. Le timbre chaleureux d’Etienne Bazola évoque maintenant la perspective de l’arrivée prochaine d’un Rex mansuetus (Roi bienveillant) prophétisée par Isaïe (7, 14-15). Le tempo étreint délicatement cet air qui baigne dans un clair-obscur expressif. Il mêle plusieurs affects : le soulagement (les notes caressant consolare/ console-toi), l’hésitation (sonorité voilée de l’orchestre et léger chromatisme affectant quae moerore consumeris/ pourquoi te consumer dans le chagrin) et l’espérance à la vue des stillabunt montes dulcidinem (montagnes (qui) distilleront la douceur). Le chœur s’enthousiasme déjà sur une ligne mélodique semblant accompagner la descente du Rédempteur (Redemptor noster, et descenderes). Le grave puissant d’Alexandre Baldo confirme l’imminence de son arrivée sur un tempo qui se met à danser avec les instruments. Le chœur jubile dans un Rorate caeli de super (Cieux, ruisselez d’en haut) et clôt ce premier volet à la manière d’une fanfare annonçant l’approche du Sauveur.
Dans son manuscrit, Charpentier commande : « Passez à la suite après un peu de silence ». La suite étant une sinfonia nous transportant dans la quiétude d’une Nuit « à la lisière du silence et de l’immobilité afin que le Verbe puisse prendre corps », écrit joliment Catherine Cessac. Charpentier apporte un soin particulier à la mise en scène de cet intermède. Il écarte spécifiquement les flûtes de l’instrumentarium, invite les instrumentistes à jouer tous lentement et prescrit l’emploi de sourdines. Enfin, il ordonne « deux mesures de silence » au milieu de cette partie orchestrale. Cette pause viserait-elle à matérialiser une forme de changement dans la continuité entre l’Ancien et le Nouveau Testament ? Ce suave Sommeil digne de l’opéra a revêtu, pour la circonstance, les habits de la spiritualité.
Des croches succèdent aux blanches pour secouer gaillardement les bergers endormis. La tonalité mineure a cédé sa place au do majeur (« gai et guerrier », selon Charpentier). La multiplication des didascalies signe une mise en scène délibérée de la partition. Peut-être même transcende-t-elle l’écho lointain de ces « pastorales » au cours desquelles, au moment de l’Offertoire, des bergers déposaient le produit de leur labeur dans une crèche vivante. Ebranlé par des instruments enjoués, le Chorus Pastorem est secoué par les vigoureux accords frappés par le théorbe, rendant plus inquiétante la lux terribilis (lumière effrayante) qui les réveille. Ici, les consignes de Charpentier visent à suggérer l’affolement. Vite et tous fort avec flûtes, commande-t-il aux instruments pour ce Réveil des bergers. Le tempo haletant du chœur effarouché est apaisé par le message dispensé, d’abord par David Tricou puis par Vojtech Semerad qui se partagent (aussi curieusement que le récit à deux voix du narrateur à l’ouverture du motet) le rôle de « l’Ange du Seigneur ». Le premier leur adresse un discours rassurant, scandé par un rythme dansant et orné de plaisantes ritournelles : le Sauveur est né. Cette opulente rhétorique à la manière italienne est à peine suspendue lorsque, dans un court passage récitatif, il les renseigne sur le lieu de la naissance (invenietis infans/ vous trouverez un enfant). Avant de les galvaniser pour qu’ils se mettent en route. Ce qu’ils consentent dans le diptyque musical du Gloria in altissimis Deo. Sur une tonalité d’abord festive, ils exaltent Dieu tandis que, par contraste, le rythme s’adoucit pour saluer la paix qui se répand sur terre. Conduite par les dessus de violons et les flûtes, une marche instrumentale à l’allure décidée prend la direction de Bethléem. Dans la partition, Charpentier indique « une reprise de cette marche avant une petite pause ». Fallait-il pouvoir attendre qu’une procession des offrandes s’achève avant de poursuivre ? Dans un chœur saisissant de tendresse et d’élégance, d’interjections en commentaires affectueux ponctués par de longs silences bienveillants, les bergers s’émerveillent à la vue de leur Sauveur. Puis, par un jeu d’alternance entre la haute-contre et le chœur, ils lui offrent deux strophes d’un air léger battu au rythme d’un menuet. Dans son manuscrit, Charpentier qualifie de « chanson » cet air que l’Ange chantait déjà dans son Dialogus inter angelos et pastores Judae in nativitatem Domini (H 420) composé en 1687. Celle-ci enjambera même les mers afin de concourir à la conversion de la tribu des Abénaquis (Canada) par des missionnaires jésuites (Paul-André Dubois, Marc-Antoine Charpentier chez les Abénaquis, Etudes d’histoire religieuse, 2006). Le motet, couronné par un chœur conclusif, s’ouvre sur un dialogue entre des solistes (basse, ténor) et le chœur. Ce dernier reconduira ensuite la formule du Gloria in altissimis Deo, célébrant Dieu avec puissance et majesté avant de retrouver la sérénité tranquille d’une pacis non erit finis (paix qui n’aura pas de fin). Une cérémonie qui, en 1690, se poursuivait probablement. En effet, le manuscrit de Charpentier invite à « recommencer tout ce qui se doit recommencer ». Tandis qu’à Versailles, les musiciens sont gratifiés d’ardents applaudissements.

Charpentier, Messe de Minuit, Mélanges autographes, volume 25, Gallica, BnF
Minuit approche (mais il est seize heures, à Versailles !). La Nuit du Dialogus inter angelos et pastores (H 420) répand son ombre sonore à l’intérieur de la Chapelle Royale. De longues notes s’étirent sur un tempo qui s’écoule placidement tandis que les flûtes à bec éclairent d’une lumière diaphane des graves qui engourdissent les dormeurs. Plus courte et sans doute moins mélodieuse que celle du Canticum H 416, cette rêverie mélancolique diffuse cependant un parfum capiteux et suscite une impression de bien-être. « L’une des plus belles pages instrumentales de la musique française de la fin du XVIIème siècle », insiste Catherine Cessac (livret Charpentier, Te Deum, Messe de Minuit, Archiv Produkion, 1997). Assurément.
Sensation qui se prolonge lorsque les dessus éthérés se fondent, avec une fine pointe de douceur, dans le velouté des graves pour communier dans une délectable euphonie. La grâce pénétrante de ce petit motet à trois voix pour l’Elévation con organo é fagotto (avec orgue et basson) s’exhale de la Missa quinti toni pro nocte ac die festi Natali Domini composée par Sébastien de Brossard pour les célébrations de Noël en la cathédrale de Meaux, en décembre 1700. En l’occurrence, le texte de cet O Miraculum, O novitatis prodigium (Miracle, ô merveille de nouveauté) paradisiaque remplace ponctuellement celui de Thomas d’Aquin (O salutaris Hostia/ O réconfortante hostie) institué dans toutes les églises du royaume en 1513 « lorsque Louis XII fut si malade au Bois de Vincennes, pour obtenir du Ciel sa guérison » croit savoir Henri Sauval (1623-1676) dans le second tome de son Histoire et recherches des antiquités de Paris (1724). Le texte est extrait des Cantiques pour les principales fêtes de l’année… le tout composé en latin d’une méthode très aisée et facile, exprès pour être mis en musique (1685) publiés par Pierre Porte ( ?- ?). Ce chanoine, chargé des questions théologiques de l’église de Saint-Chamond (Loire) et poète néo-latin, proposait alors aux compositeurs de motets de nouveaux textes à mettre en musique. Un beau texte porté par une musique sublime.
Déjà, un air champêtre fait danser les voyelles du premier Kyrie Eleison. Loin de la tonalité déférente et presque résignée du Kyrie de la Messe de Monsieur Mauroy (H 6, 1691), celui de la Messe de Minuit se déploie avec force, vitalité et rythme. Il ne s’agit plus, semble-t-il, de « demander publiquement pardon à Dieu pour les péchés de toute l’Eglise », comme l’indique Jean-Jacques Olier (1608-1659) dans son Explication des cérémonies de la grand’messe de paroisse (1687). Mais de chanter « par neuf fois, à l’honneur des neufs Chœurs Angéliques », comme l’exprime plus loin le fondateur du premier séminaire français de Saint-Sulpice. Car, en cette nuit de Noël, la supplication obtient satisfaction : le Sauveur est arrivé. Comme le veut alors l’usage, les trois invocations trois fois répétées sont réparties entre les instruments et les voix. Sur le rythme d’une bourrée, le premier Kyrie confié à l’orchestre émoustille l’air Joseph est bien marié. Ce noël populaire partage son timbre avec une chanson enfantine du début du XVIIème siècle (Quand Biron voulut danser) moquant l’interminable séance d’habillage de Charles de Coutant, duc de Biron (1562-1602) avant la danse. Le chœur fait chalouper le second tandis que Charpentier demande à l’orgue de professer le dernier. D’entrée, cette combinaison du sacré et du profane lève le voile sur un tableau familier, celui de la Sainte Famille.
Car, après ce Kyrie consacré à Joseph, personnage consacré par la piété baroque en modèle des maris chrétiens, le premier Christe est placé sous le patronage de la Vierge. Sur l’air Or nous dites Marie, un duo réconforte la jeune mère quand le second Christe est exalté par les archets sur l’air d’Une jeune pucelle.
La fraîcheur de cette mélodie irradie ensuite la reprise du Kyrie. Une cadence fringante vivifie la ligne mélodique de cette ancienne chanson italienne (La monica/ jeune amoureuse enfermée au cloître – voyez notamment la Sonata sopra la Monica du violoniste Biagio Marini) librement ajustée à des paroles françaises (Une jeune fillette de noble cœur, également destinée au couvent) dans le Recueil des plus belles et excellentes chansons en forme de voix de ville (vaudeville) publié en 1576 par Jehan Chardavoine (1538-1580). Paraphrasée dans un but d’édification, celle-ci deviendra Une jeune pucelle évoquant le récit de l’Annonciation. Aiguillonné par le tempo vif d’une bourrée, le chœur fait danser le Kyrie aussi bien que nos cœurs. Un ravissement qui se prolonge au retour de l’air Joseph est bien marié, cette fois dans sa version instrumentale (H 534, 1693), mettant ainsi la touche finale au tableau de la Sainte Famille.
Avec l’application d’un célébrant, Etienne Bazola entonne le Gloria in excelsis Deo grégorien : le « Cantique du Ciel », selon Jean-Jacques Olier. De fait, c’est un hymne angélique que l’on entend à nouveau, à partir de la messe de la nuit, après sa suspension pendant le temps de l’Avent. Son texte emprunte aux Anges les paroles qu’ils adressaient aux bergers. Chant d’allégresse aux accents séraphiques, il s’éveille sur l’onde placide d’une paix dont jouissent les hominibus bonae voluntatis (hommes de bonne volonté), dans une atmosphère qui évoque la Nuit du Canticum H 416. D’ailleurs, dans son manuscrit (Mélanges autographes, volume 25), Charpentier prescrit également, à cet endroit, l’emploi de sourdines. Par contraste, le chœur explose de louanges sur l’air des Bourgeois de Chastres. Si la mélodie de ce noël populaire est ancienne, sa vocation noëlique semble plus récente : « La bourgade de Chastres, qui devait plus tard s’appeler Arpajon, donna l’essor au XVIIème siècle à un noël d’un genre tout nouveau, où s’entremêlent…, avec certains couplets encore dévots, des vers qui ressemblent beaucoup à des airs bachiques. L’auteur était un prêtre nommé Crestot… Le curé Crestot fit école : en de nombreuses provinces françaises, on démarqua son noël et on l’imita » raconte l’académicien Georges Goyau (1869-1939) dans Le Monde illustré (22 décembre 1923). Comme les fidèles des villages d’Arpajon, d’Egly et de Montlhéry (Essonne) que le curé emmenait alors dans une procession joyeuse vers une crèche, le chœur magnifie le nouveau-né sur un tempo sémillant. Si les solistes se succèdent ensuite pour clamer ses titres de gloire, la tonalité enjouée du qui tollis peccata mundi (qui effacez les péché du monde) révèle la croyance du chœur en la mission libératrice du Messie. Aussi est-ce sur le rythme alerte d’une gavotte qu’il fait allégeance à la Trinité. Cette célébration du mystère trinitaire est réglée sur la mélodie d’un noël populaire : Où s’en vont ces guays bergers. Lui-même greffé sur la chanson traditionnelle Où est-il, mon bel ami, allé ? L’esprit de béatitude qui transcende cet hymne liturgique s’incarne enfin dans un Amen jubilatoire qui finit par se blottir dans la douceur d’un saint recueillement.
Est-ce pour matérialiser la séquence de la collecte (prière d’ouverture que récite le célébrant à la suite du Gloria) que Sébastien Daucé avait inscrit au programme l’antienne mariale Alma redemptoris Mater (tendre mère du Rédempteur) H 44 ? La liturgie ne le prévoit pas et la collecte n’est pas chantée. Du moins, cette courte incise pour quatre voix nous aura-t-elle fait goûter un petit joyau de spiritualité. Une forme d’oraison agrémentée de ritournelles instrumentales ciselées par deux violons. Charpentier recompose le texte en trois sections dont il révèle ensuite le caractère singulier par des coloris reflétant leur contenu. Dans une brève sinfonia, les violons esquissent une ligne mélodique aux accents quasiment mystiques. L’invocation de la Vierge se présente ensuite selon un schéma plus traditionnel : l’incipit entonné façon plain-chant par un soliste tandis qu’une sage polyphonie prolonge l’appel à l’Alma redemptoris. Dans la partie centrale, plus récitative, deux solistes insistent successivement sur la nature surnaturelle (natura mirante/ à la surprise de la nature) de la conception de Jésus. Enfin, le compositeur enrichit la salutation d’adieu par un contrepoint généreux habité par une émotion à fleur de notes (légère dissonance sur peccatorum miserere/ ayez pitié des pécheurs) pendant que les voix du dessus l’irradient à la manière des anges.
L’intonation liturgique grégorienne du Credo ouvre une profession de foi dans laquelle la musique de Charpentier théâtralise le texte. Porté par un mouvement lent, le tutti s’incline respectueusement devant Patrem omnipotentem (le Père tout-puissant), sculptant son œuvre (factorem coeli et terrae/ qui a fait le ciel et la terre) dans un fugato égrenant les six jours de la création du monde. Se tournant vers le Christ, la ligne de chant s’orne de ritournelles instrumentales tandis que le tempo s’éveille. Jusqu’à danser le menuet dans un Deum de Deo émoustillé par le timbre du noël Vous qui désirez sans fin. Un air chaleureux qui conserve toute la candeur joyeuse de sa matrice, la chanson populaire Magdelon je t’aime bien. Une variante de cet air enveloppe ensuite le récit de l’Incarnation. Toujours aussi vive et enjouée. L’exaltation heureuse se fige un instant pour laisser place à un Et incarnatus est (ayant pris chair) méditatif durant lequel le cérémonial parisien prescrit d’ailleurs au célébrant de se découvrir pour donner « exemple à tous de s’incliner et de s’anéantir devant Dieu » (Jean-Jacques Olier). La triple répétition de Homo factus est (a été fait homme) s’épanouit crescendo jusqu’à ce Crucifixus (qui a été crucifié) paré de ritournelles et soutenu par l’allure entraînante d’un noël pour le temps de l’Epiphanie : Voici le jour solennel de Noël. En esquissant la destinée tragique du nouveau-né avec cette forme de détachement, Charpentier ne fait-il qu’éclairer le message de l’Eglise ? Pierre de Ronsard (1524-1585), auteur du texte à l’origine de ce noël, observait : Quand ce beau Printemps je voy/ J’apperçois/ Rajeunir la terre et l’onde. Comme en écho, la musique de Charpentier suggère que la naissance divine annonce un nouveau printemps pour une humanité bientôt lavée du péché par le sang de la Passion. Dans la section figurative suivante, la partition spiritualise un défilé d’images expressives: l’évocation de l’Ascension (mouvement ascendant emporté par des grappes de croches), l’installation du Christ à la droite du Père (allure altière battue par un rythme pointé), la crainte du jugement dernier (mouvement lent et tourmenté) et l’exaltation d’un règne sans fin (finale en apothéose). Déjà, les solistes des voix du dessus proclament avec enthousiasme l’accomplissement de la promesse faite à Israël. Comme support de leur intervention, Charpentier choisit l’air A la venue de Noël. Ce noël didactique était destiné à l’initiation du peuple aux mystères de Noël au moyen d’une mélodie plaisante et d’un rythme entraînant. Electrisé par les flûtes, ce passage ne pouvait que séduire un auditoire sans doute à l’affût des clins d’œil sonores dissimulés au cœur de la partition. Et peut-être même d’en marmonner la parodie qui circulait alors : A la venue de Nau, nau nau/ Faisons tretous bonne chère. Enfin, si l’unité de l’Eglise est symbolisée par un unisson qui se déliera seulement pour illustrer la resurrectionem mortuorum (la résurrection des morts), c’est dans un dernier éclat que le tutti célèbre la vie céleste avant de s’incliner dans un Amen extatique.
Espace interdit aux chansons depuis les Règlements de 1620, l’Offertoire offre aux instrumentistes un espace de liberté. Les organistes y rivalisent d’imagination créatrice et de virtuosité. Pour sa part, Charpentier prévoit que « les violons joueront Laissez paître vos bestes ». « Un chant populaire qui a…. pour la ville de Sainte-Menehould… la valeur d’une relique ancestrale (et) dépeint d’une touche ingénieuse le caractère des habitants de tous les villages du doyenné » affirme l’abbé François Louis Lallement (1871-1927) dans ses Echos rustiques de l’Argonne (1908-1909). Sébastien Daucé se soumet ici à la volonté du compositeur, choisissant la version instrumentale H 534. En nous laissant subjuguer par cette mélodie si simple et son balancement si envoûtant, nous nous rappelons que l’abbé Simon-Joseph Pellegrin (1663-1745), l’un des librettistes de Jean-Philippe Rameau (1706-1764) en réécrira les paroles pour le transformer en un chant de dévotion pour le temps de l’Avent. Chant que l’on entend toujours, aujourd’hui, dans nos églises : Venez divin Messie.
Faute de nous être imprégné du programme, nous nous attendions au Sanctus. Mais c’est un Te Deum qui nous surprend et nous déconcerte (nos voisins aussi, d’ailleurs). Au point d’en perdre les premières mesures. Pourquoi un Te Deum après l’Offertoire ?
Nonobstant ce moment de flottement, nous nous laissons emporter par le flot scintillant du Te Deum à quatre voix H 147. Sans le concours des fanfares de son homologue eurovisionnel H 146, il fait miroiter le texte de cet hymne de louange chanté principalement lors de l’office des matines (en milieu de nuit) ou commandé pour les services solennels d’action de grâce. Ce grand motet à la façon versaillaise s’ouvre de façon inopinée, inversant l’incipit habituel (Te Deum laudamus) et le second verset Te Dominum confitemur (Seigneur, nous te confessons). Pourquoi se confesser avant de louer ? Peut-être pour faire suite à la séquence précédente dans l’agencement de la célébration du jour ? Ou pour se faire pardonner l’alliance avec l’Empire ottoman durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1699) et qui enregistre, en septembre 1693, un épisode militaire heureux avec la prise de Charleroi que célèbre ce chant d’action de grâce? En tout état de cause, Charpentier mobilise ici tous les ressorts de sa science de la composition. Et l’Ensemble Correspondances libère la riche palette de ses talents pour faire briller cette partition extrêmement bigarrée.
Le compositeur fait de la variété sa devise. Variété dans l’alternance entre le grand chœur homophone et la polyphonie du petit chœur pendant l’acte de salutation. Variété de styles combinant l’écriture harmonique (somptueux Salvum fac populum tuum) et le contrepoint à l’italienne. Variété des coloris obtenue par des combinaisons vocales sans cesse changeantes. Variété jusque dans les nuances de la battue des rythmes : retenus pour l’appel au secours (Te ergo quaesumus famulis tuis) et sitôt solennels pour honorer les saints (Aeterna fac cum Sanctis tuis). N’oublions pas cette attention sourcilleuse pour laisser parler les mots eux-mêmes. Comme terra longuement étiré pour signifier l’étendue de la superficie terrestre (nota : 1693 est l’année de la publication du premier atlas nautique français) ou ces guirlandes de mélismes illuminant laudamus. Ainsi que le majestueux majestatis gloriae tuae dont on ignore s’il s’adresse au roi victorieux à Charleroi ou à Dieu. Enfin, Charpentier ne manque pas de recourir aux vertus auto suggestives de son art. Particulièrement ce martellement du Non pour protester envers et contre tous que non confundar in aeternum (que je ne sois jamais confondu). Illustration parfaite de cet avis de Lecerf de la Vieville lorsqu’il estime que « des chants de Musique d’Eglise d’une expression puissante, des tons forts, des tons de maître soutenus d’un accompagnement convenable, seraient capables d’opérer autre chose que de légères émotions de tendresse » (Février 1706, Comparaison III). Des « sentiments vifs » qu’éveille pareillement le finale puissant de ce motet ô combien chamarré.
O que n’étais-je en vie/ Quand fut né le Rédempteur. Cette chanson du XVIIème siècle évoque tout ce que le chrétien aurait pu faire s’il avait vécu au moment de la naissance de Jésus. Sa ligne mélodique aux accents délicieusement mélancoliques portera les trois acclamations du cantique de la liturgie céleste : le Sanctus. Depuis le Cérémonial du pape Clément VIII (1536-1605) en l’an 1600, ce Sanctus est chanté en alternance avec l’orgue. Instrument qui, pour Jean-Jacques Olier, « signifie la musique du Ciel ». Avant de compléter: « L’Eglise chante une fois au milieu pour dire qu’elle tâche de prendre part et de se perdre dans les louanges du Paradis ». Une consigne suivie à la lettre lorsque Charpentier confie aux instruments (en lieu et place de l’orgue) la première et la troisième acclamation. Entre leurs deux interventions, le chœur contemple avec déférence la sainteté de Dieu avant de l’acclamer dans un Hosanna à l’unisson. En cette nuit de Noël, le Benedictus qui venit in nomine Domini (Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur) prend tout son sens. Un trio d’homme (peut-être symbolise-t-il les mages ?) salue le nouveau-né sur une tonalité tendrement mystique avant que le chœur ne s’incline sur un pieux Hosanna.
L’Agnus Dei incline à danser. En effet, superposant le texte liturgique sur l’image pastorale de l’agneau, Charpentier rythme l’invocation latine sur celui de la chanson à danser dont A minuit fut fait un réveil tire ses origines : Quand la bergère va aux champs. Une séquence aussi courte qu’époustouflante. Les cordes taquinées par les bois chantent le premier Agnus et euphorisent le troisième tandis que le chœur les avait rejoints pour enchanter le second. De concert, ils signent une fin de messe énergisante. A l’image de ces célébrations nocturnes dans les campagnes du Perche tels que les rapporte Félix Chapiseau (1857-1927) : « Tout d’abord les Noëls se succédaient autour de la crèche, répétés par les gens qui, n’ayant pu trouver place dans l’église, se tenaient sur le parvis et dans le cimetière environnant l’église. Puis les chants se confondaient ; les moutons, le bœuf et l’âne mêlaient à ce concert leurs cris discordants ; la cloche faisait entendre son plus joyeux carillon. Alors, pour compléter cette cacophonie indescriptible, musettes et hautbois attaquaient de vieux airs de menuets et de gavottes ; c’était le commencement des danses qui s’exécutaient dans le cimetière, sans respect pour la cendre des morts. L’office terminé, jeunes et vieux, bergers et bergères, reprenaient le chemin de leurs villages respectifs pour aller fêter le réveillon » (Le folklore de la Beauce et du Perche, 1902). L’ambiance fut sans doute plus sage à la sortie de l’église Saint-Louis, à Paris, ce 25 décembre 1694.
Moment de spiritualité et ambiance de fête. C’est tout cela à la fois que Sébastien Daucé et son ensemble ont voulu nous faire partager. A l’échelle des ovations qu’ils ont recueillies, il ne fait aucun doute que leur objectif était atteint. De plus, au-delà du simple plaisir de l’écoute, la diversité des œuvres interprétées nous a appris que le Charpentier des Ténèbres était, tout autant, le compositeur par excellence des Noëls.
Mais ces musiques ne nous enchanteraient pas tant si elles n’étaient servies par des musiciens qui excellent à faire parler leurs instruments à l’aune des sentiments qui animent la partition. Avec une mention particulière au pupitre des bois qui a su conserver aux sonorités champêtres tout leur potentiel de fraîcheur. Nous avons aimé l’art des nuances et la fluidité avec lequel les instrumentistes soutiennent les chanteurs. Nous avons admiré l’art de la diction des solistes et la parfaite consonance des voix des chœurs. Nous applaudissons l’engagement des artistes et de leur chef dans l’œuvre de réincarnation de ces pages qui charment nos oreilles autant qu’ils apaisent nos esprits.
Publié le 02 févr. 2022 par Michel Boesch
 ©
©