Bach/ Webern - Richter Ensemble
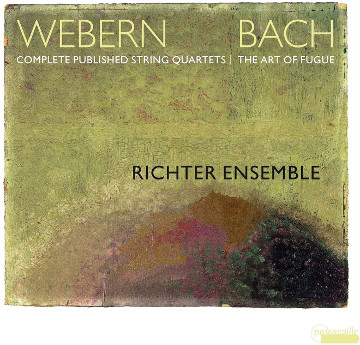 © Denken d’Arnold Schönberg (Belmont Music Publishers, Los Angeles)
© Denken d’Arnold Schönberg (Belmont Music Publishers, Los Angeles) Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notices trilingues (français-anglais-allemand), un CD, durée totale : 77 minutes 17 secondes. Passacaille - 2023
Compositeurs
- Johann Sebastian Bach (1685-1750) : l’Art de la Fugue
- Anton Webern (1883-1945) : Quatuors à cordes
Chanteurs/Interprètes
- Richter Ensemble :
- Violon : Rodolfo Richter
- Violon, alto : Rebecca Huber
- Alto : David Wish
- Violoncelle : Jennifer Morsches
- Violone : Paolo Zuccheri
- Clavecin : James Johnstone
Pistes
- 1.1-4. Johann Sebastian Bach : L’Art de la Fugue BWV 1080 (fugues, Contrapunctus I-IV)
- 2.5-9. Anton Webern : Cinq Mouvements pour Quatuor à cordes Op. 5
- 3.10-12. Johann Sebastian Bach : L’Art de la Fugue (fugues en strette, Contrapunctus V-VII)
- 4.13-18. Anton Webern : Six Bagatelles pour Quatuor à cordes Op. 9
- 5.19-22. Johann Sebastian Bach : L’Art de la Fugue (doubles et triples fugues, Contrapunctus VIII-IX)
- 6.23-25. Anton Webern : Quatuor à cordes Op. 28
- 7.26-29. Johann Sebastian Bach : L’Art de la Fugue (fugues en miroir, Contrapunctus XII-XIII)
- 8.30. Johann Sebastian Bach : L’Art de la Fugue (fugue finale, Contrapunctus XIV)
L’Art de la Fugue et l’œuvre pour quatuor de Webern, confrontés par l’Ensemble RichterMême si Die Kunst der Fuge est souvent entendue au clavier (orgue, clavecin, piano), si ce n’est conformément à sa probable vocation, du moins à sa gestation, la partition ne fut pas spécifiée pour un instrument particulier. Sa notation en voix distinctes autorise des appropriations par diverses configurations, dont le quatuor à cordes (parmi les publications, une chez Bärenreiter). Vieux de presque 90 ans (décembre 1934 / mai 1935), le tout premier enregistrement de cet emblématique BWV 1080 fut d’ailleurs réalisé par le Roth Quartet, à l’ère du 78 tours, chez Columbia, dans un arrangement de Roy Harris et Mary D. Herter Norton, –une archive qui conserve toujours son aura de poésie. Sous cette forme, les témoignages les plus connus restent ceux du Juilliard String Quartet (Sony, 1987) et de l’Emerson String Quartet (DG, 2003). Et pour sûr, dans un effectif un brin plus étoffé, la suprême réussite de Reinhard Goebel (Archiv, juin 1984). Mais à bien considérer, sans être pléthorique, la discographie compte aussi, dans l’ordre chronologique, le Collegium Aureum (quintette et clavecins, DHM, 1962), le Bell’Arte Ensemble (Bayer, 1979), le Portland String Quartet (Arabesque, 1984), le Borciani String Quartet publié l’année du tricentenaire du compositeur (Nuova Era, 1985), le Modern String Quartet (Mood Records, 1994), le Keller Quartett (ECM, 1997), l’Amsterdam Loeki Stardust (Channel, 1998), le Delmé Quartet (Hyperion, 1999), le Quartetto Bernini (Amiata, 2001), Rachel Podger et Brecon Baroque (Channel, 2015). Un prometteur mais inégal enregistrement par le Cuarteto Casals capté en mars 2022 vient de paraître chez Harmonia Mundi.
Plus innovant que la parure s’avère le rapprochement opéré par le présent album : entretoiser un des plus hauts et vastes chefs-d’œuvre du Baroque instrumental avec des pièces concises et elliptiques qu’Anton Webern écrivit au début du XXe siècle pour le quatuor à cordes, l’idée étonnerait. Et pourtant, comme le rappelle le livret, le jeune compositeur autrichien consacra une thèse aux motets d’Heinrich Isaac (c1450-1517), preuve de son intérêt pour la polyphonie des maîtres anciens – rappelons aussi qu’il arrangea un extrait de L’Offrande Musicale. Sa trajectoire accorda une importance croissante au contrepoint, parfois mêlée à la technique dodécaphonique (Symphonie op. 21), ce qui est aussi le cas dans l’opus 28, sa dernière œuvre chambriste, dont le motif sériel cite la signature B-A-C-H dans sa translittération germanique de la gamme. Mutatis mutandis, les enjeux éthiques et esthétiques, de part et d’autre du romantisme, ne sont pas à ce point divergents : à l’instar du Cantor de Leipzig et de sa combinatoire si envoûtante à l’oreille, la rationalité du procédé wébernien n’entend pas exclure la séduction sonore, réduite à l’essentiel par l’exercice de style et un certain idéal de pureté, de cristallisation du geste expressif, évoluant vers la condensation et la rhétorique des ultimes pages des années 1920 et 1930.
Sur le disque, les quatorze Contrapuncti sont abordés dans l’ordre conventionnel de l’édition posthume de 1751, d’une complexité globalement progressive, groupés en quatre séquences : fugues simples (deux en mouvement droit, deux en mouvement contraire), trois fugues-strettes, doubles & triples fugues, quatre fugues en miroir (le rectus précédant l’inversus pour chaque binôme). Ces quatre pans sont entrecoupés par trois incursions wéberniennes (les Fünf Sätze de 1910, les six Bagatelles publiées en 1924, le Quatuor créé en 1938) puis couronnés par la Fuga a 3 Soggetti. Celle-ci dans son état inachevé – dommage que notre cénacle ne se soit prêté à la gageure. Précisons que les quatre Canons ne sont pas joués, peut-être aussi faute de place (le minutage dépasse déjà l’heure et quart).
Par son coloris moiré, son diapason à 415 Hz, sa science du phrasé historiquement informé, son articulation (le rythme pointé du VI in stilo francese), l’Ensemble Richter se perçoit aisément comme un apparentage baroque et non comme une lecture modernisée telle que l’exemplifia le Juilliard Quartet. Autre gage : le recours au clavecin de James Johnstone dans sept Contrapuncti (dont le XIII en duo avec le violon) et au violone de Paolo Zuccheri dans les fugues-strettes. Dans cet appareillage et par ces effets, les options ne se confinent pas à l’aridité : cet Art de la fugue respire avec sensibilité et va pouvoir se déployer non comme des paragraphes de défunte grammaire en ré mineur, mais comme un vivant retable, un bréviaire d’âme poli par les siècles, actualisant l’admirable gravure antiquisante de Jordi Savall à la collégiale de Roquemaure, certes en consort élargi autour des violes (Astrée, 1986).
Passé l’énoncé du thème principal, le second Contrepoint révèle une onction moelleuse, une concertation délicate, qu’épanouissent des tempi plutôt aisés. Au revers d’une telle souplesse, le galopant IX alla Duodecima élancé par son saut d’octave n’emprunte pas la netteté de trait des Emerson mais suggère une joie effervescente, en émoustillant cette étape la plus cinétique du corpus. Dans son ouvrage Die Kunst der Fuge – Bachs Credo (2018), l’interprétation théologique de Wolfgang Wiemer associait le douloureux Contrapunctus XI au Crucifixus etiam pro nobis ; le tableau qu’illustre l’ensemble Richter ne verse pas dans l’orthographie, mais par son acerbe tumulte, ses rires railleurs et ses trognes moqueuses (on pense à la Verspottung Christi de Jan Sanders von Hemessen), suggérerait le Jésus conspué par les soldats sur son chemin de calvaire. Une sardonique scène de martyre que la patine des cordes semble embuer dans les teintes cireuses de la Dérision du Christ du peintre florentin Cimabue (c. 1240-1302). Bilan : tout au long du cycle, outre l’homogénéité des lignes instrumentales (leur volume, leur perspective, leur intrication), on doit saluer une prestation subtilement suggestive, parmi les plus imageantes qu’ait connue l’œuvre dans cette formation à cordes, jusqu’à la fugue finale, sobrement décantée, d’un extrême soin pictorialiste.
Ces vertus imprègnent l’approche sans grand hiatus esthétique réservée à Webern, malgré la différence d’idiome. Contrairement au regard analytique des Juilliard (RCA, 1959), Rodolfo Richter et ses partenaires ne gomment pas le pathos de l’opus 5, endeuillé par la disparition de la mère du compositeur. Ce que compriment ces cinq instantanés, qui peuvent facilement s’asphyxier sous d’autres archets pointillistes, retrouve ici une densité de textures, une expansion signifiante, depuis les gestes névrotiques du Heftig Bewegt jusqu’aux sentiments dégivrés des Sehr langsam. La concentration des Bagatelles est explorée avec un raffinement et une irisation qui luttent contre la lyophilisation de ces instants au ras du silence : on les perçoit alors comme un polyptyque dont les huiles précisément dosées ne sont pas encore sèches sur l’enduit. Une alternative à l’élégance quintessenciée des LaSalle (DG, 1974). Pour les lacis de l’opus 28, les pulpeux Richter récusent aussi le siccatif, n’outrent pas l’expressionisme mais se situent dans le chaleureux sillage du Quartetto Italiano (Philips, 1970), et de la veine néoschubertienne du Artis Quartett (Sony, 1992), deux références s’il en est. Jamais exsangue, l’équipe sculpte les discontinuités et exorbitations comme des bribes de Lieder sans paroles. Voilà qui parachève le projet, audacieux et cohérent, que révèle ce CD. Lequel, de Bach à la Seconde École de Vienne, humanise des architectures réputées austères et surtout donne voix lyrique à leur imaginaire foisonnant. Par leur éclairage réciproque, deux cosmos à redécouvrir sous le fertile voisinage que leur offre cet album.
Publié le 11 sept. 2023 par Christophe Steyne
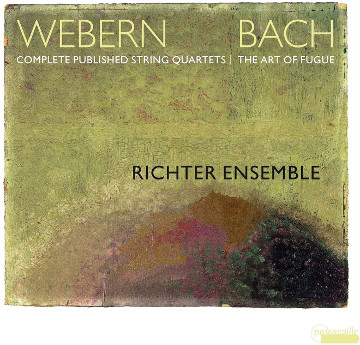 © Denken d’Arnold Schönberg (Belmont Music Publishers, Los Angeles)
© Denken d’Arnold Schönberg (Belmont Music Publishers, Los Angeles)