Grands Motets - Lully
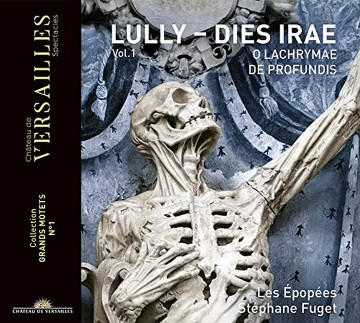 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notice trilingue (français-anglais-allemand), un CD, durée totale : 69 minutes, 25 secondes.Château de Versailles Spectacles - 2021
Compositeurs
- Jean-Baptiste Lully (1632-1687) : Grands Motets pour temps de pénitence
- Dies Irae
- O Lachrymae
- De Profundis
Chanteurs/Interprètes
- Chœur et solistes Les Epopées :
- Dessus : Caroline Arnaud, Ambroisine Bré, Claire Lefiliâtre, Jeanne Lefort, Ileana Ortiz, Lucy Page, Marie Perbost, Marine Zaccarini
- Hautes-contres : Cyril Auvity, Clément Debieuvre, Serge Goubioud, Lisandro Pelegrina
- Tailles : Marco Angioloni, Marc Mauillon
- Basses-tailles : Vlad Crosman, Imanol Iraola, Benoît Arnould
- Basses : Luc Bertin-Hugault, Renaud Bres, Thierry Cartier, Olivier Gourdy
- Orchestre Les Epopées :
- Dessus de violon : Josef Zak (Soliste premier dessus), Charlotte Grattard (Soliste second dessus), Yuna Lee, Hélène Decoin, Maud Sinda, Sabine Cormier, Koji Yoda, Louise Ayrton
- Hautes-contres de violon : Maialen Loth, Satryo Yudomartono, Delphine Grimbert
- Tailles de violon : Leïla Pradel, Diane Omer, Céline Cavagnac
- Quintes de violon : Laurence Martinaud, Youn Young Kim
- Basses de violon : Alice Coquart, François Gallon, Julien Hainsworth
- Basses de viole : Claire Gautrot, Mathias Ferré
- Grosse basse de violon : Ludovic Coutineau
- Hautbois et flûtes à bec : Laura Duthuillé, Luc Marchal
- Flûtes à bec : Marie Hervé, Bertrand Blondet, Frédéric Naël
- Basson à la quarte et flûte à bec : Arnaud Condé
- Basson et flûte à bec : Anaïs Ramage
- Serpent : Volny Hostiou
- Orgue : Marie van Rhijn
- Clavecin : Loris Barrucand
- Théorbes : Pierre Rinderknecht, Nicolas Wattinne
- Direction : Stéphane Fuget
Pistes
- 1.Dies Irae : Dies Iræ, dies illa
- 2.Liber scriptus proferetur
- 3.Rex tremendæ majestatis
- 4.Inter oves locus præsta
- 5.Oro suplex et acclinis
- 6.Pie Jesu Domine
- 7.O Lachrymae : O Lachrymæ, fideles lachrymæ
- 8.O fons amoris
- 9.Sed in planctu
- 10.Exultant cœli
- 11.Et in excelsis
- 12.O Lachrymæ, fideles lachrymæ
- 13.O fons amoris
- 14.De Profundis : De profundis clamavi ad te, Domine
- 15.Fiant aures tuæ intendentes
- 16.Si iniquitates observaveris, Domine
- 17.Quia apud te propitiatio est
- 18.A custodia matutina usque ad noctem
- 19.Quia apud Dominum misericordia
- 20.Et ipse redimet Israël
- 21.Requiem æternam dona eis Domine
- 22.Et lux perpetua luceat eis
L’âme de LullyLully avait-il une âme ? La légende noire du Florentin dressée par ses ennemis envieux de ses multiples talents a souvent occulté une réalité bien différente attestée notamment par des actes notariés où se décèle la générosité du personnage vis-à-vis de ses proches, famille, serviteurs, élèves… Sa fin se voulut édifiante, puisqu’à l’heure de mourir, à la manière italienne, il se fit mettre sur la cendre, la corde au cou, pour faire amende honorable de ses péchés. Quelle qu’ait été sa conduite, Lully fit montre dans son œuvre sacré (grands et petits motets) d’une foi sincère, sachant se faire mystique à ses heures.
Ajoutons que le surintendant n’appréciait guère qu’on confondît sa musique d’église et sa musique profane. On connaît l’anecdote du compositeur, sursautant en entendant un cantique spirituel parodiant un air d’une de ses tragédies et déclarant « Pardon, Seigneur, je ne l’avais pas fait pour vous ». Et force nous est de constater les nombreux contresens interprétatifs relevés jusqu’à ce jour en matière d’exécution de ces grands motets où deux écueils majeurs, la superficialité mais aussi peut-être l’absence de sens théologique, ont souvent fait sombrer quelques entreprises. Philippe Herreweghe s’est révélé, malgré de bien belles voix, quasi janséniste dans son Dies Iræ et son Miserere. Hervé Niquet, trop obnubilé à vouloir trouver un miroir de l’Académie Royale de Musique à l’autel, n’en a souvent retenu qu’un geste théâtral ou décoratif en dépit de quelques réussites (dont le O lacrymæ ici présent) au sein d’une quasi-intégrale assez inégale.
Il y a peu, le charismatique Leonardo Garcia Alarcón venait bousculer des habitudes d’écoute tout en suscitant un intérêt incontestable autour de trois pages emblématiques, à savoir le Dies Iræ, le De profundis et le flamboyant Te Deum. Très créatif dans son approche, le processus interprétatif donnait lieu à une complète réappropriation des œuvres, n’hésitant pas à amplifier les partitions, en bissant voire triplant certains passages (les plus beaux il est vrai, retransmis sous divers éclairages, instrumentaux, solistes et choraux). La ritournelle introductive du Dignare donnait même lieu à une transposition pour les instruments graves afin de noircir encore cette section si dramatique de l’œuvre qui fut fatale à son auteur (se reporter à notre compte-rendu).
Arrivent Les Epopées et Stéphane Fuget. Quelques extraits vidéos remontant à au moins deux ans nous laissaient envisager un bouleversement sans précédent de l’approche de ces pages grandioses. En juillet dernier, une captation était réalisée en la Chapelle Royale du Château de Versailles. Mon cher confrère Pierre Benvéniste achevait sa chronique par ces mots : « Je ne connais rien de tel dans toute la musique d'église que j'ai entendue au cours de ma vie. » C’est dire l’impact émotionnel suscité par cette première pierre posée à un édifice annonciateur d’autres volumes dans le cadre d’une collection intitulée « Grand Motets » parmi les publications de Château de Versailles Spectacles. Stéphane Fuget nous promet une intégrale de ceux de Lully, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir au vu de la qualité extrême qui marque cet enregistrement au service d’œuvres bien trop négligées malgré leur caractère tout à fait extraordinaire.
Contrairement à l’approche de Garcia Alarcón, celle de Stéphane Fuget se veut d’une fidélité à la lettre extrêmement soigneuse, qu’il s’agisse des effectifs conséquents ici convoqués, des pratiques vocales (solistes issus du chœur) et instrumentales, déployant un art consommé des dynamiques, de l’ornementation qui mobilise ici quantité d’effets au service d’une expressivité de chaque instant. C’est qu’avant même de se consacrer au texte musical, le chef est parti du sens profond des textes mis en musique afin d’y trouver la traduction musicale la plus idoine qui soit. On sait l’importance que Lully accordait aux poèmes qu’il mettait en musique, cherchant à en illustrer les moindres accents et les multiples images. Qu’il s’agisse de la prose des morts, du fort beau texte paraliturgique de Pierre Perrin ou du psaume 129, les mots sont ici sculptés, ciselés au prix d’un vrai travail d’orfèvre qui trouve son pendant dans la prise en compte extrêmement attentive du discours musical. Celui-ci s’éclaire en effet ici, devenant parfaitement intelligible, tant la musique qui lui est organiquement liée s’affirme comme une prolongation évidente de celui-ci. Tout semble tellement vécu de l’intérieur, ressenti avec une telle intensité qu’on se demande comment ces pages ont longtemps pu être considérées comme froides et parées d’une foi purement extérieure quand s’offre ici la démonstration éclatante d’une exacte antithèse à l’égard de ces jugements infondés.
On pourrait s’étonner de prime abord de la relative lenteur sur laquelle s’ouvre le Dies Iræ. En effet, point de colère ici, ni de cette humeur fiévreuse mais l’annonce d’une terrible prophétie sur la fin des temps et la certitude d’un jugement ultime qui s’imposera à l’humanité au travers de cette citation du plain-chant sur laquelle Lully fonde son récit de basse inaugural (remarquable Renaud Bres). La terreur s’empare du chœur lors du Quantus tremor avant que n’éclate le tumulte du Tuba mirum avec ses gammes ascendantes sur spargens passant d’une partie à l’autre. Plus loin, le Rex tremendæ laisse retentir sa puissante apostrophe au monarque suprême, les voix mêlant à leur formidable résonance des sanglots implorant la fons pietatis. Parmi les six récits de basse que compte ce grandiose motet, le Recordare offre ici une prière ardente à laquelle répond plus loin celle de l’Oro supplex, qui ne lui cède en rien. L’Ingemisco, le Qui Mariam comme le Preces meæ sont des appels vibrants à la miséricorde divine. Certains récits se prolongent grâce à une basse continue quasi vocale dans ses intentions comme ces petits récits de viole quasi improvisés qui commentent, relient les séquences entre elles jusqu’à un quasi silence, miroir de l’indicible. Et peut-il en être autrement lors d’un deuil pour lequel cette extraordinaire musique a été écrite ? L’Inter oves se fait berceuse quand le Confutatis rageur s’incline vite devant le splendide dialogue du Voca me entre solistes et orchestre que le chœur vient amplifier, conférant à la supplique une échelle universelle. Mais deux moments retiennent encore davantage l’attention. Le Lacrymosa est à couper le souffle, tant par la beauté de son contrepoint que l’atmosphère sépulcrale qui s’en dégage. Ses sauts de sixtes mineures nous arrachent véritablement des larmes. Le Pie Jesu final, quant à lui, vient porter l’émotion à son comble, son mélancolique prélude préparant l’entrée de la taille (magnifique Marc Mauillon) rejointe par la haute-contre poussant jusqu’à la ligne de crête (Clément Debieuvre si sensible) l’oraison avant que le chœur ne vienne implorer d’accorder le repos éternel aux âmes, s’élançant dans un Amen vertigineux par son travail contrapuntique et débouchant sur une cadence une saisissante beauté.
O Lacrymæ constitue une vaste page essentiellement chorale qu’anime un souffle grandiose. La première section établit un climat d’affliction préparée par un « grave et dévot » prélude en ré mineur avant que la haute-contre (Cyril Auvity ici au zénith - sa voix s’envolant littéralement lors de la reprise de ce volet introductif) rejointe par d’autres solistes ne vienne inviter aux larmes conduisant à l’entrée du chœur en imitations des dessus jusqu’aux basses sur Exite nostris cordibus. Les figuralismes sur Rorate illustrent les pleurs s’écoulant des yeux comparés à des fontaines, alimentant un contrepoint de plus en plus fleuri. Débute alors une deuxième section, d’une expressivité hors du commun qu’introduit une originale ritournelle à trois dessus d’une inspiration toute italienne, émaillée de dissonances savoureuses. Le chœur de flûtes à bec (instruments associés à la représentation de la mort et des pompes funèbres à l’époque baroque) d’une beauté absolue introduit les voix sur O fons amoris, sommet émotionnel du motet. Vient ensuite un épisode dialogué où alternent chœur et trio (sur des marches d’harmonie toute italiennes également) sur Non in gaudio, non in jubilo. Et à la massive invocation du nom de Jésus succède une nouvelle section, assez agitée, où l’orchestre s’anime avec ardeur pour faire place à une exultation voilée (toujours empreinte de ce même ré mineur). Une saisissante transition modulante sur Nos peccatores (on frissonne toujours avec ce la bémol aux basses, qui amorce une descente chromatique relative aux péchés qu’il nous faut pleurer) jusqu’à ce que retentisse une clameur intense qui retombe sur la réintroduction du premier volet venant conclure cet extraordinaire motet dont on ignore la date précise de composition (Jérôme de La Gorce évoque le début des années 1660) comme la destination (cérémonie funèbre ? musique pour le carême ?). Stéphane Fuget et les siens en font un point culminant de ce premier volume, en en soulignant toute la splendeur.
Le Mercure relate que « M. de Lully s'est attiré de nouveaux applaudissements par un De Profundis qu'il a fait chanter devant le Roy après que tous les prétendants à la maîtrise de la chapelle de Sa Majesté eurent fait entendre leurs divers motets. Outre la beauté de la musique, toute la cour admira la justesse des expressions qui répondaient au sujet, et c'est ce qui fait la différence d'un habile maître de musique d'avec un médiocre ou un méchant ». Vu son succès, ce somptueux motet occupa une place de choix, aux côtés du Dies Iræ, lors des funérailles de la Reine Marie Thérèse, en la basilique de Saint-Denis. Je ne reviendrai pas sur les qualités architecturales confondantes de cette œuvre, ni sur son incroyable pouvoir expressif. Mais il m’est impossible de passer sous silence le Quia apud te de Claire Lefiliâtre si bouleversant (quelle voix sait à ce point agrémenter une ligne de chant avec un tel naturel au service d’une émotion véritablement incarnée?) pas plus que la tendresse ineffable du Quia apud Dominum où instruments et voix se laissent gagner par une douceur réconfortante immédiatement dispensée en retour, avant qu’une joie contagieuse ne s’empare du chœur dans l’Ipse redimet Israël. En écho au Pie Jesu du Dies Iræ requérant quasiment les mêmes paroles, le Requiem final vient conclure cette immense oraison funèbre en faisant se succéder deux épisodes aussi contrastés que possible : le premier contrapuntique aux multiples suspensions, le second rempli d’une énergie électrisante (magnifique attaque de Marie Perbost sur Et lux perpetua) conduisant à une fin presque abrupte, image d’une âme qui s’échappe vers l’au-delà.
Voilà donc une réalisation somptueuse, servie par des effectifs nourris (ils sont absolument nécessaires chez Lully dont la musique a été pensée pour des moyens exceptionnels) emmenés par une direction magistrale sans la moindre faille. C’est de mon point de vue, l’un des plus grands enregistrements jamais consacrés à ce compositeur. Et si notre admiration ne connaît point de bornes, c’est qu’à l’expérience musicale répond ici une expérience spirituelle, qui investit ces œuvres en profondeur pour en livrer tout le sens ! Il nous tarde de découvrir les prochains opus qui sauront faire place à la louange et la joie (on imagine déjà le Te Deum comme on espère ardemment l’extraordinaire Benedictus, autre motet époustouflant de maîtrise). Quoiqu’il en soit, Lully est sauvé, à n’en point douter : il a trouvé en Stéphane Fuget et ses Epopées ses meilleurs intercesseurs.
>
Publié le 17 avr. 2021 par Stefan Wandriesse
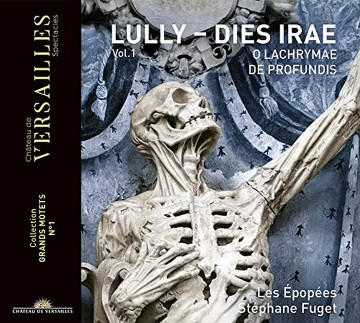 ©
©