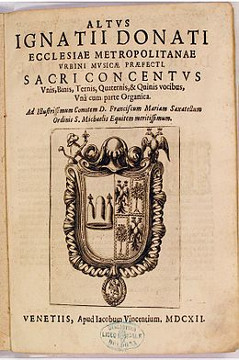The heritage of Monteverdi - J. Tubéry
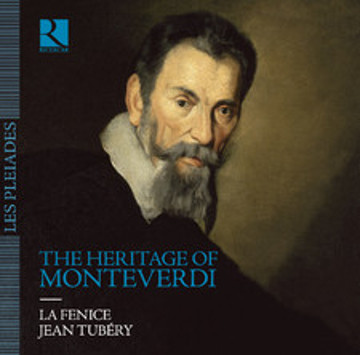 ©akg-image / Erich Lessing. Bernardo Strozzi, Portrait of Claudio Monteverdi, Innsbruck, Tirol Landesmuseum
©akg-image / Erich Lessing. Bernardo Strozzi, Portrait of Claudio Monteverdi, Innsbruck, Tirol Landesmuseum Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret bilingue (français-anglais) de Jean Tubéry, 7 CD, d'environ une heure chacun. Ricercr Outhere. 2017
Compositeurs
- Dario Castello (?-? )
- Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
- Girolamo Kapsberger (1580-1651)
- Biagio Marini (1587-1663)
- Claudio Monteverdi(1567-1643)
- Tarquinio Merula (1594-1665) ea
Chanteurs/Interprètes
- Maria Cristina Kiehr (soprano), Kathelijne Van Laethem (mezzo-soprano), Stephan Van Dyck (ténor), John Elwes (ténor), Ulrich Messthaler (baryton)
- Ensemble La Fenice :
- Cornets : Jean Tubéry, Yoshimichi Yamada, Gebhard David, Frithjof Smith
- Violons : Enrico Parizzi, Roberto Falcone
- Alto, viola da braccio : Enrico Parizzi
- Orgue, clavecin : Jean-Marc Aymes, Jörg-Andreas Bötticher
- Violes de gambe, lirone : Paulina Van Laarhoven, Arno Jochem, Imke David
- Archiluth, chitarrone : Matthias Spaeter
- Théorbe : Christina Pluhar
- Trombones : Jean-Jacques Herbin, Serge Guillou, Ole Andersen, Franck Poitrineau
- Basson : Jérémie Papasergio
- Direction : Jean Tubéry
Pistes
- 1.CD1 - Dialoghi Venetiani
- 2.CD2 - Per la Settimana Santa
- 3.CD3 – Biagio Marini : Moderne e curiose inventioni
- 4. CD4 – Dario Castello : In stil moderno
- 5.CD5 – Per il santissimo natale
- 6.CD6 – Il canzoniere – La poesia di Francisco Petrarca nel seicento
- 7.CD7 – Concerto Imperiale
Quand des rebelles se mirent à façonner la musique baroqueThe Heritage of Monteverdi. Un anglicisme doublé d’un malentendu ouvrent un coffre à trésors abondamment garni. Expliquons-nous. Si Claudio Monteverdi (1567-1643) éclaire le titre de ce coffret très soigné, il est loin d’en être le personnage principal (moins de 32 minutes sur près de 430 minutes d’écoute). En outre, le terme « héritage » suggérant l’idée de transmission d’un patrimoine, nous espérions un condensé de l’immense répertoire de ce compositeur. Or, contre toute attente ou en toute naïveté, nous voilà entourés d’une cohorte de musiciens s’activant à bouleverser les règles de la musique italienne de la première moitié du XVIIème siècle. En plongeant dans la discographie de l’Ensemble La Fenice et de Jean Tubéry, nous pensons deviner l’origine de ce titre équivoque. En effet, ce coffret résulte d’un assemblage de sept CD enregistrés et diffusés sous le label Ricercar entre 1995 et 2000. La plupart d’entre eux avaient été regroupés dans une collection alors nommée « L’héritage de Monteverdi ». Ils ont été opportunément regroupés, sous ce même titre… anglicisé, pour souhaiter un excellent 450ème anniversaire à l’un des instigateurs de cette vague subversive qui a donné naissance à la musique aujourd’hui qualifiée de « baroque ».
Cette révolution esthétique était en marche depuis le XVIème siècle, particulièrement en Italie. S’il n’en est pas le promoteur, Monteverdi en deviendra l’un de ses plus ardents artisans. Dans leur introduction à la traduction de L’Artusi, ou des imperfections de la musique moderne (1600) du moine Giovanni Maria Artusi (1540-1613), Xavier Bisaro et Pierre-Henry Frangne (Presses universitaires de Rennes – 2008) éclairent remarquablement l’amateur curieux sur le contexte et les ressorts de cette profonde transformation culturelle : « ce bouleversement (a engendré) une nouvelle façon de faire de la musique, de la théoriser et de l’expliquer, mais aussi de l’écouter et de la comprendre ».
Schématiquement, lorsque le XVIème siècle bascule dans le XVIIème, deux écoles musicales s’affrontent en Italie. La prima prattica veut rester fidèle au style ancien dans lequel la science du nombre apporte à la musique une garantie d’unité, d’harmonie et d’équilibre. Rien de plus naturel pour ses adeptes, la musique étant inscrite au programme d’un cycle scolaire solidement établi, le quadrivium, où elle côtoie l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie. Pour la seconda prattica (le style moderne), l’« efficacité » de la composition musicale se mesure à sa capacité à exprimer et communiquer à l’auditeur les affetti (sentiments) enfouis dans les textes poétiques. Cette distinction aux frontières incertaines présente bien des analogies avec celle qu’adoptera Blaise Pascal (1623-1662) pour exposer les deux manières d’aborder le domaine de la connaissance : l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse.
Les défricheurs de la Nuove musiche, comme la nomme Giulio Caccini (1551-1618) dans un texte paru en 1602, entrent en dissidence sur au moins quatre points. Premièrement, ils veulent libérer la mélodie du contrepoint strict qui la corsète : avant toute chose, la musique doit produire un « chatouillement » des sens (défini comme une « volupté corporelle » par René Descartes (1596-1650) dans son Traité de l’Homme-1664). Deuxièmement, ils veulent parler autant aux sens qu’à la raison, au corps aussi bien qu’à l’âme. Ils considèrent donc que la musique doit être « la servante de la parole, de manière à laisser comprendre le contenu expressif du chant ». Troisièmement, ils abandonnent l’abstraction de l’arithmétique pour le pragmatisme de l’expérimentation, faisant évoluer les instruments autant que les modèles d’écriture. Par le primat donné à l’expérimentation, les praticiens (compositeurs et interprètes) prennent leur revanche sur les théoriciens (souvent des ecclésiastiques), jusque-là maîtres incontestés et gardiens scrupuleux de la tradition musicale. Quatrièmement, la musique fait son aggiornamento, s’adaptant à la montée de l’individualisme qui s’affirme depuis la Renaissance. Elle ne s’écrit plus en référence à un idéal de beauté abstrait (celui de Platon) mais en fonction des individus bien réels qui constituent l’auditoire. Car « pour déterminer ce qui est agréable, il faut supposer la capacité de l’auditeur, laquelle change comme le goût, selon les personnes » (Descartes – Lettre à Mersenne – janvier 1630). En définitive, émotion et raison constituent désormais les deux cibles privilégiées des compositeurs ; expérimentation et individualisation, leurs deux moyens pour tenter de les atteindre.

Girolamo Kapsberger
CD1 - Dialoghi Venetiani : Venise, laboratoire de la seconda prattica
Le programme, confié aux Sonatori (instrumentistes), est structuré autour de sept Sonates qui encadrent diverses pièces instrumentales inspirées de danses traditionnelles ou de chansons anciennes. Pour mémoire, la sonate « naît à la fin du XVIème siècle en Italie (il n’y a quasiment pas de sonate non italienne avant les années 1650). Elle est donc contemporaine de l’invention du violon et de l’apparition de la basse continue » précisent Eugène de Montalembert et Claude Abromont (Guide des genres de la musique occidentale-2010).
Jean Tubéry livre ici un échantillonnage de sonates associant le « vieux » cornet à bouquin (cornetto) au « tout jeune » violon pour mettre en valeur la ligne mélodique autant que les instruments. Quant à elle, la basse continue est confiée à l’orgue et au théorbe. La Sonata sesta per due canti (1630) de Guiseppe Scarani (actif entre 1628 et 1642) et la Sonata terza per violoni o cornetti (1655) de Biagio Marini (1587-1663) semblent inspirées par le même esprit que la Rappresentatione di Anima et di Corpo (1600), drame sacré d’Emilio de’ Cavalieri (1550-1602). Le cornet, dont la sonorité imite si bien la voix humaine, et le violon, souvent associé aux harmonies célestes, incarnent respectivement le corps et l’âme. De monologues en dialogues sans paroles, ils s’interpellent et se répondent, souvent sur le mode de l’imitation. Le timbre chaud et charnu du cornet contraste délicatement avec la vibration et le frottement feutré du violon. Deux autres sonates révèlent une autre caractéristique de la seconda prattica. La Sonata prima per canto solo (1629) de Dario Castello (actif durant la 1ère moitié du XVIIème siècle) et la Sonata per il violino solo, per sonare con due corde (1626) de Biagio Marini déploient une agilité caractéristique du stile concitato (agité) dont Monteverdi fera grand usage dans ses opéras. Leurs différentes sections sont parsemées de trémolos, de trilles et de traits dignes des premiers virtuoses italiens. Jean Tubéry (cornetto) dans la première et Enrico Parizzi (violino) dans la seconde, font parler leurs instruments avec adresse, faisant briller les ornements de tous leurs éclats. Les trois pièces restantes révèlent toutes une personnalité singulière. La Sonata a 3 (1656) de Francesco Cavalli (1601-1676) développe une belle fugue dès l’entrée. Lui succède une suite de mouvements chromatiques chamarrés. La Sonata in dialogo, detta la Viena (1613) de Salomone Rossi (1570-1630), surnommé Rossi Hebreo pour rappeler qu’il est de confession juive, suggère une polyphonie sacrée dans laquelle les instruments couplés se partagent la mélodie. Le cornet est associé à l’orgue alors que le violon et le théorbe forment la paire. Si cette pièce suggère à peine la formule de la polychoralité, la Sonata terza per due soprani (1629) de Dario Castello, du moins dans sa partie finale, la développe sans détour. Les sections s’y succèdent dans une alternance de passages vifs et lents, de séquences bouillonnantes suivies de temps de repos : une manière de faire respirer l’auditoire au rythme des instruments. La pièce s’achève sur une écriture en imitation à la manière des deux chœurs de la basilique Saint-Marc de Venise : ils se répondent avant de s’unir dans un final révérencieux.
Les autres pièces instrumentales appartiennent principalement au domaine de la danse. Giovanni Picchi (actif entre 1600 et 1625 à Venise) développe une Pass’e mezzo qui « se danse en faisant quelques tours par la salle avec certains pas posés, et puis en la traversant par le milieu, comme le mot le porte » (Toinot Arbeau (Jehan Tabourot) – Orchésographie et Traité en forme de dialogue par lequel toutes les personnes peuvent facilement apprendre et practiquer l’honneste exercice des danses – 1588). La distribution instrumentale est emblématique de la renommée de ce virtuose des instruments à claviers : Jörg-Andreas Bötticher assure la voix du dessus au clavecin et Jean-Marc Aymes la soutient à l’orgue. Dans le premier mouvement, le clavecin expose le thème ; dans le suivant, l’orgue s’empare du premier rôle en développant une première variation joliment ornée. Les mouvements suivants confirment cette alternance, quittant peu à peu le tempo calme de cette danse pour s’engager sur la voie d’une virtuosité raisonnable. A nos yeux, la Bergamasca (1640) de Girolamo Kapsberger (1580-1651) constitue un joyau sonore ensorcelant. Dans cette danse traditionnelle de Bergame, les couples sont disposés en cercle. Le basso ostinato (basse soutenue) bat un rythme métronomique permettant au théorbe de Christina Pluhar de s’amuser avec les notes entre deux ritournelles espiègles jouées à l’orgue. L’allure populaire de la ligne mélodique et les variations d’une beauté épurée donnent un air de fraîcheur à cette pièce qu’on ne se lasse pas d’écouter! Bien que construite à partir du même air, l’Aria sopra la Bergamasca (1642) de Marco Uccellini (1603-1680) résulte d’une démarche plus savante. Elle s’inscrirait davantage dans la catégorie « Thème et variations ». Le cornet et le violon portent successivement la mélodie pendant que son partenaire l’enrichit d’ornements expressifs. Dans la courte Passacaglio (1640) de Girolamo Kapsberger, Enrico Parizzi assure la basse obstinée avec une viola da braccio (viole de bras) dont la sonorité lointaine rappelle celle d’un verrillon (verre musical). Et ce n’est pas le caractère paisible et contemplatif du Venite, siscientes, ad aquas de Monteverdi qui y mettra un terme, tant cette pièce écrite pour voix seule et basse continue appelle à la méditation. Ici, la partie vocale écrite par Monteverdi est assurée par le cornet muet de Jean Tubéry. Une belle illustration de la proximité de la tessiture de la voix humaine et de celle du cornet. La Toccata (1623) rêveuse d’Alessandro Piccinini (1566-1638), interprétée par Christina Pluhar au théorbe, est tout aussi reposante. Enfin, tous ces remarquables interprètes se rassemblent pour un cadeau final : une époustouflante Chiaccona a 3 (1637) de Tarquinio Merula (1594-1665). Les instruments s’élancent dans une danse vive où l’orgue, le clavecin et le théorbe assurent un ostinato résolu alors que le cornet et le violon s’abandonnent à l’allégresse.

Bonifazio Graziani
CD 2 – Per la settima Santa : en route vers l’Oratorio
Le programme du CD est construit sur le principe de l’alternance de pièces vocales et instrumentales. Si les sons suscitent de l’émotion, les mots portent le sens. L’art du compositeur consiste à conjuguer ces deux types d’instruments pour produire le plus grand effet sur son auditoire.
De ce point de vue, le O vos omnes (1621) d’Alessandro Grandi (1590 ?-1630) en constitue une illustration parfaite. Une courte pièce instrumentale ouvre le motet. L’orgue et le cornet installent une ambiance sonore lugubre préparant l’évocation des Lamentations de Jérémie (1, 12). Ils poursuivront leur œuvre en se faufilant, en guise de ritournelle, entre chacune des strophes. Le ténor John Elwest interprète une forme de madrigal monodique en mettant littéralement le texte en scène. Ce figuralisme est particulièrement convaincant dans le court silence qui suit le mot attendite (demeurez) ou lorsque le flagellavit est accompagné d’un trait cinglant du théorbe. Le caractère tourmenté du texte est exprimé par un tempo haché, constitué d’une succession rapide d’accélérations et de décélérations. Enfin, le traitement du dolori meo (ma douleur) illustre les différents stades de la douleur. A chacune des apparitions de ces termes, l’intonation évolue : d’abord chantés dans un murmure, ils deviennent une plainte avant d’exprimer la souffrance amplifiée par une dissonance fermement appuyée. Une œuvre à la hauteur d’un compositeur qui, le premier, a employé le terme de « cantate » pour désigner des pièces monodiques comportant plusieurs strophes chantées sous le patronage de la basse continue. Le figuralisme du O sacrum convivium (1610) de Giovanni Paolo Cima (1570-1622) se montre plus tempéré. Seules quelques sages vocalises soulignent les termes essentiels de ce chant liturgique écrit pas Thomas d’Aquin (1225-1274) pour célébrer le Saint Sacrement. En revanche, c’est à une musique à double dimension spatiale que nous convie le compositeur. D’attendrissants jeux d’échos embellissent la monodie plutôt conventionnelle confiée à Maria Cristina Kiehr. Au terme de chaque verset, voire de certaines portions de versets, le cornet muet et le théorbe résonnent en arrière-plan. La voix franche et claire de la soprano et la sonorité diaphane et lointaine des deux instruments forment un effet de contraste saisissant. L’extrait Dic mihi, sacratissima virgo du Sacrorum concertuum (1610) de Giovanni Francesco Capello (en activité à Venise entre 1610 et 1619) représente le dialogue presque oppressant entre un anonyme (Animus : l’âme, selon le livret) et la Vierge Marie, après la crucifixion du Christ. Le compositeur s’inscrit délibérément dans la seconda prattica, notamment par l’emploi de tremblements (tremula/tremblant), d’altérations glissant vers des dissonances (Heumi/Hélas) et de chromatismes expressifs (ac nimio dolorem/une immense douleur) dans le discours de la Vierge. Il introduit également une dimension dramatique dans ce dialogue, transposant dans la musique d’église les premiers effets expérimentés sur les scènes d’opéras. La tendance à la théâtralisation de la musique d’église est plus perceptible encore dans le Stabat mater, dolorosa de Giovanni Felice Sanses (1600-1679). Cette pièce est publiée en 1636, la même année que son opéra aujourd’hui perdu, Ermione. La proximité temporelle de l’écriture de ces deux textes a certainement influé sur le style de leurs écritures respectives. Cette séquence, plutôt sobre en ornements, adopte en revanche la structure d’un récitatif accompagné (recitatio accompagnato) auquel l’opéra a déjà donné ses premiers titres de noblesse. Les instruments de la basse continue annoncent, commentent et prolongent le texte, le plaçant en quelque sorte dans un écrin sonore. Par une diction impeccable exaltée par son timbre argentin, Maria Cristina Kiehr sert un texte empreint d’émotion.
Au cœur du programme de ce disque, une suite de sept pièces constitue l’embryon d’un Oratorio miniature. C’est du moins ce que nous nous plaisons à imaginer en les regroupant selon le schéma tripartite de ce genre musical naissant : la Sonata per cornetto e trombone de Cima fait office de sinfonia, les morceaux suivants tiennent lieu de récitatifs tandis que le duo final préfigure le chœur conclusif d’un Oratorio, lorsque ce genre sera parvenu à maturité. Cette suite de pièces raconte les épisodes de la mort et de la résurrection du Christ. Dans le madrigal spirituel Peccator Pentito (Le pécheur repentant-1620), Biagio Marini exprime l’émotion douloureuse qui étreint le chrétien confronté aux derniers instants de la vie du Christ. Dans la Passacaglio (1623) de Domenico Piccinini, l’archiluth de Matthias Spaeter projette l’image du spectacle macabre d’une vie qui s’éteint et, dans un mouvement mélodique ascendant, celui de l’élévation de l’âme du Christ vers Dieu. Au même moment, Domenico Mazzocchi (1592-1665) installe sur scène une Marie-Madeleine célébrant les lagrime amare (larmes amères-1638) aux vertus libératrices. Mais déjà, le Christ ressuscité engage le dialogue avec les pleureuses dans le Mulier, cur ploras hic (Femme, pourquoi pleures-tu ?-1625) d’Adriano Banchieri (1568-1634). Intimiste dans ses débuts, il s’achève dans l’allégresse d’un Alleluia exalté en duo. L’Oratorio que nous avons imaginé s’achève par les épisodes de la Résurrection et de l’Ascension. Monteverdi exalte un Et resurrexit (1640) resplendissant quand Bonifazio Graziani (1604 ?-1664) illustre la félicité de Marie dans un Regina coeli laetare (1658) particulièrement éblouissant et d’une belle inventivité mélodique. Jean-Baptiste Lully (1632-1687) y a manifestement trouvé une source d’inspiration pour son motet LWV 77/12 du même nom. Cette succession ordonnée de textes nous paraît représentative de l’écriture nouvelle, synthèse de deux tendances culturelles majeures : celle des Humanistes dans leur recherche de la pureté de la musique antique et celle des Ecclésiastiques, à l’issue du Concile de Trente (1545-1563). Ces deux mouvements, convergent vers deux priorités : l’intelligibilité du texte et l’expression des émotions. Appliquées à la dévotion, elles conduisent un Marini à délaisser la sobriété du plain-chant pour emprunter aux madrigaux profanes leur richesse mélodique, un Mazzocchi à parsemer la plainte de Marie-Madeleine de portamentos dans lesquels la voix glisse en douceur entre deux notes pour mieux signifier le désespoir ou un Banchieri transformant le chant alterné du repons en duos vocaux dignes d’une scène lyrique.
Comme dans les futurs opéras du Grand Siècle, l’évocation d’une chaconne s’impose en fin de programme. La pulsation d’un ostinato rythme fermement la section finale du jubilatoire Laudate Dominum, a voce solo (1640-1641) de Monteverdi et soutient de bout en bout l’entraînant Capriccio sopra 7 note (1660) de Maurizio Cazzati (1620-1678). De toute évidence, la musique da camera (de chambre) et da chiesa (d’église) ont désormais opéré leur jonction, leurs différences devenant de moins en moins perceptibles. Et plus encore dans les deux dernières pièces enregistrées. Dans le cérémonial liturgique, elles peuvent correspondre au rite du renvoi. Une Toccata per organa brillante et virtuose de Giovanni Salvatore (1611-1688) donne aux fidèles le signal de la sortie. Celle-ci est accompagnée par un somptueux Exultate Christo adiutori nostro (1643) de Michelangelo Grancini (1605-1669) chanté par les voix d’hommes accompagnées par tous les instruments à vent et à cordes. Ces deux pièces témoignent de l’accès à la maturité de la musique du premier baroque. Le pragmatisme des débuts va désormais céder la place à une nouvelle phase de conceptualisation et de codification. Bien des compositeurs s’y appliqueront comme, pour ne prendre qu’un exemple, l’italianisant Marc-Antoine Charpentier (1636-1704) lorsqu’il rédige ses Règles de composition (1690) et qu’il tente d’établir de subtiles correspondances entre les tonalités musicales et les affetti.
La vision panoramique des deux premiers CD a permis de découvrir, par l’exemple, l’exubérance de la nouvelle musique italienne de la première moitié du XVIIème siècle. Les deux galettes suivantes nous invitent à poursuivre l’exploration, mais en nous focalisant sur deux répertoires spécifiques : celui de Biagio Marini et de Dario Castello.

Biagio Marini
CD 3 – Moderne e curiose inventioni : le langage métissé d’un musicien nomade
Biagio Marini fut sans doute l’un des premiers virtuoses itinérants, parcourant l’Italie du Nord et l’Europe centrale, du Danube à Bruxelles, avant de retourner en Italie. De ses pérégrinations, il rapporte un lot de Moderne e curiose inventioni (inventions modernes et curieuses) qui enchantent le troisième CD du coffret. Dans une scénographie astucieuse, Jean Tubéry fait entendre treize pièces extraites des recueils publiés par Marini entre 1617 (Affetti musicali) et 1655 (Lagrime di Davide sparse nel miserere). Comme le souligne l’acclamation (Viva, Viva da Soranzo) incrustée dans l’Aria La Soranza (1617), il dédie tout à fait explicitement ces pièces à une famille patricienne de la Cité de Venise, dont le portrait du Procurateur Jacopo Soranzo a été peint par Le Tintoret (1519-1594) vers 1550. Cette lignée a donné à Venise des magistrats, cardinaux et militaires, dont Benedetto Soranzo qui s’est distingué lors de la Bataille de Lépante (1571) en faisant exploser sa galère, avec tout l’équipage survivant, plutôt que de la livrer aux Turcs. Les pièces sont interprétées successivement dans le salon (da camera) puis dans la chapelle (da chiesa), illustrant à merveille la musique domestique qui résonnait alors dans les foyers aisés.
Les sept pièces profanes s’ouvrent sur une Canzon octava (1629) particulièrement majestueuse. Les cordes babillardes sont emportées dans l’explosion sonore des deux cornets et des quatre trombones. L’écriture de cette courte pièce laisse entrevoir la perfection contrapunctique du stile antico et la technique du double chœur en vogue à la basilique San Marco. Et c’est précisément en cherchant à imiter la puissance des chœurs que ces instruments participent à la révolution musicale en mouvement. En effet, d’abord relégués dans une fonction subalterne d’accompagnement, les instruments commencent peu à peu à remplacer les voix manquantes. Bientôt, ils sauront si bien imiter la capacité de la vox naturalis (voix humaine) qu’ils formeront, à eux seuls, « le concert». Marini est l’un des artisans majeurs de cette grande mutation. Il va d’ailleurs le montrer dans deux pièces qui se suivent. Dans la première, Maria Cristina Kiehr interprète une chanson populaire Madre non mi far monaca (Mère, ne me fait pas nonne) racontant, de façon un peu crue à l’égard de la Mère Abbesse, l’histoire d’une jeune fille forcée à devenir religieuse. Suit aussitôt la Sonata sopra la Monica (1629) qui reprend le thème de cette chanson et le soumet à des variations chantées en trio par deux violons et une viole de gambe. Cette égalité nouvelle entre les voix et les instruments se signale également dans la Grotte ombrose, madrigale in echo con sinfonie (1649) lorsque le double écho est produit aussi bien par la voix que par les instruments. Avec une admirable science de la nuance, Maria Cristina Kiehr fait bondir la dernière syllabe de chacune des strophes jusqu’au fond de la grotte, parfaitement imitée en cela par le cornet de Jean Tubéry. Cette pièce imprègne l’auditeur de son charme envoûtant.
Les quatre premières pièces à vocation religieuse sont confiées aux instruments, particulièrement à l’orgue et aux cornets. Elles sont teintées de recueillement, donc conformes aux directives ecclésiastiques. La Sonata per organo e cornetto renvoie l’image classique du chanteur accompagné par l’orgue. Mais ici, le timbre du cornet étant proche de celui de la voix humaine, c’est l’instrument qui remplace le chanteur. Cette proximité incitera d’ailleurs la facture d’orgue à intégrer la voce umana (Voix Humaine) dans la famille des Jeux d’anches. De plus, son caractère ondulant peut être mis en relation avec la Sonata La Foscarina. Dans son quatrième mouvement, se déploie l’un des premiers trémolos assumés de l’histoire de la musique instrumentale. D’ailleurs, conscient de la nouveauté, Marini l’avait signalé dans le titre de sa pièce (Sonata a tre con il tremolo), annotant la partition elle-même à destination des violons (tremolo con l’arco) ou, comme ici, des cornets. Moins de dix ans plus tard, Monteverdi « redécouvrira » cette technique transposée de la partie vocale à la partie instrumentale. Il représentera les passages concernés sous la forme d’une longue suite de croches répétées en succession rapide. Le programme s’achève autour du Psaume 51/50 qui aurait été écrit par le roi David demandant pardon pour avoir séduit Bethsabée. La Passacalio a quattro résonne de façon lugubre, installant une atmosphère livrée au pathos et préparant l’expression de la culpabilité de David. Le Miserere a tre voci est en soi une œuvre de synthèse, mêlant plain-chant et partition d’opéra. Découpé en courtes strophes composées de deux versets chacune, Marini fait alterner une strophe chantée sur le mode du faux-bourdon, la suivante étant livrée à la polyphonie. L’écriture de ces dernières est d’une richesse extraordinaire, totalement sous l’influence de la stile rappresentativo : les mots-clés sont chargés d’émotion par leur répétition ou les vocalises qui les empoignent, le tempo participe à la théâtralisation du texte, le figuralisme se saisit de certains passages comme le fugato à trois voix pour évoquer le Saint-Esprit. Le Gloria patri final s’ouvre sur passage éblouissant avant de s’achever par un Amen s’éteignant dans le recueillement.

Dario Castello
CD 4 – In stil moderno: l’avènement du violon virtuose
La biographie de Dario Castello baigne dans le mystère. Tout juste sait-on qu’il a dirigé une compagnie d’instruments à vent à Venise dans le premier tiers du XVIIème siècle. En revanche, il nous a légué deux recueils de sonates sous le titre révélateur de Sonate concertate in Stil Moderno (1621 et 1629). Chacun des mots qu’il emploie participe à l’énoncé de son projet : le but est de faire sonner (Sonate) au mieux les instruments, les pièces s’adressent à un ensemble instrumental (concertate) et non à un instrument soliste et leur écriture entend se mettre au diapason des goûts du temps (stil moderno). Ils eurent un retentissement considérable dans toute l’Europe musicale.
A l’écoute du quatrième CD pertinemment nommé In stil Moderno, l’auditeur observe que l’originalité de Castello ne réside pas dans les techniques d’écriture comme l’effet de trémolo ou l’évocation de l’écho. S’il use de la première dans le cinquième mouvement de la Sonata seconda per soprano solo, c’est de manière bien plus discrète que Marini. Il ne dédaigne pas l’emploi de la seconde dans le quatrième et surtout le dernier mouvement de la Sonata decima settima per due violoni e due cornetti in ecco. Mais il l’exploite de façon moins raffinée que Marini. Il ne se distingue pas davantage par l’emploi de la forme fuguée qu’il ébauche à peine dans le second mouvement de la Sonata decima quinta per stromenti d’arco. En revanche, c’est dans le domaine de l’ornementation et de la virtuosité qu’il bâtit sa singularité. Voici comment Anne Piéjus définit son style : « Le style de ces pièces faites de sections contrastées, enchaînées ou non, et fondées sur les oppositions de tempo et de caractère, fait la part belle au contrepoint audacieux » (Le Monde de la musique – avril 1993). Les changements de tons et de rythmes incessants captent en permanence l’attention de l’auditeur. Cette agilité étonnante caractérise particulièrement la Sonata decima sexta per strumento d’arco e altri portant le sous-titre Alla Battaglia. Son écriture a la vertu d’une peinture. L’auditeur n’a aucune peine à imaginer « le film » : la montée en ligne des vagues de cavalerie, l’attente des troupes avant que ne sonne la charge, le choc des infanteries, la joie des vainqueurs qui contraste avec le désespoir des vaincus, la solennité de la cérémonie de reddition. Une magnifique description sonore d’une bataille de l’ancien temps à laquelle il ne manque que les coups sourds de l’artillerie. Cette pièce, emblématique du stile concitato (agité), raconte avec des instruments une bataille que Clément Janequin (1485-1558) interprétait en chansons dans sa célèbre Bataille de Marignan (composée vers 1528). C’est en référence au schéma de la rhétorique théâtrale que Castello construit la Sonata decima per due soprani e fagotto (basson). Jean Tubéry en propose une analyse éclairante dans l’excellent livret intégré au coffret. Il y souligne notamment l’ingéniosité de ce compositeur de musique de scène et applaudira son adresse pour charmer l’oreille per chi si diletta in musica (de ceux qui se complaisent dans la musique). Ce musicien aux multiples talents s’est donc montré particulièrement inventif, jouant l’un des premiers rôles dans la transformation de la canzona instrumentale en sonata concertate et donnant aux violons leurs premiers titres de gloire. Mais son art ne reste pas confiné à la musique instrumentale. Pour preuve, son motet Exultate Deo est d’une magistrale vitalité. La ligne mélodique est entonnée par l’orgue puis reprise par le chant limpide de Maria Cristina Kiehr. Une raison de regretter qu’il s’agisse de l’unique pièce sacrée de sa main qui, semble-t-il, nous soit parvenue.
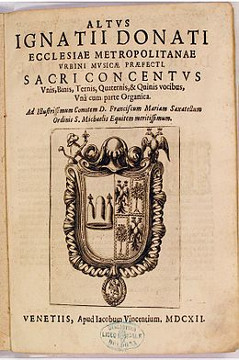
CD 5 – Per il santissimo natale : le répertoire populaire à l’épreuve de la musique expérimentale
Le programme du cinquième CD évoque les différents moments-clés du cycle de la Nativité, de l’Annonciation à la présentation de Jésus au temple. Par la nature des lieux où elle se déroule (l’intimité d’une maison puis le dénuement d’une étable) et la qualité des personnages impliqués (la famille d’un artisan puis des bergers), cette fête est incontestablement d’essence populaire. C’est donc fort logiquement dans la musique populaire que puiseront les compositeurs en charge d’animer les offices de cette séquence du calendrier liturgique.
Ignazio Donati (vers 1570-1638) a le privilège de représenter la scène de l’Annonciation. En pionnier du motet concertato, il répartit le texte de sa composition Angelus Gabriel descendit (1618) entre trois interprètes : le conteur (John Elwes), l’ange (Kathelijne Van Laethem) et Marie (Maria Cristina Kiehr). Cette forme préfigure, nous semble-t-il, celle des futures Passions : l’Evangéliste est chargé du récit alors que les autres chanteurs interprètent un rôle. L’orgue déroule sommairement la ligne mélodique à partir de laquelle les chanteurs prennent successivement la parole. Le timbre céleste de l’ange paraît légèrement décalé dans l’espace sonore. Une manière d’illustrer le cantar lontano (chanter de loin) dont Donati a, le premier, décrit les techniques et les méthodes d’exécution dans son traité Sacri concentus (1612). Ces monodies accompagnées par une basse continue sobre et raffinée se muent soudain en un fugato tressaillant, amplifié par le cornet muet, pour saluer l’acceptation par la Vierge de sa mission. Et c’est dans l’allégresse que Maurizzio Cazzati fait chanter à Maria Cristina Kiehr un air bondissant aux accents manifestement populaires pour saluer l’Alma redemptoris mater (Bonne Mère du Rédempteur). Une exubérance qui se transforme en pure jouissance sonore s’éteignant dans les bras de la Mère protectrice des pécheurs!
Et nous voilà déjà plongés en pleine nuit de Noël. L’Angelus ad pastores ait (1582) est l’œuvre d’un adolescent (SV 222). Monteverdi est âgé de seize ans lorsqu’il compose cette polyphonie bien sage interprétée par deux cornets accompagnés d’une flauto basso, flûte en forme de « J » dont la sonorité est proche du cromorne sur un orgue. Son écriture contrapunctique annonce un grand compositeur… de la prima prattica. Pour sa part, Adriano Banchieri assure la version vocale de l’annonce aux bergers de la naissance de Jésus. Le motet Intonuit de caelo sonus (Du ciel vint une clameur-1613) donne la parole à deux anges (soprano et mezzo-soprano). A tour de rôle, et en variant les tempi, ils énoncent le message aux bergers avec pour seul accompagnement l’orgue, la harpe ou l’archiluth. Le message délivré, ils traduisent le sentiment suscité par cette nouvelle, celle d’un gaudium magnum, une grande joie exprimée dans une forme concertante rendue plus brillante encore par deux cornets qui viennent les rejoindre pour le finale.
Les trois pièces suivantes ne renient pas leur extraction populaire. A l’orgue, Jean-Marc Aymes fait danser une Pastorale (1664) de Bernardo Storace sur une suite de variations de plus en plus ornées. La sonorité de l’orgue évoque celle de la cornemuse pour donner vie à l’une des premières pièces instrumentales portant le nom de « pastorale » pour désigner le chant des bergers. En 1607, Giovanni Gabrieli (1557-1612 ?) avait déjà fait entendre un Quem vidistis pastores ? (Qu’avez-vous vu, bergers ?) en treize parties. Quatre ans plus tard, Antonio Cifra (1584-1629) en donne une version simplifiée et plus sobre. Elle est construite sur le principe d’une monodie se résolvant en polyphonie : une partie en soliste (soprano renforcée par le cornet) interroge les bergers, un duo (mezzo-soprano et ténor portés par les cordes) lui répond avant que le trio ne finisse par faire danser le mot Noë en imitation, jusqu’à l’explosion de l’Alleluia final. Or, l’emploi du mot Noë (Noël) s’attache à une double tradition : liturgique car la triple acclamation « Noël » est chantée à la fin de l’office des laudes durant le temps de l’Avent et jusqu’à la vigile de la Nativité ; populaire, comme en France, où il était d’usage de « crier Noël pour signifier la joie publique » (Estienne Pasquier– Les Recherches de la France - 1660). Enfin, la tradition populaire s’impose dans le troisième couplet du Volate caelites (Volez, êtres célestes-1648) d’Orazio Tarditi (1602-1677) lorsque le Dicite canticum murmure placido (Dites votre cantique d’une voix douce) est accompagné par un délicieux fagotto (basson) ponctué par un ostinato imitant la sonorité d’une vielle à roue. La place donnée à la flûte dans la Sonata a tre, due violoni e flauto de Giovanni Picchi (1600-1625) et l’évocation des cloches d’un village dans sa dernière section illustrent parfaitement comment la musique savante traduit le fond sonore dans lequel baignent alors les campagnes.
Avec le Jesu Redemptor omnium (1640-1641) de Monteverdi, nous quittons les fêtes de Noël proprement dites pour entrevoir le destin du nouveau-né. Le texte de cet hymne vient d’être révisé par le pape Urbain VIII (1629). Une certaine liberté s’offre donc aux compositeurs qui le mettent en musique. Monteverdi va en user en faisant alterner un récitant et un chanteur soliste. Au demeurant, la discrétion du continuo accompagnant le soliste favorise l’intelligibilité du texte. Puis, à deux reprises, Jean Tubéry donne la parole à Tarquinio Merula. Dans son Jesu dulcis memoria (1628), il esquisse, avec douceur et tendresse, un Jésus spes paenitentibus (espoir des pénitents). La suavité de sa peinture est notamment soulignée par le mouvement légèrement ondoyant de sa seconde ritournelle. En revanche, la douce berceuse Hor che tempo di dormire (Maintenant, il est temps de dormir-1636) est battue par un ostinato lugubre. Merula peint une atmosphère mêlant la douceur d’une mère qui berce son enfant à la prémonition de son avenir tragique. Cette musique « claire-obscure » dégage quelques accents orientalisants faisant écho aux sonorités résonnant en Palestine à l’époque des faits. Le Nunc dimitis (1613) de Giovanni Antonio Rigatti (en activité de 1613 à 1648) met en musique le Cantique de Siméon. Il y sublime le futur sacrifice en s’attachant à ses effets : la libération des nations de l’emprise du péché originel. La voix et les instruments se partagent les rôles : le ténor transmet le message et les cornets le transportent avec éclat.
Et c’est également dans la chanson populaire que les compositeurs vont puiser leur inspiration pour honorer la mère du Christ. Biagio Marini nous avait déjà fait goûter aux charmes de La Monica (CD3). A priori, tout sépare l’élue de Dieu de cette jeune fille rebelle qui refuse de rejoindre le couvent. Pourtant, Eustache Du Caurroy (1539-1609) empruntera cette même mélodie pour honorer « Une jeune Pucelle » qui, d’abord, ne comprend pas comment elle pourrait concevoir « car jamais n’eus affaire à nul homme qui soyt ». En posant un nouveau texte sur une mélodie ancienne, il opère la transition vers la Vierge. Un anonyme réalisera la même opération avec un texte à couplets décrivant l’Epiphanie : Parton dall’ oriente tre Re per adorar. Cette pièce, tendrement mélancolique, donne alternativement la parole à John Elwes et Maria Cristina Kiehr. Le premier couplet est entonné a capella ; les suivants sont délicatement accompagnés par des instruments qui rejoignent progressivement le concert (la harpe, puis l’archiluth avant la viole de gambe). Girolamo Frescobaldi (1583-1643) interprète à l’orgue, en toute simplicité, la Partita prima sopra l’aria di Monicha dont la mélodie finit par être obsédante, tant elle est sublime.

Jacopo Peri
CD6 – Il canzoniere – La poesia di Francesco Petrarca nel seicento : « la musique est le vêtement naturel de la poésie » (Jean Guichard)
« Avant même la Renaissance et selon des options personnelles tout à fait différentes, saint François d’Assise, Dante ou Pétrarque ont contribué à modifier la sensibilité par un contact plus étroit avec la nature ou en mettant en lumière la qualité du sentiment individuel » signale François Sabatier (Miroirs de la Musique-Fayard – 1998). Et c’est précisément à la Nature que Pétrarque (Francesco Petrarca – 1304-1374) confie ses tourments amoureux suscités par Laure de Sade (1310-1348) dont il était tombé éperdument amoureux, en Avignon, à la sortie de l’office du vendredi saint de l’année 1327. Cette nature est particulièrement présente dans le madrigal A qualunque animale : aria di cantar sestime de Stefano Landi (1587-1639). L’amant malheureux envie les animaux qui trouvent refuge dans les forêts pour s’y reposer alors que lui-même ne trouve aucun endroit pour apaiser sa passion. Des 366 poèmes (sonetti, canzoni, ballate, madrigali ,sestine) que sa muse a inspiré à Pétrarque, Jean Tubéry en choisit une dizaine qui ont été mis en musique par des contemporains de Monteverdi. Il les classe en deux catégories : ceux qui ont été écrits du vivant de Laure (Rime in vita di Madonna Laura) et ceux qui célèbrent son souvenir après sa disparition (Rime in morte di Madonna Laura). Surtout dans la première partie, ces madrigaux alternent avec des pièces instrumentales.
D’un point de vue musical, ces compositions puisent dans le large catalogue des genres et des techniques d’écriture musicale qui s’imposent en Italie dès le premier tiers du XVIIème siècle. Marco de Gagliano (1582-1643) et Jacopo Peri (1561-1633) avaient été complices dans le montage de La Pellegrina (1589) pour la cour des Médicis (voir à ce propos notre chronique consacrée à La Stravaganza d’Amore dirigée par Raphaël Pichon à La Chaise-Dieu le 25 août 2016). Ici, ils déploient deux airs emblématiques du recitar cantando (dire en chantant) où la priorité absolue est donnée au texte. La basse continue assurée par la harpe et la viole de gambe développe une harmonie d’une grande sobriété, comme si elle entendait se tenir en retrait. L’essentiel est dans le chant, témoigne Gagliano à propos de son collègue Péri qui « faisait passer tellement l’émotion des mots chez les autres qu’on ne pouvait s’empêcher de pleurer ou de se réjouir selon la volonté du chanteur » (in Aby Warburg et Bastiano De Rossi - La Pellegrina et les Intermèdes- Lampsaque – 2009). Dans son Io vidi in terra Angelici costumi, Gagliano emploie des vocalises ascendantes pour désigner le soleil, des trémolos pour signifier la doglia (douleur) ou de longues tenues de note pour souligner le terme si intendo (ainsi unis). Quant à Péri, l’accélération du tempo accompagne les battements du cœur de l’amant encore ému par l’apparition de la nymphe séductrice. De même, la répétition per divina belazza indarno mira marque l’errance et le doute qui saisit l’amant qui « en vain cherche la divine beauté ». Au-delà de ces techniques d’écriture, d’autres compositeurs osent mélanger les genres. Ainsi, Sigismondo D’India (1582-1629) entonne un Benedetto sia’l giorno aux tournures grégoriennes, mais en lui appliquant des ruptures de rythmes, des altérations et des tremblements caractéristiques de la seconda prattica. Quant à Martino Pesenti (1600 ?-1648 ?), musicien né aveugle, sa très pastorale Due rose fresche, e colte in Paradisio utilise toutes les techniques en usage, de la fugue aux effets d’écho, du récitatif accompagné au duo, de l’homophonie à la polyphonie et jusqu’à la polychoralité.
Les madrigaux évoquant la douleur de la perte de Laure emploient les mêmes procédés, y ajoutant des tournures propres à communiquer à l’auditoire des sensations de mélancolie et de douleur. Ainsi, le Solo e pensoso de Nicolo Borboni (1614 ?-1641) fait usage du trémolo pour illustrer la fragilité des inscriptions humaines sur le sable (ove vestigio uman l’arena stampi) et utilise la partie instrumentale pour signifier l’aggravation progressive de la souffrance. Si l’orgue entonne le madrigal et accompagne la première strophe, les tressaillements de la harpe suivis des déchirements de la viole de gambe augmentent la tension jusqu’à ce que la voix s’éteigne, remplacée par les longues plaintes du cornet. Dans La bella donna che cotanto amavi (La belle dame que tant j’aimais) de Camillo Lambardi (1560 ?-1634), c’est à la superposition des voix qu’il revient de représenter le trouble croissant. Quelques mesures jouées à la viole de gambe annoncent un duo homophone qui, dans la seconde partie, se disloque avant de se résoudre sur un dolci soavi (douces et suaves) à l’harmonie retrouvée.
Dans ces deux volets, les parties instrumentales remplissent plusieurs fonctions. Quelques tintements de cloches ouvrent La bella dona, comme pour installer une ambiance de funérailles. La harpe de Christina Pluhar traduit douloureusement le déchirement qui suit la perte de l’être aimé. Giovanni Maria Trabacci (1575 ?-1647) confie à l’instrument le soin de représenter le texte Ancidetemi pur, Grieve Martiri (Tuez-moi car je souffre fortement) emprunté à Jacques d’Archadelt (1507 ?-1568). L’amant survivant y appelle à sa propre mort. De la même manière, Oratio Bassani retravaille le madrigal mis en musique par Cipriano di Rore (1516 ?-1565). Si ce dernier avait ajouté des sons pour valoriser le texte, Bassani renonce maintenant aux mots pour donner la parole à la seule viole de gambe, sur des accents qui font songer à Marin Marais. Ainsi, les instruments prennent leur autonomie et les mots n’ont plus l’exclusivité dans l’expression des sentiments. Il arrive même qu’un groupe de mots se transforme en une ligne mélodique qui, à son tour, donnera naissance à une technique d’écriture musicale. C’est le destin promis à ce vers extrait de l’Orlando furioso de L’Arioste (1474-1533) : Ruggier, qual sempre fui, tal esser voglio (Roger, ce qui a toujours été, je veux l’être). La basse obstinée qui s’en extrait durant la période médiévale va servir à de nombreux cycles de variations, dont la Sonata sopra l’aria di Ruggiero de Salomone Rossi. Cette sonate exprime les fluctuations des sentiments qui agitent l’humain lorsqu’il s’arrache à la mélancolie pour mieux y retomber.
L’alliance des sons et des mots trouve cependant de nouveaux terrains d’expression : l’oratorio et l’opéra. Et c’est un peu à ces deux genres que Monteverdi va puiser son inspiration pour mettre en musique son Hor che’l ciel e la terra. Quatre strophes du sonnet 164 de Pétrarque sont littéralement mises en scène. D’abord, dans une paisible homophonie chantée a cappella, la Nature est décrite endormie. Dès la seconde strophe, le narrateur s’éveille. Son état psychologique est disséqué, haché par des silences séparant veglio, penso, ardo (je veille, je pense, je brûle)… avant de pleurer sur un piango longuement tenu. Pour décrire son état civil (guerra è’l mio stato), Monteverdi exploite le registre guerrier dont quelques accents rappellent l’ouverture de son Orfeo (1608). Les voix graves dominent et les cornets résonnent comme des trompettes. Mais cette ambiance belliqueuse disparaît soudainement dans le dernier verset chantant un paisible et sol di lei pensando o qualche pace (et c’est seulement en pensant à elle que je trouve quelque paix). La strophe suivante nous transporte près d’une source vive dans laquelle move’l dolce et l’amaro (coule le doux et l’amer) développé sur un mode chromatique mi- aigre, mi- doux. La dernière strophe décrit les tourments qui tenaillent le narrateur. Pour figurer ses mille morts et renaissances, Monteverdi emploie des stretta, ces entrées vocales resserrées donnant l’impression de la multitude. Cette scénographie est proche de celle de l’opéra et annonce, en quelque sorte, les Grands Motets qui illumineront la fin du siècle.

Claudio Monteverdi
CD7 – Concerto imperiale : quand la seconda prattica brille dans les palais impériaux
« Les compositeurs réunis dans cet enregistrement ont tous eu à titres divers des relations avec la cour impériale » de Vienne, explique Jean Tubéry dans son livret. La musique des cités italiennes s’installe désormais sous les ors des palais impériaux. En composant le menu offert à nos oreilles, il s’est attaché à varier les couleurs et les parfums, veillant particulièrement à leur luminosité.
Les pièces instrumentales dédiées à l’empereur Ferdinand II de Habsbourg (1578-1637) associent intimement les cordes et les vents, jouant sur leurs différences et leurs complémentarités. A ce titre, les deux pièces de Giovanni Priuli (1575 ?-1629) constituent les deux versants d’une même inspiration. L’Ave pulcherrima Virgo est dominé par le timbre musqué des cornets et des trombones quand dans la Sonata prima in due cori la ligne mélodique glisse sur les traits de violons. Si ces deux familles d’instruments développent le même thème, la première imprime une allure solennelle à son développement alors que la seconde fait valoir toute son agilité. Le timbre charnel des vents semble fasciné par la pulchrima Virgo, la « jeune fille qui a de la beauté », selon le Dictionnaire françois de Richelet (1709) ou plongé dans un recueillement cérémonieux s’il s’agit d’une pièce destinée à l’église. C’est d’ailleurs dans le même style concertant que Dario Castello conduit sa Sonata decima quarta « due soprani e doi troboni ». Dès l’entrée, les violons grimpent à l’octave par sauts de tierces avant d’entonner le thème de la pièce. S’ouvre ensuite une discussion dans laquelle les cordes et les vents se placent sur un pied d’égalité. Cet agencement subtil des timbres crée un effet de contraste astucieux, marqueur par excellence de l’école de Venise. Le contraste des couleurs est renforcé par des ruptures de rythmes non préparées destinées à maintenir l’auditeur en éveil. Cet art subtil des enchaînements rythmiques audacieux trouve même à s’exprimer davantage dans la Sonata decima terza « due soprani e doi tromboni » du même Castello. Les sections qui composent la sonate se multiplient, chacune d’elle étant commandée par un tempo spécifique. A la vivacité du premier mouvement répond la lente majesté du second. Et c’est selon la même alternance que les cinq sections suivantes s’articulent. Pour produire le même effet, l’Intrada a 6 « doi cornetti &quatro tromboni » de Giovanni Battista Buonamente ( ?-1642) avait fait appel à un autre procédé d’écriture : le phrasé en notes détachées, le staccato, pour lequel un avenir prometteur se dessine. Enfin, dans sa Sonata a tre sopra Il Ballo del grand ducca, ce même compositeur optera pour la formule des « Thèmes et variations ». En l’occurrence, il se saisit d’un air, également connu sous le nom d’Aria di Fiorenza. Celui-ci s’est répandu dans toute l’Europe depuis qu’Emilio de ’Cavalieri l’avait composé pour l’un des intermèdes de La Pellegrina représentée à Florence, lors du mariage de Ferdinand Ier de Médicis et de Christine de Lorraine, en 1589.
Pour les compositions placées sous le patronage de Ferdinand III de Habsbourg (1608-1657), Jean Tubéry organise le défilé final des styles et des timbres, chacun tenant à se faire remarquer par un exercice de virtuosité. Le cortège s’ouvre avec la Sonata decima « due violini, violetta da braccio e tiorba » de Marco Antonio Ferro ( ?-1662). Elle est menée par les cordes qui parlent dans une langue nouvelle, celle d’un instrument encore fort jeune mais qui déjà s’élance dans des démonstrations de virtuosité surpassant les possibilités de la voix humaine. Ouvert sur un mouvement d’allure austère, l’archiluth égrène ses notes riches en graves qui ponctuent les plaintes des violons. Sans préparation, ces derniers s’élancent et s’essayent aux différents effets technique éprouvés lors des décennies précédentes : tremblements, altérations fulgurantes, amorces de fugues et ruptures soudaines de rythmes. Une véritable synthèse des modes d’écritures élaborées sous la bannière de la seconda prattica ! Après avoir mis en valeur le violon, instrument récent qui se dote rapidement d’une personnalité, d’autres instruments veulent montrer leur savoir-faire. Le cornet à bouquin règne encore en maître alors que le basson (fagotto) peine à s’affirmer. Pourtant, il le fera de manière virtuose dans le Passamezzo a due per soprano e basso de Martino Pesenti (1600 ?-1666) où Jérémie Papasergio excelle. Place aux flûtes à bec qui rappellent la place particulière que tient cet instrument dans les bruits de la ville de Venise, lorsque les piffari accompagnent les dignitaires de la Cité. Dans ce Passamezzo et surtout dans la Sonata a otto « due violoni, violette, tre faluti e tiorba » de Massimiliano Neri (1615 ?-1666) elles sortent de leur fonction pastorale pour participer au concert à l’égal des autres instruments. Pour le finale, l’instrument de musique le plus ancien, la voix, rejoint les parties instrumentales afin de célébrer la gloire de l’Empereur. En treize versets, l’Altri canti d’Amore (Quand d’autres chantent d’Amour) de Monteverdi revisite tous les genres musicaux de l’époque. Une sinfonia méditative veut capter l’attention de l’assemblée. Suivent les quatre premiers versets dont l’écriture musicale se réfère au style du madrigal. Toutes les formes de distribution vocale se succèdent : partie soliste, puis duo et trio avant de s’achever à l’unisson. Les quatre versets suivants s’inspirent de la technique de l’opéra. Elles installent une ambiance guerrière, dans un stile concitato (agité) dont le compositeur est fervent. Une manière de saluer, près de quatre ans plus tard, le héros de la bataille de Nördlingen où il s’est distingué contre les troupes suédoises. Monteverdi puise dans la panoplie du figuralisme pour décrire un Marte… furibondo e fiero (Mars furieux et cruel). Le troisième couplet relève du récitatif. Et lorsque le soliste annonce que l’orgoglioso choro (le chœur plein de fierté) entend chanter ses louanges, tous les solistes se rejoignent pour former un petit chœur qui del tuo sommo valor canta e ragiona (chante et raconte ta suprême valeur). Cette courte pièce d’une dizaine de minutes a toutes les vertus d’un oratorio profane.
Lorsque ces notes s’éteignent, notre fascinante navigation vers les sources de la musique baroque s’achève. Elle nous aura permis de ramasser un peu de cet humus sur lequel a prospéré le jardin des sons durant la période baroque. A ce titre, ce coffret constitue une encyclopédie sonore indispensable à laquelle l’amateur de belle musique ne cessera de se référer s’il veut connaître les origines d’un genre et comprendre ses développements ultérieurs. Il le fera d’autant plus volontiers que les partitions qui la composent sont animées avec science et adresse par des experts talentueux, Jean Tubéry et ses complices de toujours. En conjuguant leurs immenses talents, ils ont développé une véritable pédagogie du plaisir.
Pour chaque CD, la distribution, l’analyse musicologique ainsi que les textes des parties vocales (textes originaux et leur traduction en français et en anglais) sont consultables sur le site www.outhere-music.com à la page de présentation du présent coffret.
Publié le 28 juil. 2017 par Michel Boesch
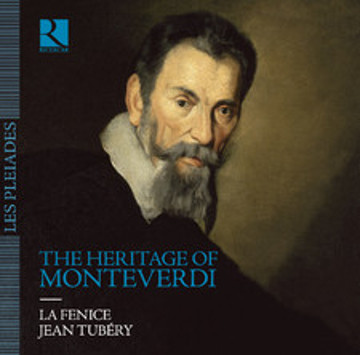 ©akg-image / Erich Lessing. Bernardo Strozzi, Portrait of Claudio Monteverdi, Innsbruck, Tirol Landesmuseum
©akg-image / Erich Lessing. Bernardo Strozzi, Portrait of Claudio Monteverdi, Innsbruck, Tirol Landesmuseum