In Nomine : Enfers et Paradis dans le paysage musical européen autour de 1600
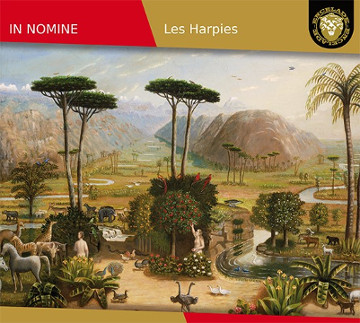 ©Encelade
©Encelade Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret bilingue (français-anglais) et notice, un CD , durée totale : 65 minutes. Encelade - 2017
Compositeurs
- Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 ? - 1594)
- Anonymes
Chanteurs/Interprètes
- Ensemble Les Harpies :
- Odile Edouard (violons)
- Mickaël Cozien (cornemuses et gaïta)
- Freddy Eichelberger (orgue, cistre et coordination artistique)
- Pierre Gallon (régale, spinettino et colachon)
- Guest Harpie : Matthieu Boutineau (régale-spinettino, souffleur)
- Chœur des Huguenots : Claire Berget, Odile Edouard, Emmanuelle Huteau, Stéphane Breyer, Mickaël Cozien, Olivier Depois, Pierre Gallon
Pistes
- 1.Chorea (régale et orgue)
- 2.Polonica (violon, cistre et colachon)
- 3.Vestiva i colli e le campagne intorno - Giovanni Pierluigi da Palestrina (orgue)
- 4.Slap and kiss (cornemuse, violon, cistre et colachon)
- 5.Szegény legény éneke (orgue et régale)
- 6.Io son ferito ahi lasso – Giovanni Pierluigi da Palestrina (violon et orgue)
- 7.Scjaraçule maraçule (cornemuse, régale, orgue)
- 8.Les Bouffons (spinettino et orgue)
- 9.In Nomine improvisé (orgue et gaïta)
- 10.Rolling hornpipe (violon, cornemuse, colachon et cistre)
- 11.Ricercar noni toni sopra le fuge Io son ferito hai lasso è Vestiva i colli – Christian Erbach (orgue)
- 12.O Mely Csudalatos (cornemuse, violon, cistre et colachon)
- 13.Psaume LXV, verset 1 à deux voix (orgue)
- 14.Psaume LXV, verset 2 orné (violon et orgue)
- 15.Psaume LXV, verset 3 au ténor (orgue et régale)
- 16.Psaume LXV, verset 4 chanté –Guillaume Franc sur des paroles de Théodore de Bèze (orgue et Le Chœur des Huguenots)
- 17.First Witches dance (régale-spinettino, cornemuse, cistre, colachon et violon)
- 18.In Nomine – John Bull (orgue)
- 19.Suite de bransles- Pierre Attaingnant et Claude Gervaise (cornemuse, violon, orgue et régale)
Subtiles alchimies au monde des HzCe disque est une comme énigme. Aux délices de l’écoute, il ajoute l’excitation de sa résolution. Décidés à allier plaisir et découverte, deux voies s’offraient à nous. Nous pouvions adopter la façon ludique du coffret Barocco enregistré par Johannes Pramsohler avec son Ensemble Diderot (voir la chronique publiée par Jean-Stéphane Sourd-Durand : Barocco). Dans l’état d’innocence de l’enfant-musicien, nous découvrions alors des instruments singuliers, des sonorités inhabituelles, des constructions mélodiques pittoresques. Nous pouvions également revêtir l’habit sérieux de l’ethnomusicologue soucieux de replacer les assemblages harmoniques dans leur contexte culturel. Notre méconnaissance d’instruments rarement entendus et notre curiosité à l’égard de la dimension sociale des musiques nous a conduits à ne pas choisir. Nous nous laisserons donc transporter avec l’âme d’un enfant, le goût pour les sons expressifs et, comme nous y invite le sous-titre donné au disque, l’envie d’en saisir le sens.
Le titre, déjà, nous met en appétit. In Nomine : de quoi s’agit-il ? Le malicieux livret de Freddy Eichelberger reste muet sur ce point. Manifestement, la formule ne renvoie pas à l’invocation liturgique accompagnant le signe de la croix (In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti) car aucune pièce interprétée n’y fait référence. C’est pourtant bien dans une veine religieuse que ce genre musical anglais prend racine. En effet, la matrice de l’In Nomine est extraite de la Missa Gloria tibi Trinitas (vers 1528) du compositeur anglais John Taverner (vers 1490-1545). Elle consiste en un cantus firmus en plain-chant utilisé ensuite par de nombreux compositeurs, jusqu’à Henry Purcell (1659-1695). Deux pièces enregistrées sur ce disque s’en réclament : une partition pour orgue attribuée à John Bull (vers 1562-1628) et un duo irrésistible associant l’orgue et la gaïta. Comme le font entendre ces deux pièces, le genre se livre à l’improvisation : parfaitement identifiable dans le duo, le cantus firmus originel devient méconnaissable dans la version de Bull. Manifestement, entre Taverner et Bull, le genre a glissé vers la fantasia. Et c’est justement dans cette mue que nous distinguons les raisons du choix du titre du coffret. En effet, voici comment Eugène de Montalembert et Claude Abromont définissent ce genre musical nouveau: « Née au XVIème siècle, la fantaisie est un genre instrumental qui, comme le suggère son nom, présente la caractéristique d’être de forme libre et imprévisible, de pouvoir changer abruptement de propos, de caractère ou de style, passer par exemple d’un contrepoint vocal à des formules purement instrumentales, voire quasi improvisées » (Guide des genres de la musique occidentale - Fayard - 2010). C’est exactement le programme proposé par Les Harpies !
Dans le sous-titre, Freddy Eichelberger évoque les Enfers et le Paradis pour figurer le centre de gravité des dix-neuf pièces gravées. Pourtant, ces repères nous paraissent quelque peu éloignés des idées et des émotions que nous captons à leur écoute. Il nous semble plutôt que la plupart des séquences pourraient être placées sous le signe de la transgression. Car la danse populaire est considérée comme dangereuse pour le salut des âmes : « Les bals, les danses et telles assemblées ténébreuses attirent ordinairement les vices et péchés » tonne François de Sales (1567-1622) dans son Introduction à la vie dévote (1609). Car, quitter le giron de l’Eglise catholique, apostolique et romaine soulève des passions et provoque des excès dont ont été victimes « plusieurs personnes de la nouvelle opinion, avec telle fureur que l’autorité de nos officiers et ministres de justice aurait eu peu de force à les contenir et réprimer » (Lettres patentes du Roi (Charles IX) pour le repos de tous les sujets de son royaume et conservation des corps et biens de la nouvelle opinion - 28 octobre 1572). Car les pratiques de la sorcellerie terrorisent « par des incantations, des charmes, des conjurations, d’autres infamies superstitieuses et des excès magiques, (qui) font dépérir, s’étouffer, s’éteindre la progéniture des femmes, les petits des animaux, les moissons de la terre, les raisins des vignes et les fruits des arbres » (Bulle apostolique contre l’hérésie des sorcières du pape Innocent VIII - 5 décembre 1484). Or, c’est bien poussés par le souffle des airs de danse, des cantiques huguenots et des échos de sabbats que Les Harpies nous font zigzaguer à travers l’Europe entière, dans une joyeuse farandole enflammée par des sonorités dépaysantes.
Dès les premières notes, nous voilà happés par le mouvement hoquetant d’une chorea (chorée). Ce terme curieux désigne à la fois une danse pratiquée dans la Grèce antique et une maladie nerveuse dont les manifestations rappellent des mouvements de danse. Un certain Isidore Bricheteau (1789-1861), médecin de son état, raconte comment les premiers chrétiens la dansaient autour d’un feu : « on sautait en chantant et en commettant toutes sortes d’extravagances » (Dictionnaire de la conversation et de la lecture - Tome XIX - 1835). Interdite par saint Augustin (354-430), le terme réapparaît au Moyen Age pour désigner, cette fois, la danse frénétique de personnes atteintes de maladies convulsives et donc possédées par le diable, comme on le pensait à l’époque. Notre médecin poursuit en racontant comment, en 1418, « la chorée fut observée à Strasbourg où elle prit le nom de danse de Saint-Guy parce que les reliques de ce saint, conservées non loin de cette ville, étaient célébrées pour la guérison de ce mal ». C’est donc dans une danse sentant le souffre que nous entraîne Pierre Gallon au son de la régale. Ce petit orgue transportable utilisé aux XIVème et XVème siècles, a, par la suite, donné son nom à un jeu d’anche que les facteurs d’orgue de l’Allemagne du Nord ont ajouté à la gamme des sonorités proposées par leurs instruments. Pour les orgues classiques français, la sensation auditive qu’elle procure correspond approximativement à deux registres : la Musette et la Voix humaine. Au demeurant, le timbre tranché de la régale convient parfaitement au goût des auditeurs de la Renaissance pour les sonorités à dominante nasale. Accompagné par Freddy Eichelberger à l’orgue, la régale lance une ronde somme toute assez sage mais dont la répétition obsédante du thème sur des registres différents finit par nous posséder. Par ailleurs, les ruptures de rythme qui ponctuent la ligne mélodique lui donnent une tonalité pétulante figurant les mouvements brusques des malades atteints de chorée. Une entrée en matière fort plaisante, en hommage, explique Freddy Eichelberger, au chef René Clemencic, grand découvreur de musiques médiévales.
Dans le même mouvement d’hommage, une Polonica prend le relais de la Chorea. Mais ces deux pièces ne se ressemblent ni par l’allure, ni par le caractère. Autant la première renvoie, dans notre imaginaire, aux danses nobles de la Renaissance, autant la seconde respire l’ambiance des bals populaires. Le qualificatif Polonica désignait, du temps de Sigismond III Wasa (1566-1632), les pièces d’allure ou de composition polonaises, qu’il s’agisse de danses ou de chansons. C’est pourtant vers la Hongrie que Freddy Eichelberger oriente notre regard. Le violon d’Odile Edouard prend les commandes de la pièce. Elle est accompagnée par deux étranges compères : un cistre et un colachon. L’un et l’autre appartiennent à la grande famille des cordes pincées. Le premier, proche du luth même s’il est de facture plus robuste, peut comporter de quatre à six chœurs (à raison de deux à trois cordes par chœur) ; le second compense le nombre limité de cordes (trois, en général) par leur longueur. L’un convient au musicien amateur quand l’autre s’illustre dans les musiques populaires d’Italie méridionale. Au départ de la pièce, le violon hésite, s’essaye à quelques accords et finit par façonner une ligne mélodique qui va s’animer à grand renfort de cistre et de colachon. De répétions en imitations, le tempo s’échauffe pour finir en tourbillon. En revanche, dans la Suite de bransles qui met le point final au CD, aucune hésitation. D’emblée, les instruments nous entraînent dans ces danses populaires que décrit Michel Toulouze dans son Art et instruction de bien dancer (1496) : « le branle se doibt commencer du pié senestre et se doibt finet du pié dextre et s’appelle branle pour ce qu’on le fait en branlant d’un pié sur l’autre » (cité par Eugène de Montalembert et Claude Abromont in Guide des genres de la musique occidentale). Ces deux compositions, l’une de Pierre Attaingnant (vers 1494-vers 1551) et l’autre de Claude Gervaise (vers 1525-vers 1583) font exploser les sonorités et les rythmes. Les partitions libèrent une joie de vivre et une énergie communicative. La cornemuse, la régale et le violon que l’on perçoit plus faiblement, énoncent une mélodie assez répétitive. L’orgue bat le rythme et rappelle, par sa participation, qu’il n’était pas toujours un instrument réservé aux églises. Une belle manière de souligner la beauté naïve des danses populaires que les frères Breughel ont documenté avec beaucoup de malice.
Il est temps de reprendre notre souffle avec une transcription pour orgue du madrigal Vestiva i colli e le campagne intorno (Il habille les collines et la campagne alentours) publié en 1566 par Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 ?-1594) dans le recueil Il desiderio : secondo libro de madrigali a 5 voci de diversi. Ce madrigal célèbre à la fois la renaissance de la nature au printemps et la fidélité que Licori promet à son amant. Le tempo est apaisé, la mélodie douce et sensuelle. La sonorité flûtée de l’orgue est traversée, par intermittence, par le gazouillis facétieux d’un rossignol intégré dans les jeux de l’orge de Saint-Savin-en-Lavedan lors de travaux de restauration (1618). Cette séquence a le charme d’une promenade dans la campagne un jour de printemps ensoleillé. Toute autre est l’ambiance de la seconde pièce de Palestrina interprétée quelques séquences plus tard. Son madrigal Io son ferito ahi lasso (Je suis blessé, hélas) est paru en 1561 dans Il terzo libro delle muse a cinque voci di diversi escellentissimi musici. Comme la précédente, cette pièce a connu un énorme succès populaire. Dans un ouvrage contenant diverses transcriptions pour luth de pièces célèbres, Vincenzo Galilei (1520-1591), le père du célèbre physicien et astronome, écrit à son sujet : « Vous aurez, dans la cinquième tablature, cette admirable chanson de ce grand imitateur de la nature, Jean de Palestrina » (cité dans la Revue de Paris - Tome X- 1842). Le musicien y raconte la situation désespérée d’un amant atteint par « une blessure qui ne répand pas le sang » mais qui le fait frissonner et gémir. L’interprétation de la partition est extraordinairement expressive. Aux profonds gémissements figurés par l’orgue se superposent des sanglots agités par le violon. La voix de l’un est feutrée et manifeste une émotion contenue ; les traits d’archets de l’autre s’étirent plaintivement. Leurs pleurs conjugués sont joliment pétris par l’écho de l’abbatiale. L’émotion nous submerge et nous traverse. Elle nous saisira à nouveau lorsque Freddy Eichelberger interprétera le Ricercar noni toni sopra le fuge Io son ferito hai lasso è Festiva i colli (1600). Comme l’indique le titre, Christian Erbach (1568 ?-1635), organiste dans la ville impériale d’Augsbourg, a composé cette pièce en s’inspirant des deux madrigaux entendus précédemment. L’initiative consistant à regrouper une œuvre et ses sources doit être saluée car nous avons rarement l’occasion de trouver, sur une même galette, des pièces interprétées selon leur ordre généalogique. Ce ricercare (nom dérivé du mot italien « rechercher ») se revendique d’inspiration italienne, autant pour le texte que pour l’écriture musicale. Son compositeur germanique excelle dans l’art de l’ornementation, empruntant à Palestrina l’écriture en imitation et sans doute à Andrea Gabrieli (1533-1585), les prémisses de l’art de la fugue. Il produit ici un magnifique duo contrapunctique, mariant un supérius développant une ligne mélodique empreinte d’une certaine mélancolie à une basse qui ne se satisfait plus de jouer le rôle ingrat de l’ostinato. Avec Erbach, la révolution musicale est en marche : le dessus et « la basse agissante » (Annie Coeurdevey in Guide de la musique de la Renaissance – Fayard - 2011) s’ajustent dans un rapport d’égalité. Est-ce sur ce point que se niche la transgression qui, selon nous, constituerait le fil conducteur du CD ? Peut-être, mais pas seulement. En effet, souvenons-nous qu’aux yeux du pape Paul IV, Palestrina fut doublement transgressif : il était marié et composait de la musique profane, deux motifs qui l’ont conduit à être rayé des rôles des musiciens attachés à la chapelle Sixtine !
Après le repos au soleil de printemps que nous a procuré le premier madrigal, l’agitation reprend. C’est par une gifle et un baiser (Slap and kiss) que quatre instruments nous secouent. Ils nous arrachent et nous poussent dans un Lancashire hornpipe endiablé. Cette danse populaire anglaise au tempo accéléré est dirigée par le violon d’Odile Edouard, rythmée par le cistre et le colachon de Freddy Eichelberger et de Pierre Gallon, solidement enveloppée par la cornemuse de Mickaël Cozien. Elle a l’allure d’une gigue mais se danse de façon individuelle. En tout état de cause, elle impose aux danseurs des jeux de pieds complexes. Complexes au point, dit-on, qu’un certain Richard Dugdale, domestique dans le comté de Lancashire vers 1690, aurait même vendu son âme au diable pour une leçon de danse. L’histoire de sa possession (ou de son imposture) a inspiré de nombreuses brochures aujourd’hui oubliées. Quelques séquences plus loin, les mêmes musiciens lancent un nouveau hornpipe, tout aussi déchaîné que le premier. On imagine volontiers que ces airs truculents accompagnés par ces instruments à tuyau (pipe) dotés d’un pavillon en corne d’animal (horn), ou d’une cornemuse rudimentaire, aient pu irriter les bonnes âmes lorsque, raconte Feddy Eichelberger dans le livret accompagnant le CD, des bandes de vadrouilleurs s’ingénièrent à s’échauffer sur le parvis des églises. Et ce n’est pas la First Witches dance qui apaisera l’atmosphère. La sonorité nasillarde de la régale et le timbre guttural de la cornemuse apportent un solide appui aux instruments à corde pincée qui, avec le violon, s’élancent dans cette danse des sorcières. Elle rendrait presque sympathique cette corporation tant abhorrée par Innocent VIII et sa troupe d’Inquisiteurs. Tout comme l’entraînante Scjaraçule maraçule que les femmes et les hommes du village frioulan de Palazzolo dansaient, dit-on, pour appeler la pluie. Son tempo en constante accélération peut également évoquer cette ronde traditionnelle dansée en Sardaigne qui, à force de prendre de la vitesse, provoque une exaltation collective enflée par les sonorités entêtantes de la régale et de la cornemuse.
Mais il est des danses bien plus tranquilles. Ainsi, la pièce Les Bouffons renvoie à un genre proche de la pavane, mais qui se danse sur un rythme plus rapide : la Passamezzo moderna. Née sous la Renaissance italienne, elle s’est largement diffusée, grâce notamment à des recueils tels que les 24 Passamezzi de Giacomo Gorzanis (1520 ?-1575 ?). Ce musicien propose douze pièces de chaque modèle pour le luth : l’antico dans une tonalité généralement mineure et la moderno, sa variante en mode majeur. Nos Bouffons brillent autant par leur civilité que par le scintillement du spinettino de Pierre Gallon. Cet instrument à clavier évoque l’épinette ou le virginal, tous deux précurseurs du clavecin. L’orgue assure l’ostinato alors que le spinetto transforme la ligne mélodique en un aimable jeu de variations sur un même thème. D’allure très pudique au départ, la mélodie s’enhardit et son tempo s’emballe pour finir dans un gentil fou rire. Aucune transgression, non plus, dans la chanson Szegény legény éneke que Freddy Eichelberger a découvert dans un Codex Vietorisz dont le mystère reste entier pour les modestes amateurs de belle musique que nous sommes. D’une voix égale, l’orgue et la régale interprètent chacune des strophes de cette chanson, apportant, ici ou là, des variantes dans l’accompagnement par la partie de basse et quelques nuances dans les tempi. La ligne mélodique témoigne de l’influence culturelle de l’Europe occidentale sur la partie de l’Europe centrale en train de se libérer du joug ottoman. Mais la capillarité avec la culture orientale se ressent dans l’autre chanson extraite du même codex. En effet, O Mesly Csudalatos laisse la cornemuse et le violon chanter de longs airs langoureux. On devine, ici ou là, quelques sonorités tsiganes qui mêlent fougue et mélancolie. Ces pièces apaisent mais sans ouvrir pour autant les portes du Paradis. Et si, comme l’affirment certains, toute danse est transgression, celle-ci s’affiche ici dans une forme vénielle.
En revanche, les quatre versets du Psaume LXV (65) rappellent des épisodes de transgressions, parfois d’une violence toute diabolique. A titre d’exemple, le théologien Emmanuel-Orentin Douen (1830-1896) raconte comment, en 1550 « on vit le Parlement de Toulouse quitter la procession à laquelle il assistait, entrer dans la sacristie de l’église Saint-Etienne, et, séance tenante, condamner au feu le nommé Blondel, qui venait d’entamer un cantique profane de Clément Marot » (Clément Marot et le Psautier huguenot - 1878). C’est sans doute parce que les Psaumes mis en rime françoise par Clément Marot et Théodore de Bèze (1563) étaient autant des signes de reconnaissance que des recueils de prière collective qu’ils attirèrent l’attention des illuminés des deux bords. Pourtant, leur intention est généralement pacifique. Il en est ainsi de l’exergue au Psaume LXV versifié par Théodore de Bèze (1519-1605) : « Ce Psaume contient une description des biens et grâces que Dieu continue sans fin et sans cesse de faire à son Eglise ». Le premier quatrain (Dieu, la gloire qui t’est deu) prend pour support la ligne mélodique du cantique telle qu’elle est publiée dans l’ouvrage cité. Freddy Eichelberger y introduit quelques modestes ornements et, en guise de variante, transpose pour la main gauche le chant du second verset. L’ensemble est assez dépouillé et son allure est paisible. Le second quatrain (Toutes manières de malices) laisse au violon le soin d’enrichir la ligne mélodique par des digressions mélodiques alors que l’orgue assure le continuo. La pièce, joliment ornée, conserve cependant le découpage par versets marqué par de courts silences. L’atmosphère suscite la méditation. Dans la troisième strophe ((Heureux celuy que veux élire), la ligne mélodique est prise en charge par la régale et c’est l’orgue, cette fois, qui s’égaye en de pieuses méditations. Elles correspondent parfaitement au caractère apaisé du texte exprimant le bonheur spirituel des croyants réunis au sein de l’Eglise. La quatrième et dernière strophe interprétée sur le CD (Des biens du palais de ta gloire) est chantée par Le Chœur des Huguenots constitué, explique Freddy Eichelberger, « par tous les gens disponibles, membres de l’équipe et gens de passage ». L’accompagnement par l’orgue est extrait du recueil publié par Guillaume Franc (1519-1605) à Genève, en 1576 : Les Pseaumes mis en rime françoise par Clément Marot et Théodore de Bèze, avec le chant de l’église de Lausanne. Après les versets interprétés sur divers instruments, cette seule incursion de la voix humaine est saisissante. Elle constitue un témoignage de ce pouvait être le chant des psaumes dans une assemblée ordinaire de fidèles. La dynamique emportant la ligne mélodique explique à elle seule pourquoi, à l’issue des offices, les adeptes de la « nouvelle opinion » continuaient souvent à chanter les cantiques sur le chemin du retour vers leurs foyers.
Notre chronique s’est ouverte sur l’In Nomine. Nous la conclurons avec les deux pièces se référant à ce genre musical. L’In Nomine improvisé rend un hommage direct à l’inventeur du genre. Dans un duo absolument ravissant, la gaïta de Mickaël Cozien chante exactement le cantus firmus de l’antienne Gloria Tibi Trinitas tandis que l’orgue improvise un accompagnement fervent et rythmé imaginé par un Freddy Eichelberger décidemment inspiré. La sonorité de la gaïta (ici une flûte basque) illumine cette séquence, transformant le son en émotion. Ce passage est un joyau dans un coffret à bijoux déjà richement garni. Et c’est fort judicieusement qu’il constitue, en quelque sorte, la clé de voûte de ce programme. En comparaison, l’In Nomine choisi parmi les onze que John Bull (vers 1562-1628) a composé, paraît plus hésitant. La ligne mélodique est plus distendue et le thème difficilement reconnaissable. L’ensemble présente une allure chaotique : des ruptures ouvrent la voie à de cours développements ; des sauts à l’octave succèdent à des descentes chromatiques ; le tout manquant de cette unité qui caractérise le « récit » proposé par Christian Erbach.
Séduction ultime : ce disque sonne vrai. Il nous fait entendre les premiers vagissements de la musique baroque. Projetés sur un véritable banc d’essai, les sonorités, les rythmes et les mélodies se modèlent et se remodèlent, préparant ainsi la matière première à partir de laquelle seront pétries les fugues, motets, cantates et autres sinfonia qui fleuriront aux XVIIème et XVIIIème siècles. La prise de son témoigne également de la sincérité qui se dégage de cet enregistrement. Elle ne nous épargne rien des bruits de la soufflerie de l’orgue. D’ailleurs, elle fait bien de nous rappeler que, bien avant l’organiste, c’est le souffleur qui est le maître du jeu. Une belle leçon de réalisme dans ce siècle du tout électrique ! Enfin, le livret de Freddy Eichelberger rappelle aux amateurs que nous sommes, que chaque instrument s’exprime sur une fréquence qui lui est propre (exprimée en herz ou Hz). L’art du chef-coordinateur ne se résume donc pas à l’interprétation collective d’une partition, même laborieusement reconstituée. Elle suppose également que la conjonction des fréquences de chaque instrument produise finalement une sonorité agréable à l’oreille de l’auditeur. Exercice d’autant plus compliqué que le répertoire se singularise par sa diversité. L’orgue Renaissance de Saint-Savin-en-Lavedan agissant en qualité de diapason, il convenait d’organiser la ronde des Hz de telle sorte qu’elle produise l’accord parfait. Projet ambitieux mais pari tenu. Dire que nous sommes tombés sous le charme de ce disque ne suffirait pas pour exprimer à quel point nous avons ressenti du plaisir à l’écouter et le réécouter… et à partager notre enthousiasme d’auditeur comblé.
Publié le 03 avr. 2017 par Michel Boesch
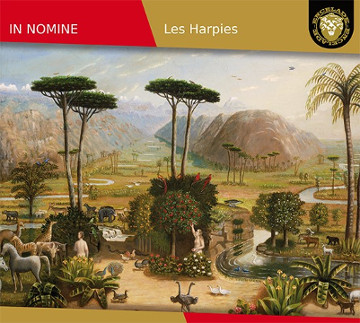 ©Encelade
©Encelade