Isis - Lully
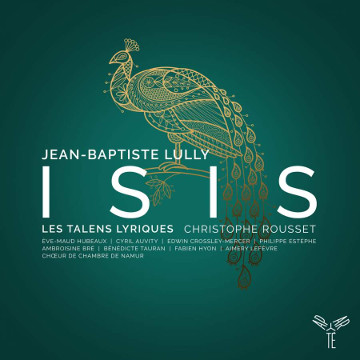 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notice bilingue (français-anglais) de Pascal Denécheau, 2 CD, durée totale : 156 minutes. Aparté - 2019
Compositeurs
- Isis
- Tragédie en musique en un prologue et cinq actes de Jean-Baptiste Lully (1632-1687), sur un livret de Philippe Quinault (1635-1688), d’après Les Métamorphoses d’Ovide
- Créé le 5 janvier 1677 au Château de Saint-Germain-en-Laye
- Édition musicale réalisée par Nicolas Sceaux pour les Talens Lyriques, établie à partir de l’édition de Ballard de 1719 et du matériel de 1677
Chanteurs/Interprètes
- Bénédicte Tauran (La Renommée, Melpomène)
- Eve-Maud Hubeaux (Thalie)
- Ambroisine Bré (Calliope)
- Cyril Auvity (Apollon, 1er triton)
- Fabien Hyon (2e triton)
- Philippe Estèphe (Neptune)
- Ève-Maud Hubeaux (Isis, Io)
- Ambroisine Bré (Iris, Syrinx, Hébé, 1e Parque)
- Bénédicte Tauran (Mycène, Junon)
- Cyril Auvity (Pirante, La Furie - Erinnis, La Famine, l’Inondation, 2e Parque, 1er berger)
- Fabien Hyon (Mercure, 2e Berger, 1er conducteur de Chalybes, Les Maladies languissantes)
- Edwin Crossley-Mercer (Jupiter, Pan)
- Philippe Estèphe (Argus, 3e Parque, la Guerre, l’Incendie, les Maladies violentes)
- Aimery Lefèvre (Hiérax, 2e conducteur de Chalybes)
- Julie Calbète et Julie Vercauteren (Deux nymphes)
- Chœur de chambre de Namur :
- Dessus 1 : Gwendoline Blondeel, Julie Calbète, Zoé Pireaux, Amélie Renglet
- Dessus 2 : Barbara Menier, Aurélie Moreels, Julie Vercauteren
- Hautes-contre : Patrick Boileau, Stephen Collardelle, Marcio Soares Holanda, Jonathan Spicher
- Tailles : Peter de Laurentiis, Eric François, Thibault Lenaerts, Thierry Lequenne
- Basses-tailles : Kamil Ben Hsain Lachiri, Etienne Debaisieux, Philippe Favette, Sergio Ladu, Jean-Marie Marchal
- Chefs de chœur : Leonardo Garcia-Alarcón et Thibaut Lenaerts
- Les Talens lyriques :
- Dessus de violon 1 : Gilone Gaubert, Stephan Dudermel, Bérengère Maillard
- Dessus de violon 2 : Gabriel Grosbard, Myriam Mahnane, Josef Zák
- Hautes-contre de violon : Marie Legendre, Alain Pégeot
- Tailles de violon : Sarah Brayer-Leschiera, Murielle Pfister
- Quintes de violon : Martha Moore, Sophie Cerf
- Basses de violon : Emmanuel Jacques, Jérôme Huille, Mathurin Matharel, Pauline Lacambra, Hartmut Becker
- Flûtes traversières et à bec : François Lazarevitch, François Nicolet
- Musette : François Lazarevitch
- Hautbois : Vincent Blanchard, Jon Olaberria
- Basson : Tomasz Wesolowski
- Trompettes : Jean-François Madeuf, Jean-Daniel Souchon
- Timbales et percussions : Marie-Ange Petit
- Continuo :
- Basse de violon : Emmanuel Jacques
- Viole de gambe : Kaori Uemura
- Luth et guitare : Laura Mónica Pustilnik
- Clavecin et orgue : Korneel Bernolet
- Clavecin et direction : Christophe Rousset
Pistes
- 1.PROLOGUE - Ouverture
- 2.Scène 1. Chœur de la suite de la Renommée, des Rumeurs et des Bruits : « Publions en tous lieux »
- 3.La Renommée, le chœur : « C’est lui dont les dieux ont fait choix »
- 4.Scène 2. Premier Air des tritons
- 5.Deux tritons chantants : « C’est le dieu des Eaux qui va paraître »
- 6.Deuxième Air des tritons
- 7.Neptune, la Renommée : « Mon empire a servi de théâtre à la guerre »
- 8.Chœur de la suite de la Renommée : « Célébrons son grand nom sur la terre et sur l’onde »
- 9.Scène 3. Prélude des muses
- 10.Calliope, Thalie, Apollon, Melpomène : « Cessez pour quelque temps, bruit terrible des armes »
- 11.Premier Air pour les muses
- 12.Deuxième Air pour les muses
- 13.Apollon : « Ne parlez pas toujours de la guerre cruelle »
- 14.Apollon, la Renommée, Neptune, les muses et le chœur : « Ne parlons pas toujours de la guerre cruelle »
- 15.Air pour les trompettes
- 16.La Renommée, Neptune et Apollon : « Hâtez-vous, Plaisirs, hâtez-vous »
- 17.Ouverture
- 18.ACTE I - Scène 1. Ritournelle
- 19.Hiérax : « Cessons d’aimer une infidèle »
- 20.Scène 2. Pirante, Hiérax : « C’est trop entretenir ces tristes rêveries »
- 21.Scène 3. Io, Hiérax : « M’aimez-vous ? Puis-je m’en flatter ? »
- 22.Scène 4. Io, Mycène : « Ce prince trop longtemps dans ses chagrins s’obstine »
- 23.Scène 5. Mercure : « Le dieu puissant qui lance le tonnerre »
- 24.Chœur des Échos : « Échos, retentissez dans ces lieux pleins d’appas »
- 25.Mercure, Io : « C’est ainsi que Mercure »
- 26.Scène 6. Chœur des divinités : « Que la Terre partage »
- 27.Premier Air pour l’entrée des divinités de la Terre
- 28.Deuxième Air
- 29.Jupiter, chœur des divinités : « Les armes que je tiens protègent l’innocence »
- 30.Entracte
- 31.ACTE II - Scène 1. Ritournelle
- 32.Io : « Où suis-je, d’où̀ vient ce nuage ? »
- 33.Scène 2. Jupiter, Io : « Vous voyez Jupiter, que rien ne vous étonne »
- 34.Scène 3. Mercure, Jupiter, Io : « Iris est ici-bas et Junon elle-même »
- 35.Scène 4. Mercure, Iris : « Arrêtez, belle Iris, différez un moment »
- 36.Scène 5. Prélude
- 37.Iris, Junon : « J’ai cherché vainement la fille d’Inachus »
- 38.Scène 6. Jupiter, Junon, Mercure, Iris : « Dans les jardins d’Hébé vous deviez en ce jour »
- 39.Scène 7. Entrée pour la Jeunesse
- 40.Hébé, chœur : « Les plaisirs les plus doux »
- 41.Premier Air
- 42.Deux nymphes : « Aimez, profitez du temps »
- 43.Deuxième Air
- 44.Chœur : « Que ces lieux ont d’attraits »
- 45.Scène 8. Mercure, Iris, Hébé : « Servez, nymphe, servez, avec un soin fidèle »
- 46.Hébé, chœur des nymphes : « Que c’est un plaisir charmant »
- 47.ACTE III - Scène 1. Ritournelle
- 48.Argus, Io : « Dans ce solitaire séjour »
- 49.Scène 2. Hiérax, Argus : « La perfide craint ma présence »
- 50.Scène 3. Argus, Hiérax, Syrinx, chœur des nymphes : « Liberté, liberté ! »
- 51.Scène 4. Mercure, chœur des nymphes de bergers et de sylvains : « De la nymphe Syrinx, Pan chérit la mémoire »
- 52.Scène 5. Syrinx, chœur des nymphes : « Liberté, liberté »
- 53.Scène 6. Air des sylvains et des satyres
- 54.Marche des bergers et satyres
- 55.Deuxième Air
- 56.Deux bergers : « Quel bien devez-vous attendre »
- 57.Troisième Air
- 58.Pan, Syrinx : « Je vous aime, nymphe charmante »
- 59.Chœur de sylvains, satyres et de bergers, chœur de nymphes, Syrinx, Pan : « Aimons sans cesse »
- 60.Syrinx, chœurs, Pan : « Faut-il qu’en vains discours un si beau jour se passe ? »
- 61.Pan, Syrinx, chœurs de bergers, sylvains et satyres : « Je ne puis vous quitter, mon cœur s’attache à vous »
- 62.Pan, deux bergers, Mercure : « Hélas ! quel bruit ! qu’entends-je ? »
- 63.Scène 7. Mercure, Hiérax, Argus : « Reconnaissez Mercure et fuyez avec nous »
- 64.Scène 8. Junon : « Revois le jour, Argus, que ta figure change ! »
- 65.Entracte
- 66.ACTE IV - Scène 1. Entrée des peuples des climats glacés
- 67.Chœur des peuples des climats glacés : « L’hiver qui nous tourmente »
- 68.Scène 2. Io, la Furie, chœur des peuples des climats glacés : « Laissez-moi, cruelle Furie »
- 69.Scène 3. Les deux conducteurs, chœur des Chalybés : « Tôt, tôt, tôt… »
- 70.Entrée des forgerons
- 71.Scène 4. Io, chœur des Chalybés, la Furie : « Quel déluge de feux qui sortent des forges »
- 72.Scène 5. Chœur de la suite des Parques, la Guerre, la Famine, l’Incendie, l’Inondation, les Maladies violentes, les Maladies languissantes, chœur : « Exécutons l’arrêt du sort »
- 73.Scène 6. Premier Air des Parques
- 74.Deuxième Air des Parques
- 75.Io, chœur de la suite des Parques : « C’est contre moi qu’il faut tourner »
- 76.Scène 7. Ritournelle. Les trois Parques : « Le fil de la vie »
- 77.Io, la Furie, chœur de la suite des Parques : « Tranchez mon triste sort d’un coup qui me délivre »
- 78.Entracte
- 79.ACTE V - Scène 1. Ritournelle
- 80.Io : « Terminez mes tourments, puissant maitre du monde »
- 81.Scène 2. Prélude
- 82.Jupiter, Io : « Il ne m’est pas permis de finir votre peine »
- 83.Scène 3. Jupiter, Junon, Io : « Venez, déesse impitoyable »
- 84.Chœur des divinités, des Égyptiens, Jupiter, Junon : « Venez, divinité nouvelle ! »
- 85.Premier Air pour les Égyptiens
- 86.Deuxième Air pour les Égyptiens
- 87.Chœur des Égyptiens et des divinités : « Isis est immortelle »
Isis, l’anti AtysAlors que nous venons tout juste de célébrer le 387e anniversaire de Lully, quel meilleur cadeau Christophe Rousset pouvait-il offrir au compositeur que cette savoureuse Isis ? Voici un nouvel opus dans le cadre de cette collaboration fructueuse avec Aparté, qui, après Bellérophon, Phaéton, Amadis, Armide, avait proposé une Alceste somptueuse (voir notre compte-rendu). À la tête de ses Talens Lyriques, Christophe Rousset constitue désormais le meilleur défenseur de la cause lullyste, quand certains de ses confrères préfèrent d’autres compositeurs plus tardifs ou des versions remaniées des chefs-d’œuvre du florentin, qui, malgré un indéniable témoignage musicologique, n’offrent souvent qu’une forme hybride et dépourvue de la cohérence profonde des originaux.
Isis n’est pas tout à fait une découverte puisque Hugo Reyne avec sa Simphonie du Marais en avaient restitué une intégrale en 2005 de bonne tenue mais souvent plus réussie dans les divertissements que les scènes, peinant quelque peu à soutenir notre attention. Il faut dire que la dramaturgie d’Isis a de quoi surprendre : de nombreux personnages n’y font qu’une brève apparition et avouons que les infidélités jupitériennes (le maître des dieux poursuit de ses ardeurs la nymphe Io qui encourt ainsi la colère de Junon, l’épouse trahie) n’ont pas l’impact émotionnel du sacrifice matrimonial d’une Alceste ou de l’amour illusoire entretenu par la magie d’une Armide.
Les contemporains de la création en janvier 1677 ont assimilé Junon à Madame de Montespan et Io à la jeune Marie-Élisabeth de Ludres, insolence facétieuse du tandem Lully-Quinault qui valut la disgrâce du poète et une critique froide à l’égard d’une musique jugée trop savante. Mais laissons de côté ces allusions de l’époque pour reconsidérer l’œuvre à sa juste mesure car il faut bien le dire : Isis constitue un chef d’œuvre. Mais ce dernier est une sorte d’anti Atys. Cette précédente tragédie est souvent envisagée comme racinienne par sa concentration, la structure implacable de son livret (sans doute l’un des meilleurs de Quinault). Autant Atys s’avère classique, autant Isis s’avère baroque dans sa forme comme dans son contenu. Il semble que le musicien et son librettiste aient voulu prendre l’exact contre-pied de ce qu’ils avaient produit l’année d’avant. Aux scènes d’amour de l’acte I d’Atys s’opposent ici celles d’un évitement entre le pauvre Hiérax et Io. À l’acte II, qui voyait la désignation d’un sacrificateur, plongeant le héros dans une certaine terreur intérieure, succède ici une fête certes teintée de mélancolie (ré et sol mineur) mais beaucoup plus légère et consacrée à la jeunesse (avec un joyeux si bémol majeur pour le chœur final). Au sommeil de l’acte III répond ici une pastorale héroïque miniature menée avec une urgence incroyable. L’harmonieux divertissement des fleuves fait place ici à une série de tortures toutes plus incroyables les unes que les autres permettant à Lully d’expérimenter des effets recherchés. Enfin le dénouement funeste débouchant sur une thrénodie finale noire à souhait (acte V) s’efface ici au profit d’une célébration joyeuse relative à l’élévation de Io, métamorphosée (non en vache ce que la décence n’eût point permis) mais en déesse, sous le nom d’Isis.
Construite comme une arche faisant correspondre à la descente de Jupiter à l’acte I, l’ascension de Io-Isis à l’acte V et articulée autour d’une très habile mise en abyme à l’acte III (l’épisode de Pan et Syrinx préfigurant le renoncement du dieu suprême à la nymphe qu’il courtise), la partition s’avère formidablement architecturée, notamment dans les perpétuels effets de miroirs entre les plans tonals envisagés (les chœurs du final reprennent l’ut majeur triomphal de ceux du prologue et avec les mêmes emprunts à la sous-dominante : Qu’il dure autant que l’univers et Tout vous révère dans ces lieux) et les formes se répondant avec des effets de démultiplication. On trouve ainsi de nombreux duos à voix égales (tritons, nymphes, bergers, Hierax et Argus). Des textures en trio également se réfléchissent : aux nymphes de l’acte III (Liberté, liberté et N’aimons jamais) s’opposent les Parques dans l’acte IV. Un autre procédé, visant à donner une profonde cohérence, réside dans les reprises tantôt textuelles, tantôt partielles, fournissant l’occasion d’une forme d’élargissement : Heureux l’empire qui suit ses lois pour effectivement dire cent et cent fois les louanges du monarque. Notons aussi comment Lully lie les deux premières scènes de l’acte I avec des motifs comparables utilisés d’abord pour Hiérax (Mais que vous êtes lente : valeurs longues sur une basse ondulante) puis pour Pirante (Ce beau séjour est l’asile du repos, idem) qui lui répond ainsi en écho, ce mimétisme musical témoignant de l’amitié entre ces deux personnages. On pourrait citer à l’envi de nombreux exemples, mais laissons-les découvrir aux auditeurs qui seront conquis également par le charme mélodique abondant en maintes pages de cet ouvrage qui n’a guère usurpé son surnom « d’opéra des musiciens ».
Livrons-nous maintenant à un examen plus attentif des différentes parties constitutives. L’ouverture « grave et magnifique » en sol mineur oppose ses motifs pointés d’une extrême verticalité (serait-ce Jupiter ?) au fugato splendide lui faisant suite marqué par un motif ascensionnel (donnant presque l’illusion d’un mouvement perpétuel : serait-ce déjà Io élevée au rang d’Isis). Rarement l’ouverture lullyste aura à ce point illustré ce qui va suivre. Le prologue est probablement le plus festif et le plus royal jamais écrit par Lully : rehaussé de l’éclat des trompettes à plusieurs reprises, celui-ci prend des allures de Te Deum profane, tant par le registre lexical (la terre et les cieux) que par les couleurs de l’hymne éponyme créé quelques mois plus tard également en 1677 (voir compte-rendu). Quoi de plus galvanisant que les chœurs Publions en tous lieux, Célébrons son grand nom ou encore Hâtez-vous plaisirs ? Dans le duo des tritons, Lully se renouvelle par rapport à celui de la fête marine d’Alceste, préférant ici une écriture plus raffinée faisant la part belle aux imitations. L’épisode des Muses s’ouvre par une très belle page orchestrale où dialoguent textures à cinq et en trio (flûtes) cédant la place à Calliope, Thalie, Melpomène et Apollon. L’annonce de la tragédie évite toute explicitation (contrairement à Atys), se bornant au générique de « fête nouvelle ».
De l’acte I, retenons en priorité les airs de Hiérax. Aimery Lefèvre y est splendide de vérité, tant par le timbre que l’engagement dans un rôle pourtant ingrat s’il en est. L’inconstante n’a plus l’empressement extrême adopte la formule lullyste bien connue du chant doublé par la basse continue et accompagné de deux parties obligées de dessus, procédé repris pour Je cherche en vain, marqué par ses intervalles disjoints trahissant l’épuisement du personnage, la deuxième section descendant inexorablement vers le grave. Auparavant notons l’air Vous juriez sur basse continue seule marquée par une fort belle fausse relation (opposition entre route nouvelle avec do dièse à la basse et le do naturel au chant qui lui succède sur plutôt qu’on ne verrait. Relevons également le splendide duo entre Io et Hiérax où ce dernier exprime son désespoir par une ligne chromatique ascendante sur Non, il ne tient qu’à vous. Dans la scène IV, comment ne pas céder au charme de Mycène (On pardonne aux premiers transports) où Bénédicte Tauran se montre aussi délicieuse qu’elle peut être redoutable quand par la suite, elle incarne Junon avec toute l’autorité qui sied. La descente de Jupiter est annoncée par un charmant chœur jouant d’effets d’écho : le Chœur de chambre de Namur (dont les chefs de chœur sont Leonardo Garcia-Alarcón et Thibaut Lenaerts) y fait preuve d’une subtilité idoine, comme d’ailleurs dans toutes les pages chorales de l’œuvre caractérisées à la perfection. Mercure permet à Fabien Hyon d’entonner avec panache Que tout l’univers, que le chœur développe dans la foulée. Le Jupiter de Edwin Crossley-Mercer est hiératique dans son entrée, déployant d’impressionnantes vocalises sur le mot tonnerre, idée reprise par les basses du chœur, comme un grondement souterrain, le dieu n’entendant pas se servir de la foudre mais venant au contraire apporter la paix.
L’Acte II reprend un procédé coutumier des premiers opéras de Lully : exposer la tragédie dans une scène avec les personnages principaux (Jupiter et Io) à laquelle répond une scène dévolue aux personnages secondaires (Mercure et Iris). Le tout s’opère par des récitatifs soutenus alors du seul continuo. Soulignons le raffinement de celui-ci, qui réunit : Emmanuel Jacques (basse de violon), Kaori Uemura (viole de gambe), Laura Mónica Pustilnik (luth et guitare), Korneel Bernolet (clavecin et orgue) et Christophe Rousset (lui-même au clavecin). Notre seule réserve tient à sa modestie quantitative car nos musiciens accompagnent, commentent, illustrent une foule d’intentions, conférant à ces scènes en récitatif toute la dramatisation et servant magistralement la déclamation. Mercure et Iris (magnifique Ambroisine Bré) se livrent à de délicieux duos. Celui sur Le moindre artifice fait la part belle aux marches d’harmonie et à une neuvième que Lully place malicieusement quatre mesures avant la fin, offrant une conclusion savoureuse. La fête organisée dans les jardins d’Hébé, déesse de la jeunesse est pleine de vivacité avec son menuet introductif auquel succède l’air délicat Les plaisirs les plus doux (à nouveau Ambroisine Bré, endossant un nouveau rôle). Arrive ensuite le célèbre duo des nymphes (Julie Calbète et Julie Vercauteren issues du chœur), dont on apprécie la présence des deux strophes pour mieux se délecter encore de son écriture raffinée. Le tempo, un peu plus lent que dans d’autres versions, étonne à la première écoute. Mais Christophe Rousset a vu juste : malgré l’injonction Aimez, profitez du temps, il s’agit surtout de séduire et d’enjôler. La bourrée chantée Que ces lieux ont d’attraits fut un grand succès à l’époque puisqu’on la trouve dans des recueils parodiques (en particulier bachiques) : elle s’affirme avec vigueur, le chœur de Namur lui conférant un allant irrésistible.
L’Acte III est un chef d’œuvre à lui seul. C’est sans aucun doute le sommet de l’œuvre. Après une vive ritournelle à l’écriture soignée en trio, nous faisons connaissance d’Argus (une sorte de Charon ayant acquis des lettres de noblesse) qu’incarne avec superbe Philippe Estèphe. Celui-ci nous livre trois airs bien différenciés. Le premier d’entre eux joue sur les oppositions entre aimable (chanté tendrement) et coupable (d’un ton péremptoire). Le deuxième (Vous n’en serez pas mieux) exprime à Io son infortune sur un ton mi menaçant, mi goguenard. Le troisième exhorte Hiérax, son frère, à renoncer à Io Dégagez-vous d’un amour si fatal. Au fa majeur des deux premiers succède un ré mineur agité de figurations orageuses des violons et de figuralismes sur lance la foudre. Suit un rare duo de basses sur Heureux, qui peut briser sa chaîne auquel s’enchaîne une pastorale héroïque miniature (genre auquel Lully devait apporter un sommet avec Acis et Galatée, neuf ans plus tard). Rien n’y manque : une sorte de prologue avec le chœur des nymphes à l’élan irrésistible (Liberté, liberté, sentiment ressenti physiquement par l’auditeur qui reçoit ce mot asséné comme en étant pris dans un tourbillon). Mercure, alors déguisé en berger, justifie à Argus l’irruption de ce divertissement, qui n’est qu’un subterfuge pour libérer Io. Une scène pastorale est introduite par une marche des bergers et des satyres où la musette apporte ses notes agrestes (excellent François Lazarevitch) auquel répond un duo inoubliable dès la première écoute où brillent Cyril Auvity et Fabien Hyon (Quel bien devez-vous attendre) et marqué par d’heureuses modulations (là aussi, on apprécie vivement la restitution des deux strophes). Puis s’enchaîne le drame qui va se jouer entre Pan (judicieuse idée que de le confier à Edwin Crossley-Mercer : le renoncement de Pan préfigurant celui de Jupiter) et Syrinx (à nouveau Ambroisine Bré qui ne cesse de nous séduire). Au milieu des récitatifs et petits airs surgit un grand double chœur (cet épisode englobe 132 mesures à lui seul) opposant deux masses inégales et aux textures différenciées : quatre voix pour les sylvains, satyres et bergers exhortant à aimer sans cesse, et trois voix hautes (dessus, bas-dessus et hautes-contre) pour les nymphes qui s’y opposent (N’aimons jamais). Syrinx voulant échapper aux ardeurs de Pan s’élance dans une course effrénée appelant ses compagnes à la chasse, ce qui nous vaut un tableau cynégétique en bonne et due forme : fanfares et appels à travers bois jusqu’à la rupture dramatique sur Cruelle, arrêtez qui amorce la métamorphose de la nymphe en roseau.
S’élève alors l’une des pages parmi les plus belles de celles nées de la plume de Lully : la plainte de Pan. Les flûtes (remarquables François Lazarevitch et François Nicolet) sanglotent autant qu’elles dépeignent le vent soufflant dans les roseaux. Les soupirs sont bien marqués (ce qui n’est pas toujours le cas des autres versions) : or ceux-ci s’avèrent nécessaires pour souligner l’état de sidération de de Pan : Quel bruit !, « Qu’entends-je ? Émaillée de délicats chromatismes descendants ou ascendants, la basse crée presque à elle seule une atmosphère de désolation avec une économie de moyens confondante pour une émotion portée à son paroxysme. Les yeux qui m’ont charmé amplifient encore la plainte avant que les deux bergers ne viennent offrir leur soutien à Pan dans une sorte de pompe funèbre intime articulée autour du trio des voix et du duo des instruments de dessus qui commentent la scène à la manière d’un chœur imaginaire. Cette scène est absolument bouleversante et partagée ici de manière intense. L’épouvante qui gagne les protagonistes et préalable à l’apparition de Junon est traitée de manière lapidaire : quelques mesures de chœur syllabique et un simple récitatif pour l’arrivée de la Furie qui enlève Io. C’est que Lully, le magicien, nous réserve bien d’autres surprises pour la suite !
Antithèse de l’acte II, l’acte IV est lui aussi hors normes. Sous prétexte de tortures infligées à la pauvre Io, nous voici plongés d’emblée dans l’endroit le plus glacé de la Scythie. D’abord exprimé au seules cordes (a priori sans basse continue dans le matériel de 1677, pour souligner encore davantage la nudité de cet environnement hostile), le motif des trembleurs avec ses notes répétées (procédé repris par la suite par Purcell et Vivaldi notamment) gagne le chœur ne requérant que les voix masculines (la formule des Songes funestes d’Atys est ici remobilisée, mais de façon presque comique, là où l’opéra précédent en faisait une page terrifiante et cauchemardesque). Le contraste est on ne peut plus saisissant lorsque nous sommes transportés dans les forges des Chalybes. L’onomatopée Tôt, tôt, tôt s’y exprime de façon entêtante entrecoupée d’exclamations du chœur invitant à préparer tout ce qu’il faut, allumer le feu des forges et travailler d’un effort nouveau. C’est une musique populaire qui s’affirme ici, comme un chant d’ouvriers entonné dans une ambiance enthousiaste. Le récit de la Furie (Cyril Auvity électrisant de présence) rappelle que Io est ici pour souffrir. Un troisième tableau offre une vaste fresque où le chœur de la suite des Parques fait une entrée remarquée sur un rythme martelé (Exécutons l’arrêt du sort) qu’entrecoupent les irruptions inopinées de diverses calamités (la guerre, l’incendie, les maladies violentes : Philippe Estèphe ; la famine, l’inondation : Cyril Auvity ; les maladies languissantes : Fabien Hyon). La tension monte encore d’un cran avec le premier air des Parques aux figurations agitées des violons et où les cordes se parent d’un tranchant terrible (le ciseau venant mettre un terme à la vie est là sans le moindre doute). Notons les couleurs sépulcrales du chœur sur C’est aux Parques de l’ordonner, dont l’effet est quasi surnaturel. La ritournelle introduisant le trio des Parques prend des allures de marche funèbre, grâce aux roulements de tambour (l’excellente Marie-Ange Petit est de la partie !). Par son harmonie recherchée (la modulation au deuxième degré s’opérant habilement par le mi bémol de la deuxième Parque et non par chromatisme), cette page ne dut pas laisser Rameau insensible qui y rendit hommage dans son premier trio des Parques d’Hippolyte et Aricie. Les paroles Tournent dans nos mains donnent lieu à des échanges entre les voix traduisant le texte musicalement avec une évidence rare. On en veut presque à Lully de ne point faire durer davantage ses idées mais c’est qu’il agit autant comme dramaturge que musicien. La fin de l’acte s’opère sur un chœur abrupt (C’est l’arrêt du destin, il est irrévocable) faisant écho à celui de l’acte précédent, dont il reprend le syllabisme martelé.
L’acte V débute par une ritournelle splendide dans la tonalité sombre de fa mineur avec des incursions en si bémol mineur (sous-dominante) et la bémol majeur (relatif), raretés pour l’époque. C’est sans doute ce genre de page qui fit passer l’ouvrage comme particulièrement savant. Les flûtes viennent y apporter leurs notes endeuillées avant de céder la place au monologue de Io. Celle-ci est littéralement incarnée par Ève-Maud Hubeaux. Quelle voix splendide et quel tempérament de tragédienne ! On est frappé par le gabarit vocal : voilà une future Médée pour Thésée (s’il venait le projet à Christophe Rousset de l’enregistrer, ce qu’on ne peut trop ardemment souhaiter!). Elle ferait également une extraordinaire Cybèle dans Atys ou une Cérès de feu dans Proserpine ! Force est de constater qu’en effet, Ève-Maud Hubeaux est davantage Isis que Io ! Elle pourrait presque apparaître surdimensionnée pour la nymphe. Mais peut-on décemment regretter quoi que ce soit quand s’élève Terminez mes tourments, puissant maître du monde ? Sans la moindre mise en scène, elle vous fait ressentir par la justesse de son jeu dramatique, ses qualités de diction et les mille et une couleurs de sa voix toute la souffrance de son personnage, jusqu’aux sanglots entrecoupés de silences sur Heureuse, heureuse, si je meurs. La grande ritournelle en fa majeur qui éclate dans la foulée fait l’effet d’une lumière aveuglante. Celle-ci précède la réconciliation de Junon avec Jupiter moyennant son renoncement à aimer Io, ce qui nous vaut un beau duo aux paroles divergentes (Abandonnez votre vengeance/ j’abandonnerai ma vengeance). Le final mobilise d’abord un double chœur où dialoguent les divinités (Venez divinité nouvelle) et les Égyptiens (Isis tournez sur nous nos yeux) avant de céder la place au duo Junon/ Jupiter célébrant l’immortalité d’Isis et fournissant le matériau au chœur dans un mouvement d’accélération (à 3/8) débouchant sur des danses allègres (la première est un rondeau faisant sonner avec bonheur les trompettes, écho à celles de la Renommée du prologue et la seconde des canaries alertes) avant de conclure sur l’acclamation déjà entendue.
Vous l’aurez compris, Isis regorge de beautés magnifiquement défendues ici. L’équipe réunie par Christophe Rousset s’avère exemplaire, homogène dans ses qualités. Malgré des effectifs bien inférieurs à ceux de la création, l’implication de chaque instant des instrumentistes, des chanteurs et du chœur restitue à merveille le caractère foisonnant d’une partition parmi les plus riches de Lully. Les Talens Lyriques peuvent donc s’enorgueillir une fois encore d’un succès incontestable et nous font saliver d’envie à l’égard du prochain : Thésée ? Cadmus ? Psyché ? Proserpine ? Acis et Galatée ? Une chose est sûre : Lully y gagnera encore.
Publié le 04 déc. 2019 par Stefan Wandriesse
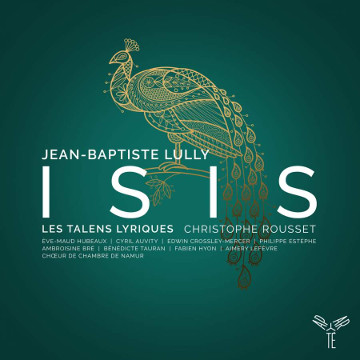 ©
©