Leçons de Ténèbres - Couperin
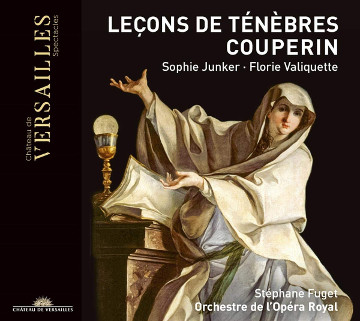 ©La Théologie, par Michel François Dandré-Bardon
©La Théologie, par Michel François Dandré-Bardon Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notice trilingue (français-anglais-allemand), un CD, durée totale : 60 minutes, 30 secondes. Château de Versailles Spectacles - 2020
Compositeurs
- François Couperin (1668-1733) : Première Leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint
- Deuxième Leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint
- Troisième Leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint
- Michel-Richard de Lalande (1657-1726) : Cantique quatrième - Sur le Bonheur des Justes et le Malheur des Réprouvés (Texte de Jean Racine)
- François Couperin : Motet pour le jour de Pâques - Victoria Christo Resurgenti
Chanteurs/Interprètes
- Sophie Junker (dessus)
- Florie Valiquette (dessus)
- Orchestre de l’Opéra Royal :
- Lucile Boulanger, basse de viole
- Alice Coquart, basse de violon
- Pierre Rinderknecht, théorbe
- Direction, clavecin, orgue : Stéphane Fuget
Pistes
- 1.François Couperin : Première Leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint - Incipit Lamentatio. Aleph. Quomodo sedet sola civitas
- 2.Beth. Plorans ploravit in nocte
- 3.Gimel. Migravit Juda propter afflictionem
- 4.Daleth. Viae Sion lugent
- 5.He. Facti sunt hostes
- 6.Jerusalem convertere
- 7.Deuxième Leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint - Vau
- 8.Et egressus est a filia Sion
- 9.Zain. Recordata est Jerusalem
- 10.Heth. Peccatum peccavit Jerusalem
- 11.Teth. Sordes ejus in pedibus
- 12.Jerusalem, convertere
- 13.Troisième Leçon de Ténèbres pour le Mercredi Saint - Jod. Manum suam misit hostis
- 14.Caph. Omnis populus ejus gemens
- 15.Lamed. O vos omnes qui transitis per viam
- 16.Mem. De excelso misit
- 17.Nun. Vigilavit jugum iniquitatum mearum
- 18.Jerusalem, convertere
- 19.Michel-Richard de Lalande (1657-1726) : Cantique quatrième - Sur le Bonheur des Justes et le Malheur des Réprouvés : Heureux qui de la Sagesse
- 20.De quelle douleur profonde
- 21.Infortunés que nous sommes
- 22.Pour trouver un bien fragile
- 23.De nos attentas injustes
- 24.Ainsi d’une voix plaintive
- 25.François Couperin (1668-1733) : Motet pour le jour de Pâques - Victoria Christo Resurgenti : Victoria Christo resurgenti
- 26.Haec est dies
- 27.Sic Jesus Pastor
- 28.Praesta nos ut resurgamus
L’éloquence sacréeLecteur, tu pourrais, à bon droit, me taxer de parti pris pour ces nouveaux lauriers tressés à Stéphane Fuget et ses musiciens. La pierre angulaire récemment posée au service de l’œuvre sacrée de Lully (voir ma chronique) m’avait en effet conduit à me montrer particulièrement louangeur. Il y a quelque temps déjà, je vantais ici les mérites de la version des Leçons de Ténèbres de François Couperin, livrée par le bel ensemble Les Ombres. Et déjà, se posait la question : fallait-il encore un nouvel enregistrement de ces œuvres déjà abondamment servies par une discographie riche et marquée par de nombreuses réussites ? À l’écoute de ce nouvel opus publié dans la collection Château de Versailles Spectacles, la réponse est indubitablement oui.
Avec des moyens beaucoup plus intimes que dans son fastueux Lully, Stéphane Fuget livre ici des Leçons véritablement habitées. Là où beaucoup de ses confrères font de la musique -certes excellente- il ajoute un supplément d’âme et une dimension spirituelle fondée sur une intertextualité éclairée entre texte poétique et texte musical. C’est à peine si la traduction du latin s’avère nécessaire tant la façon d’illustrer le propos par le chant, l’accompagnement, ô combien soigné, rendent le propos d’une intelligibilité confondante. En outre, le programme s’avère très intelligent dans ses rapprochements. Écrites dans un rayonnant ré majeur qui transperce la nuit de son éclat, les Leçons de Couperin partagent avec le trop rare Cantique de Michel Richard de Lalande une même tonalité (celui-ci est également écrit en ré, alternativement majeur et mineur) et un esprit analogue invitant au repentir, les réprouvés regrettant amèrement leur inconduite passée au vu des félicités réservées aux justes qui ont choisi la Sagesse comme ferment de leur vie. Écrit en la majeur (à la dominante), le Motet pour le jour de Pâques vient, quant à lui, offrir par sa jubilation le dépassement des souffrances endurées par la Passion et clôturer dans la lumière de la Résurrection cette petite heure de musique qui évite toute reconstitution d’un office au profit d’une mise en perspective d’œuvres et de textes parents par la pensée et le message qu’ils délivrent.
Datant probablement de 1714, les trois Leçons du Mercredi Saint nous feront regretter à jamais la perte de celles que Couperin avait composées quelques années plus tôt pour le Vendredi Saint à l’intention des Dames Religieuses de Longchamp (mais aussi celles du Jeudi comme le compositeur nous l’indique dans sa préface de l’exemplaire gravé avec un soin méticuleux et conservé par la Bibliothèque nationale). L’abbaye de Longchamp, fondée par Isabelle de France, sœur de Saint-Louis, jouissait d’une grande réputation au XVIIIe siècle, les guides recommandant l’endroit notamment pour y venir entendre chanter l’office des Ténèbres, lors de la Semaine Sainte « de deux heures jusques à quatre heures de l’après-midi » comme l’indique Nemeitz dans son Séjour de Paris en 1727.
Si Bachaumont indique dans ses Mémoires secrets (1768) que « les filles y ont brillé à leur ordinaire », c’est qu’elles devaient posséder l’art du chant en perfection. La lecture attentive de la partition de Couperin indique la nécessité de voix très souples (les mélismes sur les lettres hébraïques sont des modèles achevés de vocalises), aux aigus faciles, versées aussi bien dans l’air sérieux (de grandes plaintes nécessitent un certain souffle au cœur des deux premières leçons notamment) que dans le récitatif aux exigences déclamatoires réelles.
À Sophie Junker est réservée la première Leçon. Après l’Incipit issu d’un plain-chant sublimé, le Quomodo nous plonge d’emblée dans l’atmosphère de lamentation. Après l’admirable vocalise sur Beth éclate le Plorans ploravit, plainte grandiose (en ré mineur, grave et dévot) que la reprise adoucit à peine car sur ex omnibus c’est un cri de douleur qui vous fend l’âme même. La modulation au relatif (fa majeur) nous plonge dans une autre ambiance. Le climat s’assombrit en ut mineur pour une brève halte sur requiem. Daleth offre sa courbe tourmentée pour nous préparer au fa mineur de l’affliction de Viae Sion et à un effet saisissant sur gementes où tout semble chanceler, de la voix à la basse qui vacille. He vient culminer sur son lumineux la aigu alors que la basse s’anime en noires égales pour moduler en mineur à l’évocation des inimici. La fin est particulièrement doloriste (le rapport mi bémol-do dièse et cette chute tourmentée sur tribulantis). Le Jerusalem convertere semble faire écho au Plorans ploravit comme jamais, en en retrouvant les couleurs. Les multiples reprises du motif de la basse se font chaque fois plus insistantes. Et après une cadence rompue de toute beauté sur Deum tuum, la voix s’élève pour conclure magnifiquement (sur cette basse frémissante sol, sol dièse menant à la cadence parfaite).
Florie Valiquette aborde la deuxième Leçon avec la sérénité du Vau initial qu’accompagne un contrechant de la viole d’un grand raffinement. L’ante faciem fait monter la tension et après la douce caresse de Zain, c’est au relatif de si mineur qu’une noble passacaille (comme celle du 8e Ordre) installe une déploration désespérée sur Recordata est. La basse s’élève d’abord dans son premier segment (si, do dièse, ré, mi, fa dièse, si) avant de retomber chromatiquement (si, la dièse, la bécarre, sol dièse, sol bécarre, fa dièse, si). L’absence d’aide accordée à Jérusalem est marquée par l’interruption quasi brutale du motif obstiné, quand la voix est toute entière dans l’aigu sur Et non esset auxiliator. Si le peccatum peccavit est péremptoire, l’Ipsa autem gemens conversa est retrorsum est terriblement attendrissant dans sa nudité et son intériorité. Le délicat Teth ne prépare en rien à la violence qui anime le Sordes ejus qui lui oppose un contraste saisissant, le non habens consolatorem reprend la basse chromatique descendante (en sol mineur cette fois), au vu de la parenté de texte. L’exhortation finale sur Jerusalem est d’une beauté confondante. Il y a un tel amour dans cette façon de prononcer le nom de la ville qu’on ne peut qu’en être bouleversé. La phrase s’étire (le tempo est d’une lenteur idoine), savoure la résonance sur Dominum Deum tuum (où la basse se tait), pour conclure accablée de souffrance.
La troisième Leçon marie les deux voix (Sophie Junker -1er dessus- et Florie Valiquette -2e dessus) avec un bonheur tel que l’extase mystique n’est pas loin. Sur Jod, c’est un véritable mouvement de sonate en trio qui inaugure le propos, à l’influence italienne indéniable (dissonances provoquées par les retards des dessus et basse en noires égales qui déroule son flux régulier). Le Couperin des Goûts Réunis et des Nations est déjà là. C’est d’ailleurs une sorte de triptyque car Caph est vocalisée sur une idée analogue, enchâssant le Manum suam qui fait alterner les deux voix avant de les réunir de façon verticale sur Quia vidit. C’est à nouveau si mineur qui vient noircir l’atmosphère sur Omnis populus ejus. Les silences qui accompagnent Vide et considera sont comme marqués d’une gestuelle déictique qu’on perçoit de façon imaginaire grâce aux voix, tant l’intention est superbement rendue.
Le O vos omnes offre un véritable pendant musical à l’illustration choisie si judicieusement en couverture, La Théologie, de Michel François Dandré-Bardon (1700-1783) où le Attendite et videte semble faire écho au geste de la figure allégorique. L’effet est incroyable quand les deux voix s’assemblent, Couperin réitérant l’injonction au prix d’un enchaînement inoubliable d’ut majeur à sol mineur. La fièvre gagne alors le discours, les voix accélérant le rythme (Couperin indiquant expressément « un peu plus animé »), la basse s’anime de croches et une terrible cadence sur un accord de septième diminuée (furoris sui) marque une dramatique rupture, cédant finalement au repos. Si Mem apporte un véritable baume par ses entrelacs introduisant un double récit sur De excelso, Nun jouit des frissons procurés autant par la marche de septièmes de la basse que l’irruption soudaine du mineur aux voix. Le Vigilavit propulse le dernier verset qui contient une fin animée, mobilisant à nouveau un effet d’accélération comme plus haut, mais réaffirmant de façon de plus en plus insistante ré majeur avec cette montée dans l’aigu flamboyante. Contrairement aux deux précédentes Leçons, celle-ci s’achève dans la sérénité, Couperin y déployant un contrepoint splendide où les deux voix de dessus ne cessent de s’entrecroiser pour se poser sur un accord de triton (ad Dominum) débouchant sur une cadence ornée sur Deum tuum d’une extrême beauté. Tout concourt ici, voix et instruments, à faire de cette Leçon un moment d’élévation en tout point admirable.
Nous ne pouvons trop nous réjouir d’une nouvelle version du Cantique de Lalande sur un magnifique texte de Jean Racine. En effet, malgré quelques témoignages vidéos des Nouveaux Caractères et de l’Ensemble Correspondances, seule la fort belle exécution des Arts Florissants avec les splendides voix de Véronique Gens et Noémie Rime avait su rendre hommage à cette page du Surintendant de Louis XIV. Si l’historiographie fait souvent de Madame de Maintenon la commanditaire de ces œuvres, rien n’exclut une demande royale au sujet de ces divertissements dévots comme l’indique dans une publication passionnante le musicologue Thierry Favier. Lalande ne fut d’ailleurs pas le seul à se pencher sur ces cantiques savants à la forme bien différente des airs spirituels de Bacilly puisque Moreau, Collasse, Marchand, De Bousset et un certain Duhalle exercèrent leur plume à en illustrer musicalement le propos. Doté d’une forme strophique mais aussi de plusieurs musiques différentes (ici en ré majeur et ré mineur) alternant ou faisant l’objet de reprises sur de nouvelles paroles, ce cantique s’ouvre d’une manière très originale, sans la moindre basse continue, la deuxième voix remplissant cet office après quelques mesures. Malgré cette grande économie de moyens, il s’agit d’une œuvre particulièrement éloquente. Lalande y déploie un savoir-faire étonnant par son efficacité, bien éloignée des vastes fresques latines de ses grands motets.
N’étant pas un adepte inconditionnel du français restitué, je dois souligner combien le travail mené sous l’égide de Jean-Noël Laurenti s’avère ici convaincant. Si les finales, par exemple, sont prononcées, elles le sont avec douceur et une rare élégance. Et alors que la version des Arts Florissants versait dans une certaine austérité, les reprises musicales sur différentes strophes donnent ici matière à un renouvellement permanent, de telle sorte que jamais on n’ait l’impression de redites totalement similaires. C’est qu’encore une fois, le travail sur le texte s’est avéré prépondérant, tout entier au service d’un discours porteur de sens. En outre, l’art si subtil de l’ornementation permet à chaque strophe de bénéficier d’une caractérisation très soignée, avec d’infimes variations de tempo, des passages donnant lieu à retenue, des silences (proches des « petites pauses » que Couperin indique dans ses Leçons) et des doubles ornés (Bacilly et Collasse ne sont pas loin).
Couperin indiquait dans sa préface : « Si l’on peut joindre une basse de viole, ou de violon à l’accompagnement de l’orgue ou du clavecin, cela fera bien. » C’est bien l’option qui a été retenue fournissant une incroyable variété d’éclairages, trouvant ici peut-être encore plus de liberté. Clavecin et orgue (Stéphane Fuget très inventif et dénué de bavardage), Lucile Boulanger (admirable basse de viole), Alice Coquart (basse de violon fournissant une assise solide) et Pierre Rinderknecht (théorbe raffiné) tissent une trame d’une rare richesse, faisant de leurs instruments des protagonistes à part entière qui chantent et déclament à l’instar des voix. Ne se bornant pas à accompagner, ceux-ci concertent, généreusement servis par une prise de son qui ne les repousse pas à l’arrière-plan comme trop souvent.
Le Motet du jour de Pâques s’offre comme une synthèse puisqu’en quelques minutes se trouvent rassemblées toutes les qualités qui ont été développés lors des trois Leçons et du Cantique. Des guirlandes de doubles croches inaugurales et une basse qui vrombit (la pierre du tombeau roule…) donnent lieu à une acclamation particulièrement jubilatoire (Victoria), libérant la tension qui s’est accumulée au terme de la Semaine Sainte. Après deux récits, c’est un climat d’adoration qui nous étreint à nouveau sur O Jesus, O Salus, Lux et Vita avant que n’éclate de nouveau une joie dansante irrésistible sur l’Alluya final.
Lecteur, tu l’auras compris, ces lauriers sont amplement mérités. Dans son incontournable biographie de Couperin, le regretté Philippe Beaussant disait au sujet de la fin de la troisième Leçon : « Je ne crois pas qu’on ait jamais mieux compris l’essence du cantique de Jérémie, que par ce nom transfiguré (Jerusalem) en chant, métamorphosé lui-même en lamentation, et qui la contient tout entière. » Paraphrasons ce propos et disons pour finir : je ne crois pas qu’on ait jamais mieux compris - que Stéphane Fuget et ses musiciens, l’essence même de cette musique portant l’éloquence sacrée au pinacle.
Publié le 07 mai 2021 par Stefan Wandriesse
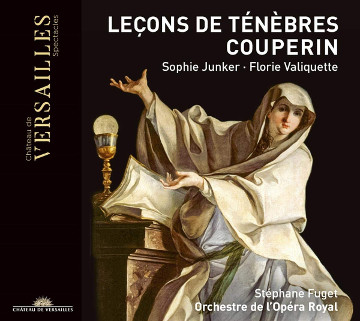 ©La Théologie, par Michel François Dandré-Bardon
©La Théologie, par Michel François Dandré-Bardon