Magnificat à la Chapelle royale - Blanchard
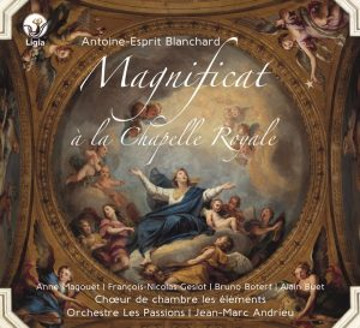 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret bilingue (français-anglais) comprenant les textes et une notice de présentation de Bernadette Lespinard, un CD , durée totale : 77 minutes - Ligia - 2016
Compositeurs
- Antoine-Esprit Blanchard (1698 - 1770)
Chanteurs/Interprètes
- Anne Magouët (dessus)
- François-Nicolas Geslot (haute-contre)
- Bruno Boterf (taille)
- Alain Buet (basse-taille)
- Choeur de chambre Les Eléments :
- Dessus : Cécile Dibon-Lafarge (solo), Anne-Marie Jacquin, Cyprile Meier, Eliette Parmentier
- Hautes-contre : Damien Brun, Marc Pontus, Benjamin Woh
- Tailles : Marc Manodritta, Michaël Smith, Guillaume Zabé
- Basses-taille : Antonio Guirao, Jean-Baptiste Henriat, Mathieu Le Levreur
- Basses : Alexandre Chaffanjon, Didier Chevalier, Xavier Sans
- Orchestre Les Passions :
- Dessus de violon : Olivier Briand,Nirina Betoto, Marie Bouvard, Ariane Dellenbach, Nathalie Fontaine, Myriam Gevers, Liv Heym, Lucien Pagnon
- Tailles de violon : Marie-Liesse Barau, Myriam Bis-Cambreling
- Basses de violon : Etienne Mangot, Marjolaine Cambon
- Contrebasse de violon : Jean-Paul Talvard
- Orgue : Yasuko Uyama-Bouvard
- Flûtes : Philippe-Alain Dupré, Fabienne Azéma
- Hautbois : Xavier Miquel, Philippe Canguilhem
- Bassons : Marc Duvernois, Mélanie Flahaut
- Cors : Lionel Renoux, Olivier Brouard
- Serpent : Volny Hostiou
- Timbales : Guillaume Blaise
- Direction : Jean-Marc Andrieu
Pistes
- 1.Magnificat : Magnificat anima mia
- 2.Et exultavit
- 3.Quia fecit
- 4.Et misericordia
- 5.Fecit potentiam
- 6.Deposuit
- 7.Esurientes
- 8.Suscepit Israel
- 9.Sicut locutus est
- 10.Gloria
- 11.De Profundis : De Profundis
- 12.Si iniquitates
- 13.Quia apud te
- 14.A custodia matutina
- 15.Quia apud Dominum
- 16.Et ipse redimet Israel
- 17.Requiem aeternam
- 18.In exitu Isael : In exitu Israel
- 19.Mare vedit et fugit
- 20.Montes exultaverunt
- 21.Quid est tibi mare
- 22.A facie Domini
- 23.Qui convertit patriam
- 24.Non nobis Domine
- 25.Non nobis Domine
- 26.Super misericordia tua
- 27.Simulacra gentium
- 28.Non morti laudabunt te
- 29.Sed nos qui vivimus
Blanchard, « mousquetaire » du gallicanisme en musiqueDans la France de l’Ancien Régime, la musique sacrée entretient des relations intimes avec le pouvoir politique. Le « grand motet » (ou « motet à grand chœur ») en constitue la figure emblématique. Ce genre musical spécifiquement français caractérise les pièces interprétées lors de la messe basse quotidienne à laquelle assiste le roi : pendant qu’un chanoine de la Chapelle royale dit la messe à voix basse, le roi entend un grand motet dont le texte « ne répond pas aux exigences liturgiques du jour, mais participe de la louange au monarque » (Philippe Vendrix – Musique et pouvoir au XVIIème siècle - 2004), un petit motet au moment de l’élévation et l’incontournable hymne royal Domine salvum fac regem, en fin de célébration. Ainsi, l’art du compositeur d’un grand motet se lit-il dans sa capacité à prolonger un temps religieux (à voix basse) par un temps politique (l’éclatante louange du monarque régnant).
L’exécution quotidienne de ces motets solennels contraint les maîtres de musique de la Chapelle Royale à renouveler sans cesse leur répertoire s’ils ne veulent pas subir l’humiliation suprême, celle de « devoir diriger la composition d’un collègue », précise Bernadette Lespinard. Pourtant, malgré leur génie et leur dévouement, Philippe d’Orléans (le Régent) constate que « les plus belles choses trop entendues et trop souvent répétées deviennent à la fin ennuyeuses, et … les motets de Lalande, malgré leur grand nombre et l’extrême beauté de la plupart d’entre eux, commençaient à tomber dans ce cas » (L’Etat actuel de la musique du roi et des trois spectacles de Paris – 1773 cité par Olivier Baumont – La musique à Versailles – 2007). Pour varier les musiques, rien ne vaut une bonne émulation. Aussi, à la mort de Michel-Richard de Lalande (1657-1726), les quatre trimestres (quartiers) de l’année sont attribués à quatre sous-maître chargés de composer et d’exécuter la musique lors des cérémonies religieuses. Comme les Trois mousquetaires, les sous-maîtres de la Chapelle Royale seront désormais quatre, du moins sur le papier. Esprit Joseph Antoine Blanchard sera l’un d’eux. Il succède à Nicolas Bernier (1664-1734) et cédera sa charge, en 1765, à Julien-Amable Mathieu (1734-1811).
La réputation de Blanchard a précédé sa nomination à la Chapelle Royale. Ainsi, en 1733, Jean-Jacques Rousseau fait-il appel à ses services pour prendre des leçons de musique. Voici son témoignage : « Venture (son ami) m’avait beaucoup parlé de l’Abbé Blanchard son maître de composition, homme de mérite et d’un grand talent, qui lors était maître de musique de la Cathédrale de Besançon et qui l’est maintenant de la Chapelle de Versailles… J’arrive à Besançon. L’Abbé Blanchard me reçoit bien, me promet ses instructions et m’offre ses services » (Les Confessions – Livre V). La confiscation de ses bagages à la « douane » française empêchera finalement Rousseau de mener à terme son projet de formation. Cette même année, un motet de Blanchard « fut très goûté et fort applaudi par une très nombreuse assemblée » assistant à un concert donné par le Concert Spirituel, à Paris (Mercure de France – décembre 1733). De succès en succès, il finit par faire « exécuter … plusieurs motets, à la messe du Roi et de la Reine, qui ont été trouvés fort beaux, et le Roi, en sortant de la messe hier (15 mars 1738), dit à cet abbé qu’il était très content de sa musique. On croit qu’il sera reçu maître de musique de la chapelle » (Mémoires du duc de Luynes sur la Cour de Louis XV – Tome 2). Et c’est effectivement ce qui advint au cours de cette année-là.
Mais qui était donc cet Abbé Blanchard ? Marc-François Bêche (1729-1794 ?), haute-contre à la Chapelle Royale, a tracé son portrait et l’a placé en tête du recueil manuscrit qu’il a constitué en recopiant les « meilleurs motets » de son ami : « Monsieur Blanchard était doux et modeste ; il aimait à rendre justice au mérite de ses contemporains. Il joignait à une très bonne éducation et d’excellentes études, un fond de piété admirable qui se faisait clairement apercevoir dans toutes ses productions. Sa musique est extrêmement savante, pleine de grâce et de génie. Sa manière de moduler était facile, touchante et séduisante. Enfin, les véritables connaisseurs et le grand Rameau lui-même lui ont tous rendu justice de dire qu’il fut un des plus excellents compositeurs de musique d’église parmi les maîtres qui ont travaillé pour la chapelle du roi ». (Notes sur la vie de Monsieur Blanchard in Recueil des motets choisis de feu Monsieur Blanchard… – Bibliothèque Nationale de France).
Pour constituer son programme, Jean-Marc Andrieu a choisi trois parmi la quarantaine de motets de Blanchard qui nous sont parvenus. Alors, ces qualités transparaissent-elles dans l’interprétation qu’il a gravée sur cette galette ? Sans anticiper la conclusion, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que c’est un Blanchard généreux, pieux et maître de son art qu’il donne à entendre dans ce CD qui nous a totalement séduit.
C’est par un Magnificat daté de 1741 que débute le concert. En composant cette musique, Blanchard prend nettement ses distances avec sa forme traditionnelle pour lui donner, en quelque sorte, celle d’un opéra en deux actes. Trois chœurs enserrent respectivement trois puis quatre récits confiés aux chanteurs solistes. Le premier est guidé par les instruments. Dans une courte sinfonia d’ouverture menée sur un rythme de danse, ils indiquent le tempo et tracent la ligne mélodique sur laquelle va se poser le chœur. De la même manière, chaque reprise du premier verset est annoncée par une ritournelle instrumentale préfigurant les variations de couleur et de tonalité apportées au chant. Quant au chœur final, il fait l’effet d’un magnifique feu d’artifice sonore. Il débute délicatement par l’intonation joyeuse lancée par Alain Buet pour célébrer la divinité trinitaire. Dès le verset suivant, c’est par un énergique Sicut erat in principio (Comme il était au commencement) que le chœur et l’orchestre vont gravir un crescendo irrésistible menant à un Amen étincelant.
Mais c’est le chœur central qui nous paraît le plus caractéristique du motet versaillais. Annoncé par une symphonie aux allures martiales, ce grand chœur fugué décrit un tableau vivant : un bras puissant se déploie (fecit potentiam) pour disperser les orgueilleux (dispersit superbos). Le style figuratif de Blanchard s’y déploie en toute liberté, tant dans la description de la majesté de la potentiam que dans la débandade des superbos exprimée par les cordes, à grand renfort de croches. S’agit-il vraiment d’un hommage rendu à Dieu ? A nos yeux, la louange s’adresse plus probablement au roi Louis XV qui, précisément en 1741, s’est décidé à prendre parti dans la guerre de Succession d’Autriche. Cet hymne à la majesté royale transparaît encore plus nettement lorsque nous comparons le Magnificat de Blanchard à celui de Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749) (voir notre chronique : Motets de Clérambault). Deux indices convergent dans le sens de notre hypothèse. D’abord, les deux versets du Fecit potentiam de Blanchard sont séparés des versets suivants et déclamés par un chœur puissant ; Clérambault, au contraire, les inclut dans un bloc de six versets confiés à un seul chanteur soliste. Par ailleurs, la volonté de Blanchard de magnifier la puissance royale se perçoit également dans le dialogue engagé par Anne Magouët avec le chœur (Quia fecit mihi magna qui potens est, le Puissant fit pour moi des merveilles). Dans sa composition, c’est précisément ce verset que Blanchard décide de faire répéter avec force par le chœur alors que Clérambault choisit de souligner, par la même technique mais par un chanteur soliste, le verset suivant (Et sanctum nomen ejus, Saint est son nom). Si, en 1704, ce cantique virginal conservait sa vocation religieuse, il prend, en 1741, la dimension d’un instrument à usage politique.
Avec le De Profundis, nous changeons radicalement de contexte, de tonalité et même de style. Ce type de composition, inspiré du Psaume 129/130, est traditionnellement exécuté lors des offices funèbres ainsi que le jour de la Toussaint. Cette fois, les chœurs font surtout office d’ouverture et de conclusion. Le premier mouvement suscite une intense émotion produite par l’association de violons déchirants et de bassons tourmentés. Il est traversé par quelques dissonances signifiant l’angoisse devant la mort et les lentes chutes mélodiques figurant la vie qui s’éteint peu à peu. Le chœur met ensuite des mots sur l’image lugubre dessinée par l’ouverture instrumentale. Il est tour à tour plaintif et suppliant dans un clamavit (je crie) pathétique lancé depuis tous les pupitres du petit chœur. L’émouvant récit qui réunit Bruno Boterf et Alain Buet confirme le doute qui saisit le pécheur à la veille de sa mort : quis sustinebit (qui subsistera ? ) s’interrogent-ils dans ce beau duo accompagné par le basson et soutenu par un continuo sombre. Anne Magouët invite pourtant à ne pas s’abandonner au désespoir : le pardon des fautes est possible pour celui qui craint Dieu. Sa voix claire et son engagement imposent peu à peu une tonalité plus lumineuse, celle de l’espérance. Emporté par sa conviction, le chœur amplifie le message par un sustinuit anima mea presque joyeux. La répétition et la longue tenue de notes du Speravit transforme progressivement ce chant funèbre en un air affirmant la joie de la délivrance. Le duo à l’allure de danse qui réunit Anne Magouët et Cécile Dibon-Lafarge achève merveilleusement cette séquence dédiée à la paix intérieure retrouvée. Mais la douleur de la perte d’un proche renaît dans un Quia apud Dominum misericordia (car près de Dieu est la grâce) admirablement transformé par François-Nicolas Geslot en une imploration traversée par le doute. Ces deux versets avaient été retravaillés par Blanchard dans une version de son opus datée de 1764. Il y ajoute une dimension tragique dans laquelle la musique (languissante) et le verbe (l’espoir en la miséricorde) ne parlent pas complètement le même langage. Cette partition convenait pourtant à l’immense douleur ressentie par Blanchard quand, dans sa dernière prestation publique, il dirigea ce motet à l’occasion des funérailles de la reine Marie Leszczynska à Saint-Denis, en juin 1768. Cette mélodie douloureuse s’éloigne pourtant, cédant la place à deux chœurs successifs. Le premier évoque le rachat des fautes d’Israël. Le second, plus intéressant, constitue un résumé des différents tableaux qui se sont succédé dans le motet. Il débute par un air qui nous rappelle le carillon des morts de Michel Corette (1707-1795) joliment restitué par Skip Sempé dans un concert donné à Versailles (voir notre chronique : Requiem pour le service funèbre de Rameau par Jean Gilles) mais également les premières notes de celui que composa Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772) pour les obsèques d’Henri Madin (1698-1748). Il rappelle ensuite, dans le Requiem aeternam final, le thème douloureux du début. Enfin, et sans transition, la musique change de rythme et de tonalité pour développer un lux perpetua luceat eis (et que la lumière éternelle les illumine) absolument rayonnant. Ce motet funèbre témoigne, selon nous, de la foi de son compositeur. Par sa musique, il a su admirablement traduire à la fois la peur devant la mort et la joie de la délivrance qu’elle apporte finalement à ceux qui croient. Certes, son De Profundis eut moins de succès public que celui de Mondonville. Mais il en dit davantage, à nos yeux, sur l’homme et le croyant qui ont inspiré le compositeur. Ce qui le rend d’autant plus attachant.
Après ces deux pièces en premier enregistrement mondial, Jean-Marc Andrieu propose maintenant l’audition du Psaume 114/113A In exitu Israel. Sa première interprétation contemporaine revient à l’Ensemble Jubilate de Versailles, dirigé, en 2004, par Michel Lefèvre. C’est en 1749 que Blanchard compose ce motet destiné aux Vêpres, soit dix ans après celui d’Antonio Lucio Vivaldi (voir notre chronique : Gloria, Magnificat de Vivaldi) et quatre ans avant celui de Mondonville.
La magnificence de la sinfonia liminaire contraste avec celle de Mondonville, plus tourmentée à nos yeux. Sa tonalité délibérément solennelle tranche avec la version joyeuse de Vivaldi. Le sifflement des fifres et le battement des timbales suggère clairement une entrée royale si l’on en croit Yolande de Brossard et Erik Kocevar: « le fifre joue du moment que le roi vient » (Etats de la France (1644-1789) in Recherches sur la musique française classique – Tome 30). Le roi étant installé, le chœur se tourne maintenant vers Dieu, sur une note plus factuelle, pour évoquer la consécration de la nation d’Israël. Déjà, le battement des cordes et l’agitation des violons annoncent le début des phénomènes naturels qui accompagnent la sortie d’Egypte. Dans un bel exemple de musique visuelle inspirée par la musique d’opéra, l’orchestre décrit les turbulences aquatiques : la mer s’enfuit, le Jourdain remonte vers sa source. Le jeu des cordes figure, de façon réaliste, le sifflement du vent dans ce spectaculaire Mare vidit et fugit. Alain Buet superpose à ce fond sonore secoué, le récit des événements. Si, dans la version de Mondonville, les voix tremblantes expriment le trouble qui saisit les témoins de la scène, c’est aux instruments que Blanchard confie ce soin. Mais l’agitation temporaire fait rapidement place à des airs plus apaisés. D’abord, des cordes sautillantes poussent François-Nicolas Geslot à décrire les montagnes bondissantes, sur un tempo cependant plus nerveux que dans le motet de Mondonville. De son côté, Anne Magouët interroge les éléments aquatiques : mais pourquoi fuyez-vous donc ? Le chœur leur rappelle délicatement, dans un beau passage homophonique, que facta est Judae sanctificatio ejus (Dieu consacra la nation des juifs à son service) et qu’il n’y a donc rien à craindre. Anne Magouët, dans un air plein d’allégresse, en veut pour preuve la joie qui anime les montages et les collines. Et le récit qu’elle partage avec le chœur s’achève, paisiblement, par un Israel potestas ejus déférent. Cette séquence est interrompue par l’annonce d’un tremblement de terre. Comme pour Mondonville, Blanchard va puiser aux sources pour décrire ce phénomène naturel. L’un et l’autre s’inspirent manifestement du Chœur des Trembleurs de l’Isis de Jean-Baptiste Lully (1632-1687), Mondonville pour évoquer la fuite de la mer, Blanchard, comme d’ailleurs Vivaldi, pour décrire le tremblement de terre. C’est ensuite par des frottements stridents des cordes que Blanchard prépare la scène de la conversion de la pierre en torrent par Moïse. Mais, après la tonalité dramatique de cette entrée en matière, François-Nicolas Geslot et le chœur s’appliquent à raconter l’épisode sur un mode plus paisible : un bel effet de contraste. C’est ici que Mondonville interrompt son récit. Son psaume ne rejoindra celui de Blanchard qu’au moment du chœur final.
Dans la composition de Blanchard, trois magnifiques séquences vont maintenant se succéder. D’abord un chœur splendide qui s’adresse, nous semble-t-il, indistinctement à Dieu et au roi lorsqu’il est question de tua da gloriam. Commencé dans le recueillement et sur le mode homophonique, le Non nobis Domine explose soudain pour libérer une fugue enjouée, d’une richesse d’écriture digne des plus grands. Les violons sautillent, les basses imposent un rythme énergique, les voix se croisent, se séparent et se retrouvent dans un final majestueux. Avec François-Nicolas Geslot, le calme revient. Il forme, avec les violons, un émouvant duo pour évoquer la question grave de la croyance en Dieu. Pourtant, l’air est enjoué, prenant même des allures de danse dans le Super misericordia tua qui introduit et conclut la séquence. Sur la même tonalité, il poursuit le récit pour décrire, par le menu, l’inanité des idoles. Cependant, nous confessons une préférence pour ce passage dans la version où Vivaldi fait dialoguer le soliste et le chœur dans une aimable litanie. C’est sous le souffle des vents et de cuivres et par deux chœurs que s’achève le chant du psaume. Le premier choeur, en forme de fugue, déclare que les morts ne peuvent louer Dieu. Malgré le caractère dramatique du texte, la musique qui l’emporte est moins sombre que dans la partition de Mondonville. Les timbales et les cuivres habillent le dernier chœur de cette solennité ample qui nous avait déjà conquis à l’ouverture.
Ces trois pièces, dont deux en premier enregistrement mondial, nous font découvrir un compositeur qui « a un nom parmi les meilleurs musiciens français du XVIIIème siècle », selon le Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie (1922). Ce livret-CD confirme la place de Jean-Marc Andrieu au rang des musiciens-déchiffreurs. Et nous tenons à lui rendre hommage parce qu’il nous renforce dans la conviction que le répertoire de la musique baroque recèle encore de nombreux trésors enfouis. L’exercice est difficile car les partitions de cette période nécessitent un travail de préparation, longtemps avant de commencer à penser à réunir les musiciens appelés à l’interpréter. En nous faisant connaître ces pièces extraordinaires qui ont constitué « l’ordinaire » des messes royales, il a manifestement fait de la belle ouvrage. Alors, quand donc nous fera-t-il goûter à ce Laudate Dominum quoniam bonus est qui a tant plu au couple royal ?
Les cinq chanteurs solistes ont animé les nombreux récits avec une science parfaitement maîtrisée. Anne Magouët se fait l’interprète des textes d’une voix lumineuse commandée par une diction maîtrisée. Ses duos avec Cécile Dibon-Lafarge impressionnent, tant leurs expressions sont joliment complémentaires. Alain Buet s’impose face au flot des croches rapides. Son interprétation du second verset du Magnificat (Et exultavit spiritus meus) nous a particulièrement marqué. François-Nicolas Geslot est soumis à rude épreuve, notamment dans le Psaume In exitu Israël. Il relève avec succès le défi de l’amplitude vocale, imposée par la partition, même s’il donne parfois l’impression de toucher à ses limites. Enfin, Bruno Boterf sait libérer l’émotion retenue par son auditeur, particulièrement dans le Et misericordia du Magnificat.
En outre, Jean-Marc Andrieu dispose d’un corps de musiciens de talent qui ont réveillé, avec délicatesse, des notes endormies depuis plus de deux siècles. S’ils y sont parvenus, c’est évidemment grâce à l’expertise de chacun des interprètes et aux qualités de l’instrument qu’ils ont apprivoisé. Mais c’est surtout parce que la magie du groupe a opéré, particulièrement dans les symphonies descriptives. Et cette même passion a manifestement animé les choristes. Ils constituent un ensemble d’artistes de la voix qui ne forment qu’un seul corps aux multiples facettes. Instrumentistes et chanteurs font ici la démonstration que, lorsque Les Eléments rencontrent Les Passions, c’est pour le plus grand plaisir de leur public.
Les artistes actuels ont été remarquables, nous ne le dirons jamais assez. Mais, pour une fois, pensons également aux musiciens contemporains de Blanchard, ceux qui ont été les acteurs de la création des œuvres que nous avons tant appréciées. Bien qu’ils resteront sans doute toujours des inconnus, nous voulons conclure par une pensée qui leur soit destinée. D’autant que, l’année de la création du Magnificat, le marquis d’Argenson rapporte que « hier (donc le 20 octobre 1741), les musiciens de la cour vinrent représenter à M. Orry (le « ministre des Finances ») que, n’étant pas payés, ils mouraient de faim ; qu’ils étaient de pauvres diables qui n’avaient que cela pour vivre, à Versailles surtout, où les vivres étaient si chers. M. Orry leur a répondu : « Vraiment, messieurs, le roi a bien d’autres musiciens en Allemagne » (Journal du règne de Louis XV – Tome IV). Derrière la musique qui nous ravit, n’oublions donc jamais ceux qui en sont les artisans.
(Cet enregistrement est disponible sur le site des Passions : Les Passions)
Publié le 14 janv. 2017 par Michel Boesch
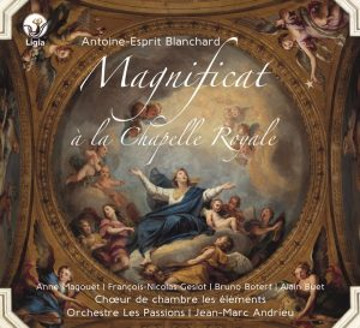 ©
©