Les Paladins - Rameau
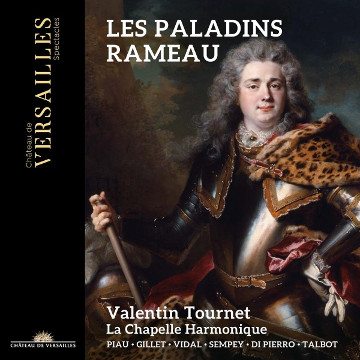 ©Charles-Armand de Gontaut, 2e Duc de Biron, par Nicolas de Largillière (1714) - © Pascal Le Mée
©Charles-Armand de Gontaut, 2e Duc de Biron, par Nicolas de Largillière (1714) - © Pascal Le Mée Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notice trilingues (français-anglais-allemand) de Loïc Chahine, 3 CD, durée totale : 164 minutes, 59 secondes. Château de Versailles Spectacles - 2022
Compositeurs
- Les Paladins
- Comédie ballet en trois actes de Jean-Philippe Rameau (1683-1764) sur un livret attribué à Pierre-Jacques Duplat de Monticourt
- Créée 12 février 1760 à l’Académie Royale de Musique (théâtre du Palais Royal)
Chanteurs/Interprètes
- Sandrine Piau (Argie)
- Anne-Catherine Gillet (Nérine)
- Mathias Vidal (Atis)
- Florian Sempey (Orcan)
- Nahuel Di Pierro (Anselme)
- Philippe Talbot (Manto)
- Ensemble La Chapelle Harmonique
- Chœur :
- Premiers dessus : Alice Duport-Percier, Dorothée Leclair, Ellen Giacone, Alice Ungerer
- Deuxièmes dessus : Jeanne Lefort, Cécile Madelin, Armelle Morvan, Marie Planinsek
- Hautes-contre : David Tricou (un Paladin), Lancelot Lamotte, Arnaud Le Dû, Sylvain Manet, Marc Scaramozzino
- Tailles : Tarik Bousselma, Davy Cornillot-Dufeu, François Joron, Thomas Lefrançois, Augustin Laudet
- Basses-tailles : Nicolas Boulanger, Thierry Cartier, Laurent Collobert, Christophe Gautier, Sergio Ladu, Halidou Nombre, Guillaume Olry
- Orchestre :
- Premiers dessus de violons : Florence Malgoire, Philippe Couvert, Lucien Pagnon, Kee Soon Bosseaux, Claire Jolivet, Alexandre Delcroix
- Deuxièmes dessus de violons : Bernadette Charbonnier, Adrien Carré, Myriam Mahnane, Heriberto Delgado, Helena Lescoat
- Parties de violons : Jean-Philippe Vasseur, Aurélie Métivier (hautes-contre), Benjamin Lescoat, Deirdre Dowling (tailles)
- Basses de violon : Claire Giardelli (continuo), Emilie Wallyn, Natalia Timofeeva
- Contrebasse : Richard Myron
- Flûtes et petites flûtes : Jean Bregnac, Geneviève Pungier
- Musettes : Jean-Pierre Van Hees, Nadia Vazquez Martinez
- Hautbois : Emmanuel Laporte, Guillaume Cuiller
- Bassons : Inga Klaucke, Josep Casadella
- Clavecin : Béatrice Martin
- Cors : Jaire Pablo Gimeno Veses, Gilbert Cami
- Percussions : Mickael Metzler
- Direction : Valentin Tournet
Pistes
- 1.CD I - Ouverture très vive
- 2.Menuet
- 3.Gai
- 4.Acte I - Scène 1, Air « Triste séjour, solitude ennuyeuse », Argie
- 5.Récits et Air « L’hymen qu’on vous prépare » - « Qu’il faut attendre l’époux » - « Quel espoir veux-tu qu’il me reste ? », Argie, Nérine
- 6.Ariette vive « L’amant peu sensible et volage », Nérine
- 7.Scènes 1 et 2, Récit et Trio « Argie, holà, Nérine » - « J’entends le bruit des clefs » - « Quelle rigueur austère » - « Non, non, non, non » - « Cédez à sa rigueur », Argie, Nérine, Orcan
- 8.Scène 3, Récit et Air « Seras-tu toujours inflexible » - « Eh, comment veux-tu que l’on aime ?», Nérine, Orcan
- 9.Air « Ma voix deviendrait plus sonore », Orcan
- 10.Air « Écoute, Orcan, écoute », Nérine
- 11.Récit et Duo vif « Tais-toi, tais-toi » - « Serpent, retire-toi », Nérine, Orcan
- 12.Scènes 3 et 4, Annonces et Récits « Quels concerts insolents » - « Qu’ai-je entendu ?» - « Mais les sons que j’entends » - « Accourez, venez voir », Argie, Nérine, Orcan
- 13.Scène 4, Air « Est-il beau comme le jour », Nérine
- 14.Récit « Orcan veille de ce côté », Argie, Nérine
- 15.Scène 5, Entrée de pèlerins
- 16.Ariette vive et gaie « Accourez amants », Atis
- 17.Gavotte gaie
- 18.Air, Récits et Chœur « L’espoir nous mène au bout du monde » - « Ah, j’en possédais un si fidèle » - « Venez le chercher avec nous » - « Pour retrouver Atis », Argie, Atis, Chœur
- 19.Air « Quand sous l’amoureuse loi », Atis
- 20.Récit et Duo « C’est une fée enchanteresse » - « Vous m’aimez », Argie, Atis
- 21.Première gavotte gaie et deuxième gavotte
- 22.Air gai
- 23.Scène 6, Bruit de guerre et Récit « Fuyez le sort qui vous menace », Nérine, Atis, Orcan
- 24.Air, Récit et Duo très vif « Je meurs de peur » - « Orcan j’aime à voir ce grand cœur » - « Défends-toi », Orcan, Atis
- 25.Gay, Récits et Chœur « Belle Argie, obtenez ma grâce » - « Nérine, Nérine » - « Vous, dont le zèle me seconde » - « Qu’il soit armé pèlerin », Orcan, Nérine, Atis, Chœur
- 26.Air gay
- 27.Chœur « Le joli, le gentil pèlerin », Argie, Nérine, Atis, Chœur
- 28.Loure
- 29.Pantomime
- 30.Contredanse
- 31.Galop. Récit et Chœur « Qu’ai-je entendu » - « Fuyez Atis, sauvons-nous » - « C’est un éclair qui fend l’air », Argie, Nérine, Atis, Orcan, Chœur
- 32.CD II - Acte II : Scène 1 – Ritournelle
- 33.Récit, « Mon cœur, tu n’as que peu d’instants ». Anselme
- 34.Scène 2, Récits « Mais quel bruit ! » - « Ah Seigneur, sauvez-vous », Orcan, Anselme
- 35.Scène 3, Récit « La, la, la », Argie, Anselme
- 36.Air « Vous méditiez, perfide », Anselme
- 37.Récit, « Nommez l’auteur de ce dessein », Argie, Anselme
- 38.Scène 4, Air, « C’est ce poignard, perfide », Anselme
- 39.Scène 5, Récit, « Approche, Orcan », Orcan, Anselme
- 40.Scène 6, Lent et Récit, « Je ne puis donc me venger moi-même », Orcan
- 41.Scène 7, Ariette, « C’est trop soupirer », Nérine
- 42.Récit, « Le voilà cet amant », Nérine, Orcan
- 43.Duo et Récit, « Non, non, je ne puis dire », Nérine, Orcan
- 44.Scène 8, Air de furie et récit, « Quel bruit ! Quels monstres, justes dieux », Orcan, Atis
- 45.Récit et Chœur « Démons, frappez » - « Frappons », Atis, Orcan, Chœur
- 46.Air très vif, « Je suis la furie », un Démon (Atis)
- 47.Scène 9, Récits, « Monstre, vois la beauté » - « Espérons un destin plus doux », Argie, Atis, Orcan
- 48.Scène 10, Entrée de Paladines et ensuite de Paladins
- 49.Récit, « Vengeur des beautés qu’on outrage », Atis
- 50.Air et Chœur, « Formez les nœuds les plus charmants » - « Formons les nœuds », Atis, Chœur
- 51.Sarabande
- 52.Premier menuet en rondeau et deuxième menuet
- 53.Entrée très gaye de troubadours
- 54.Ariette lente, « Je vole, Amour », Argie
- 55.Air très gay
- 56.Gavotte un peu lente
- 57.Menuet
- 58.Contredanse
- 59.Simphonie vive et Récit, « Quel nouveau bruit se fait entendre ? », Atis, un Paladin
- 60.CD III - Acte III : Scène 1, Air, « Tu vas tomber sous ma puissance », Anselme
- 61.Chœur, « Attaquons » - « Mais, ô ciel ! », Anselme, Chœur
- 62.Air, « Quels jardins délicieux », Anselme
- 63.Scène 2, Récit, « Esclave, contentez », Anselme, Manto
- 64.Ariette gaye, « « La printemps des amants », Manto
- 65.Récit, « Mais votre cœur enfin », Anselme
- 66.Air, « De ta gravité », Manto
- 67.Récit, « Mais si je suis une autre loi » - « Animez-vous », Anselme, Manto
- 68.Air pour les Pagodes
- 69.Scènes 2 et 3, Récits et Airs, « Ton ardeur, cher amant » - « Anselme soupirant » - « Il faut savoir vaincre » - « Le crime n’est pas d’aimer » - « Ah ! Connais mieux mon cœur », Argie, Anselme, Manto
- 70.Scène 3, Trio, « Vengeons, vengeons », Argie, Anselme, Manto
- 71.Scène 4, « Reconnaissez Manto » - « Ô Divinité » - « Je veux que ces jeux » - « Je vois la foule », Argie, Nérine, Atis, Manto
- 72.Duo, « Ah que j’aimerai », Argie, Atis
- 73.Air vif
- 74.Chœur, « L’amour chante » - « Livrez-nous », Nérine, Chœur
- 75.Entrée des Chinois
- 76.Loure
- 77.Gigue vive
- 78.Première gavotte et deuxième gavotte
- 79.Ariette gaie, « Lance, lance », Atis
- 80.Contredanse, chœur
- 81.Air gay
- 82.Addendum : Ouverture très vive
- 83.Acte II, Scène 10, Ariette très gaye, « Pour voltiger », Nérine, Atis
- 84.Acte III, Scène 4, Pantomime d’un Chinois et d’une Chinoise
- 85.Acte III, Scène 4, Deuxième air, mouvement de rigaudon
- 86.Acte III, Scène 4, Rigaudon
- 87.Acte III, Scène 4, Contredanse
« Quelle ardeur ! Quel délire ! »p>
Rameau avait encore une fois présumé de la capacité de son public à accueillir une œuvre ô combien déroutante, lorsqu’au soir du 12 février 1760,
Les Paladins retentirent sur la scène de l’
Académie royale de musique. Au bout de quinze représentations, cette comédie lyrique novatrice fut retirée et sombra dans l’oubli. Pourtant, le compositeur n’avait point ménagé sa peine, accumulant nombre de hardiesses : une étonnante ouverture reprenant des motifs issus de la pièce, des ariettes étincelantes de virtuosité, un mélange des genres d’une étonnante modernité ou encore le travestissement d’un homme en fée maure et l’apparition de Chinois au sein d’un Moyen-Âge fantasmé. Bien que donnés en plein carnaval, période de l’année propice à toutes les licences, ces
Paladins avaient de quoi déconcerter les spectateurs.
Les musicologues reprirent longtemps à leur compte les propos désobligeants de Collé, ennemi de Rameau, n’estimant sauvables que les danses, qui firent le bonheur de nombreux albums à l’ère du microsillon, la jubilatoire Entrée très gaye de Troubadours s’offrant régulièrement au beau milieu de florilèges. Le regretté Jean-Claude Malgoire avait d’ailleurs fourni chez CBS, en 1972, l’un d’entre eux, émaillant le propos chorégraphique de quelques pages vocales pour livrer presque vingt ans après une version plus ambitieuse mais tronquée. Konrad Junghänel se penchait aussi en 2010 sur l’œuvre sans convaincre pleinement, précédé par William Christie (en DVD) en 2004 mobilisant une mise en scène décalée et plutôt drôle à défaut d’être esthétique. Gustav Leonhardt, quant à lui, nous avait frustrés, en se limitant à une somptueuse suite d’orchestre si bien sentie.
C’est dire si cette œuvre a longtemps attendu une version pleinement digne de son caractère novateur. Enfin, la voici ! Le jeune Valentin Tournet a fait du chemin en un temps record. Il y a quelques années, nous assistions, médusés, à un récital qu’il donnait en solo à la basse de viole au Musée des Beaux-Arts d’Angers. Depuis, avec sa Chapelle Harmonique, il s’est consacré à Bach mais aussi déjà à Rameau dont il a livré des Indes Galantes de très belle tenue (également chez Château de Versailles Spectacles), même si, comme souvent de nos jours, à l’imitation de nos anciens, l’entrée de la Fête persane a été écartée, ne gardant au passage, fort heureusement, que l’inoubliable quatuor Tendre Amour. Ici, au contraire est offerte une version complétée de différents ajouts - la consultation des différentes partitions sur Gallica atteste d’une multiplicité de corrections -, ce qui nous vaut par exemple l’enregistrement de la première ouverture prévue par Rameau, lequel aurait modifié ses plans eu égard aux remarquables dispositions des cornistes nouvellement recrutés par l’Académie royale de musique.
Ici sont dépassées les qualités observées lors du précédent opus ramiste : cohérence du plateau, ivresse sonore autant vocale qu’orchestrale et un sens aigu de la dramaturgie pour ce que la musicologue spécialiste de Rameau, Sylvie Bouissou, qualifie de « Dramma giocoso à la française ». En effet, celui-ci met en scène deux trios de personnages. Le premier s’inscrivant dans un registre tragique et pastoral réunit le paladin Atis, Argie pupille d’Anselme, vieux barbon de sénateur qui est bien décidé à épouser de force cette dernière. Le second trio mobilise un registre bouffe et s’appuie sur la confidente d’Argie, Nérine l’enjouée, ce balourd et pleutre d’Orcan, serviteur d’Anselme et un personnage transgenre avant la lettre, l’incroyable fée Manto. Ces deux trios alimentent quantité de situations contrastées jouant avec maestria de cette dualité de registres, qui avait déplu aux contemporains mais savent incontestablement nous séduire de nos jours par un rebond constant de l’action et la mobilisation de styles musicaux des plus variés, démontrant page après page, s’il en était besoin, la suprématie de Rameau en la matière.
Celle-ci s’affiche avec superbe dès l’ouverture où Rameau, bien loin de radoter, sait une fois encore se renouveler : à l’irrésistible galop aux anapestes obsédants contrecarrés par des triolets auxquels répondent d’orageux traits des violons, il enchaîne un gracieux menuet très chantant et une contredanse déjà entendue dans la Naissance d’Osiris en 1754 et qui se mémorise sur l’instant grâce à sa rusticité joviale particulièrement réjouissante. D’emblée, La Chapelle Harmonique séduit par le fruité de ses timbres, le raffinement pleinement maîtrisé des différents plans sonores. La mise en place est confondante de précision : quelle virtuosité lors de la disparition du château à l’acte III où l’on visualise complètement par les sons ce changement de décor !
Les danses, particulièrement nombreuses dans cette œuvre, séduisent plus que jamais. Elles sont souvent d’un tour très heureux, notamment sur le plan mélodique comme en témoigne la gavotte gaye du premier acte aux imitations canoniques (aux violons et bassons) auxquelles aussitôt exposées succèdent de délicieux effets de musette. L’air gay qu’on trouve un peu plus loin mêle robustesse (avec ses cors et ses arpèges descendants à l’unisson) et charme rêveur quand la texture s’allège et les valeurs s’allongent, ce qui nous vaut de savoureux dialogues. Celui en fa majeur en reprend les couleurs sans pour autant se répéter et la contredanse du Divertissement des pèlerins sonne avec humour, interrompue par le galop sur lequel commençait l’ouverture.
L’air de furie du deuxième acte frappe par son allure mâle jouant d’effets de contrastes entre les registres aigus des cordes et leurs puissants unissons dans les graves. L’Entrée des Paladins, en ré majeur, possède aussi cette ambivalence propre à Rameau qui, après un début plein de fierté, s’abandonne à un motif plein de sensualité (deux blanches liées suivies de sept croches). L’exquise sarabande possède une délicatesse dotée d’un raffinement incomparable quand les menuets propulsés par une basse très mobile (de grandes enjambées en arpèges) séduisent par leur caractère galant (celui en majeur) ou franchement troublant (celui en mineur). L’Entrée des troubadours déjà mentionnée plus haut est une merveille d’orchestration à laquelle La Chapelle Harmonique rend pleinement justice faisant tout dialoguer avec énergie et grâce : gazouillis des flûtes, sonneries agrestes des cors, effet comique des grands accords en pizzicati des cordes. Le résultat en est ici pleinement jouissif, dont l’air gay en ré majeur se fait l’écho avant de déboucher sur une gavotte en ré mineur originale par son inachèvement et un menuet marqué par des variations de dynamique parfaitement maîtrisées pour céder enfin la place à une riante contredanse dont le thème rappelle V’la l’bon vent.
Au troisième acte, l’air vif, tout en remobilisant des procédés compositionnels déjà rencontrés plus haut, s’avère terriblement entraînant comme la contredanse finale aux allures de gigue. Auparavant, par son motif sinueux et syncopé, l’Entrée des Chinois se fait ici plus sage que chez Leonhardt mais sait une fois encore séduire comme la loure (une danse dans la quelle Rameau était insurpassable) nous saisir par sa gravité sombre avant qu’un couple de gavottes ne nous fasse retrouver un sourire que les pages vocales entretiennent sans discontinuité.
Comment en effet ne point rendre les armes devant un charme mélodique de chaque instant servi par des voix idoines quant aux personnages incarnés ? L’Argie de Sandrine Piau est parfaite de justesse, sachant aussi bien nous toucher d’emblée dans son grand air introductif Triste séjour que nous éblouir dans son ariette arachnéenne Je vole Amour où tu m’appelles à l’accompagnement d’une extrême finesse. Sa voix fait encore merveille dans les deux duos d’amour si attendrissants qui lui sont réservés (Vous m’aimez et peut-être plus encore Ah que j’aimerai plein d’un émerveillement palpable sur toujours fidèle), témoignant d’une symbiose parfaite avec celle de Mathias Vidal, magnifique Atis. Celui-ci, tel un grand cru, gagne en qualité année après année, sa palette se fait de plus en plus riche sur le plan des couleurs vocales, des nuances qu’il sait répandre partout comme nous l’avions déjà souligné dans les extraordinaires Boréades parues l’an dernier dans la même collection (voir la chronique). Si son entrée avec l’ariette Accourez amants s’affirme avec une réelle autorité, toute rehaussée de l’agilité des cors, son charme triomphe avec L’espoir nous mène au bout du monde au doux balancement offert par le contrechant du hautbois ou encore avec Quand sous l’amoureuse loi aux accents suaves. Sa virtuosité s’expose également lorsqu’il parodie l’air de furie ou pour célébrer l’amour dans le divertissement final (Lance, lance).
Anne-Catherine Gillet confère à Nérine le caractère qui sied sachant manipuler Orcan à sa guise et offrant au passage une maîtrise vocale confondante. Avec L’Amant peu sensible et volage, véritable feu d’artifice, elle s’impose avec évidence dans ce rôle (incroyables vocalises sur courage). Récitatifs, petits airs, tout lui réussit. Elle sait nous subjuguer page après page : Est-il beau, beau, comme le jour ?, l’enchanteur Écoutez l’écho de sa musette ou encore le délicieux C’est trop soupirer pour ne citer que quelques exemples.
Florian Sempey habite le personnage d’Orcan de façon magistrale. Outre un gabarit vocal impressionnant (Nérine ne lui reproche-t-elle pas sa voix de Polyphème ?), celui-ci endosse le rôle comme s’il le jouait sur le théâtre. Il sait autant impressionner dans ce grand récit Je puis donc me venger dont le prélude nous rappelle les couleurs de Zoroastre (avec ses notes syncopées des bassons) que se montrer risible (Je meurs de peur, émaillé de tremblements) par sa couardise. À ce titre, à l’acte I, on relève déjà un extraordinaire duo divergent avec Atis (Défends-toi/Sauve-toi) qui trouve sa conclusion foudroyante sur Je suis mort (fausse mort évidemment !) pour déboucher sur sa demande de grâce à Argie où il supplie Nérine d’intercéder pour lui, ce qui nous vaut de désopilants soupirs sur Nérine, gémit de la façon la plus comique (sur un intervalle de seconde), de grinçants violons lui répondant en écho.
L’Anselme de Nahuel Di Pierro est également d’excellente tenue, rendant parfaitement ce personnage odieux, plein de suffisance, fourbe et oublieux de son engagement à l’égard d’Argie au troisième acte. Le timbre est noir et profond, correspondant tout à fait à ces rôles de méchants pour lesquels Rameau avait une affection toute particulière, rendant ces personnages si intéressants et les dotant de pages vocales souvent très impressionnantes. Retenons le saisissant Mais quel bruit ! Qu’est-ce que j’entends ?, le magnifique Vous méditez perfide plein d’assurance ou plus encore le fougueux C’est ce poignard aux incessantes envolées de triolets en arpèges brisés des violons qui animent le discours avec une force terrifiante. Sa rage s’exprime encore au début de l’acte III dans Tu vas tomber sous ma puissance pour laisser place, quelques mesures plus loin, de façon très convaincante à la surprise sur Quels jardins délicieux où le motif ascendant (ré/ sol/ fa dièse/ si bémol) traité en imitations à toutes les parties nous permet de visualiser musicalement cet autre changement de décor soudain.
Mais peut-être plus encore que ces personnages, c’est l’extraordinaire Manto de Philippe Talbot qui nous enthousiasme. Celui-ci nous avait déjà grandement impressionnés par des moyens vocaux hors du commun en campant un héroïque athlète dans Castor et Pollux avec Raphaël Pichon (Éclatez fières trompettes). Au troisième acte, il triomphe ici avec une enjôleuse ariette vive Le printemps des amants pour leurrer Anselme puis le menacer dans l’extraordinaire air De ta gravité, de ta majesté inoubliable dès la première écoute par sa puissance. On souhaite véritablement que ce chanteur exceptionnel trouve quelque rôle principal dans une tragédie en musique où il ferait à coup sûr merveille.
Vantons encore les mérites des ensembles d’un brio époustouflant où Rameau nous sidère par son extraordinaire maîtrise. Outre de nombreux duos auxquels nous avons déjà fait référence, le trio final Vengeons, vengeons constitue une véritable apothéose réunissant Argie, Anselme et Manto où le motif trépignant sur Tu me suivras, tu m’aimeras, m’adoreras, m’épouseras se voit contrecarré par les Non, non, plus d’esclavage dans un climat survolté et ébouriffant. Comment ne point céder également à l’ardeur qui anime Le joli, le gentil pèlerin propulsé par Argie, Atis et Nérine auquel le chœur s’adjoint de façon splendide avec des effets d’écho impeccables de mise en place pour ce qui pourrait constituer le final du premier acte ? Mais non ! C’est un éclair qui fend l’air, qui prend la relève quelques pages plus loin, s’établissant sur un tempo encore plus alerte, marqué par des motifs de fanfare (qui gronde) ou répétés à l’envi (Le bruit qu’il produit) d’une verve toute comique. Formons les nœuds les plus charmants s’avère tout autant jubilatoire, tant par son élan que ses vastes proportions et son élargissement grandiose sur le passage noté « lent » où Rameau se remémore le saisissant passage de sol majeur à fa majeur de Que ce rivage retentisse d’Hippolyte et Aricie ! Dans L’Amour chante, l’hymen soupire, écrit dans la même tonalité, le compositeur conserve le même enjouement sans se répéter pour autant. Cette allégresse contagieuse s’exprime à nouveau dans la contredanse parodiée choralement Loin de nos jeux, époux fâcheux venant conclure de façon irrésistible cette partition géniale. Voilà qui nous invite à conclure à l’instar de Nérine et d’Orcan avec un enthousiasme sans bornes : Quelle ardeur ! Quel délire !
Publié le 14 juin 2022 par Stefan Wandriesse
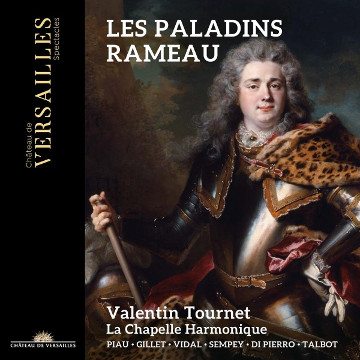 ©Charles-Armand de Gontaut, 2e Duc de Biron, par Nicolas de Largillière (1714) - © Pascal Le Mée
©Charles-Armand de Gontaut, 2e Duc de Biron, par Nicolas de Largillière (1714) - © Pascal Le Mée