Santa Editta - Stradella
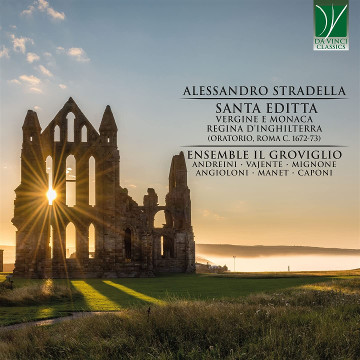 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret en anglais, un CD, durée totale : 58 minutes, 13 secondes. Brilliant Classics - 2021
Compositeurs
- Santa Editta, Vergine e Monaca, Regina d’Inghilterra
- Oratorio d’Alessandro Stradella (1643-1682) sur un livret de Lelio Orsini (1622-1696)
- Date et lieu de création inconnus
Chanteurs/Interprètes
- Ensemble Il Groviglio :
- Laura Andreini, soprano (Santa Editta)
- Silvia Vajente, soprano (Humilità)
- Michele Mignone, basse (Senso)
- Marco Angioloni, ténor (Bellezza)
- Sylvain Manet, alto (Grandezza)
- Francesca Caponi, soprano, (Nobilità)
- Thibaut Reznicek, violoncelle
- Léo Brunet, théorbe
- Marco Crosetto, clavecin
Pistes
Reine ou nonne ? La chronique d’un choixLa musique : « Plaisir de l’esprit, plaisir des sens ? », s’interrogeaient Thierry Favier et Manuel Couvreur (Le plaisir musical en France au XVIIème siècle, Mardaga, 2006). Les deux à la fois, répondrions-nous après l’écoute de la Santa Editta d’Alessandro Stradella (1643-1682).
Déjà, une simple écoute paresseuse régale nos oreilles. Elles s’abandonnent au charme de ce long chapelet de perles harmoniques, tour à tour lumineuses et ombrées. La finesse des contrastes, la fluidité des phrasés, les mélodies bercées d’humeurs changeantes et l’élégante sobriété des coloris sont sublimés par la ferveur des jeunes artistes de l’Ensemble Il Groviglio. Il est vrai que le défi à relever était de taille. Car ils ouvraient sur leurs pupitres une partition que leurs aînés de l’Ensemble Mare Nostrum avaient enregistrée en 2015 et distribuée par le label Arcana.
Mais le plaisir de l’esprit nous paraît plus gratifiant encore. Pour autant qu’il soit possible d’accéder au texte et d’inscrire, dans une même foulée, sa lecture littéraire et son audition chantée. Malheureusement, le texte est absent du livret. Une carence qui, à nos yeux, relève du manquement lorsque l’œuvre proposée au public doit impérativement s’appuyer sur deux jambes. A savoir, le texte et la musique. Afin de satisfaire notre soif d’apprendre et de comprendre, nous avons donc été contraints d’emprunter les paroles au livret qui accompagne l’enregistrement proposé par Mare Nostrum.
Tirons maintenant le fil conducteur. En premier, apparaît une image. Une image pieuse représentant sainte Edith. Non pas l’Edith française vénérée en la Chapelle des trois Vierges de Caëstre (actuel département du Nord). Mais la princesse d’Angleterre, fille illégitime du roi Edgar le Pacifique (943-975). Dans ses Petits Bollandistes : vie des saints (1876), Monseigneur Paul Guérin (1830-1908) consacre deux belles pages à Edith (Eadgyth) de Wilton (961-984). Nous retiendrons ici les épisodes en relation avec le livret mis en musique par Stradella.

Sainte Edith de Wilton
Plutôt que d’épouser le roi après son veuvage, sa maîtresse, Wilfrid (Wulthryth) se retire dans le monastère bénédictin de Wilton dont elle devient l’abbesse peu de temps après. Elle y entraîne sa fille, Edith, afin de l’arracher « à la corruption du monde… La jeune princesse profita si bien des exemples et des instructions de sa mère, qu’elle se fit religieuse dans le même couvent ». Professant l’humilité, « elle se faisait la servante des étrangers et des pauvres… L’abstinence faisait ses plus grands délices,… joignant à cette mortification celle d’un rude cilice qu’elle portait sur sa chair nue, afin de réprimer de bonne heure les mouvements de la nature… Mais son humilité parut bien davantage lorsqu’elle refusa la couronne d’Angleterre ; car, après la mort de saint Edouard II, son frère,… les seigneurs vinrent la trouver pour lui présenter le sceptre, et employèrent toutes les raisons possibles, et même tentèrent les voies de la violence pour l’obliger de l’accepter. Elle leur résista toujours généreusement, et l’on aurait plutôt transmué les métaux… que de la retirer de son cloître, et de lui faire quitter la résolution qu’elle avait prise d’être toute sa vie dévouée au service de Dieu ».
Si, en Angleterre, Edith est célébrée « pour sa sagesse, sa beauté physique et spirituelle et sa voix angélique » (Dmitry Lapa, Vénérable Edith de Wilton), son aura ne franchira la Manche qu’au XIXème siècle. A la création de notre oratorio, la sainte était donc inconnue du grand public continental. D’ailleurs, son nom n’apparaît pas dans le monumental Grand dictionnaire historique ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane (Tome 1, partie 2, 1674) de Louis Moreri (1643-1680) tandis qu’une rubrique est consacrée à son père, Edgar, ainsi qu’à son frère, Edouard.

Jean Audran, d'après Adrien Van der Werff : Marie Eléonore d'Este, princesse de Modène. © Château de Versailles – Distr. RMN – Grand Palais
Alors, pourquoi le poète et librettiste, Lelio Orsini (1622-1696), a-t-il convoqué une sainte anglaise inconnue en terres italiennes ? Nous l’ignorons, autant que les circonstances de la création de l’oratorio. Cependant, les hypothèses convergent vers un événement touchant l’histoire de l’Angleterre et impliquant un membre d’une famille princière italienne. Depuis son veuvage en mars 1671, le jeune duc d’York, futur Jacques II Stuart (1633-1701), recherche une seconde épouse. La prospection s’élargit à toute l’Europe. Sans succès. Jusqu’à ce qu’il s’arrête sur le portrait d’une princesse de Modène : Marie Béatrice Eléonore d’Este (1658-1718). « Une lumière de beauté », se pâme un témoin. Malheureusement, raconte Théodore de Wyzewa (1862-1917) dans sa Nouvelle biographie de Marie de Modène (Revue des Deux Mondes, 15 août 1906), « cette jeune princesse… avait formé le vœu de ne jamais se marier, et d’entrer au couvent ». Les tractations diplomatiques s’intensifient quand le duc d’York s’obstine à vouloir épouser cette « belle femme ». Même Louis XIV (1638-1715) intervient. Sans plus de succès : la jeune fille n’entend pas revenir sur sa position. Jusqu’à l’intervention du pape Clément X (1590-1676) qui, « peut-être pour répondre aux prières des cours d’Angleterre et de France, ou peut-être, plutôt, par sollicitude paternelle pour l’avenir des catholiques anglais, écrit, de sa propre main, à la petite princesse… une longue et belle lettre latine où il lui ordonne d’oublier son vœu et de consentir au mariage qui lui est proposé ». Son argument ? « Bien que nous comprissions que cette répugnance (au mariage) résultait d’un désir, très louable, en soi, d’embrasser la discipline religieuse. Nous en avons pourtant été sincèrement affligé, en songeant que, dans l’occasion présente, elle risquait de former un obstacle aux progrès de la religion ». Dès réception, Marie-Béatrice consent au mariage qui sera célébré, par procuration, le 30 septembre 1673. Cette décision signe la victoire des partis (dont la France) qui souhaitent le rétablissement du catholicisme comme religion d’Etat en Angleterre. Pour Marie de Modène, cet épisode, ajouté à ses épreuves ultérieures, lui vaudra ce portrait que tracera d’elle le duc de Saint-Simon (1675-1755) : sa vie, particulièrement depuis son exil en France, fut consacrée « à l’oblation de Dieu, le détachement, la pénitence, la prière et les bonnes œuvres continuelles » (Mémoires, 1718).
Il ne reste plus au librettiste qu’à relier les fils de ces deux histoires parallèles pour former la trame du texte de l’oratorio. Puis à nourrir ce canevas de propos édifiants. Une formalité pour cet érudit considéré alors comme le principe amicissimo dell’Arti liberali (littéralement : prince très ami des arts libéraux) selon Nadia Amendola (La poesia di Giovanni Pietro Monesio, Giovanni Lotti e Lelio Orsini nella cantata da camera del XVII secolo, 2016-2017). En effet, Lelio Orsini, prince de Vicovaro et duc de Nerola (deux communes limitrophes de Rome) appartient à la lignée prestigieuse des Orsini (plus connue dans sa traduction française « des Ursins »). Frère de Flavio Orsini (1620-1698), le chef du parti francophile de Rome, il se retire de la vie publique pour se consacrer à l’étude. La renommée de cet homme pieux, féru de rhétorique, de théologie et de philosophie, dépasse même les frontières. Ainsi, l’éditeur de Regensburg, Johann Zacharia Seidel, déclare que ses ouvrages doivent être considérés « en haute estime et saints d’inspiration (hoch und heilig), être lus studieusement (fleissig lesen), regardés avec considération (andächtig betrachten) et que l’enseignement et la vie doivent se régler sur ses préceptes (in Lehr und Leben sich Darnach richten soll)» (selon notre traduction de la note 13, page 255 de l’ouvrage de Nadia Amendola).
Tirons une dernière fois notre fil conducteur. Voici qu’apparaît l’appareil idéologique qui domine l’époque de la rédaction du livret. Une doctrine largement nourrie par la très influente De imitatione Christi (De l’Imitation du Christ) attribuée au moine néerlandais Thomas a Kempis (1380 ?-1471 ?). Ouvrage que les autorités religieuses post-tridentines (de Charles de Borromée aux Jésuites dont Orsini a été l’élève) désignent comme le livre de chevet du chrétien. Car toute la morale pratique utile pour guider une vie chrétienne au quotidien est formulée dans cette somme rapidement traduite dans de nombreuses langues. Nous avons consulté sa version française (1674) réalisée par un proche de Port-Royal : Louis Isaac Lemaistre de Sacy (1613-1684). Effectivement, nous y avons retrouvé les matériaux à partir desquels ont été forgés les dialogues de notre oratorio. Pour le moment, nous n’en retiendrons que le thème central. Il est reformulé, à destination d’un public aristocratique, dès le propos dédicatoire adressé à « Son Altesse royale Mademoiselle » (Anne-Marie-Louise d’Orléans dite la Grande Mademoiselle – 1627-1693). Résumons : « L’humilité d’un vrai chrétien n’est pas une bassesse… mais une élévation divine » qui, en assujettissant l’âme « à celui qui est au-dessus de tout,… méprise tout le reste ». Cet abandon des choses terrestres pour se consacrer à Dieu seul est d’autant plus crucial que les personnes qui « possèdent les plus grands avantages du monde, il ne leur reste pour s’élever, que de s’élever au-dessus du monde ; ce qu’elles ne peuvent faire qu’en s’humiliant à l’imitation de Jésus Christ ». Ces directives forment la colonne vertébrale de notre oratorio : l’humilité comme règle de conduite, le mépris du monde comme postulat et une vie consacrée au service exclusif de Dieu comme finalité de l’existence terrestre.
De fait, son oratorio, intitulé Il premio felice/ L’heureuse récompense (S. Editta) en référence à l’incipit de l’ouvrage, ne comporte ni intrigue véritable, ni effets dramatiques spectaculaires. En revanche, cet « opéra spirituel… que les Italiens appellent oratorio » (dixit François Joseph Fétis in Biographie universelle des musiciens, Tome 8, article « Alexandre Stradella », 1844) développe une dialectique savante qui permet, grâce aux vertus de la « dispute » (discussion), d’opérer la sélection entre le vrai et le faux et d’aider à la décision. Ici, un personnage de l’hagiographie anglicane est confronté à cinq personnages fictifs incarnant diverses caractéristiques humaines : Humilità (Humilité), Senso (Sens), Belezza (Beauté), Grandezza (Grandeur) et Nobilità (Noblesse). Cette personnification d’une abstraction est loin d’être inédite. Déjà, Emilio de’Cavalieri (1550-1602) couvrait de chair Intelligence, Sagesse, Temps, Corps, Ame, Plaisir, Monde, Vie mondaine ou Ange Gardien dans La rappresentatione di anima e di corpo (La représentation de l’âme et du corps) créée à Rome en février 1600. A Rome également, mais en 1707, Georg Friedrich Haendel convoquera quatre autres figures allégoriques (Beauté, Plaisir, Désillusion et Temps) dans son premier oratorio Il trionfo del Tempo e del Disinganno (Le triomphe du Temps et de la Désillusion).

Portrait d’Alessandro Stradella par Louis Denis — Bibliothèque nationale de France
C’est en 1672-73 (selon le livret) ou en 1677 (pour Nadia Amendola) que le texte de Lelio Orsini rencontre un musicien réputé : Alessandro Stradella. Certes, les auteurs se délectent surtout des frasques amoureuses de ce compositeur. Celles-là même qui causèrent sa perte. Mais ils ne manquent jamais de souligner son immense talent. Comme dans ce propos rapporté par Fétis : à la fin de l’avertissement de l’éditeur de La Forza dell’amor paterno/ Le pouvoir de l’amour paternel (1678), Stradella est « reconnu sans contestation comme le premier Apollon de la musique ». De même, dans son Histoire de la musique et de ses effets (1715), Pierre Bourdelot (1610-1684 ou 85) lui compose l’épitaphe suivante : « le plus excellent musicien de toute l’Italie ».
Dans cette Santa Editta, il appartenait au musicien de sublimer un texte difficile d’accès pour nos esprits rationnels tant il parle le triple langage de la poésie, de la spiritualité et de l’allégorie. En revanche, il est construit sur le modèle d’un véritable discours rhétorique académiquement pur que Stradella traduira dans la langue des affetti.
Le prologue fait ici fonction d’Exorde. Pour Balthasar Gibert (1662-1741), ancien recteur de l’Université de Paris, l’ouverture du discours rhétorique doit exposer « tout ce qui prépare à écouter la Cause et en donne une idée générale » (La Rhétorique ou Les règles de l’éloquence, 1742).
Humilità se présente seule à la barre. Elle personnifie « le sentiment de notre infériorité relativement à tout ce qui nous est supérieur » (Dictionnaire des notions primitives, 1773). Son discours, construit sur un mode binaire, combine un aria et un recitativo. Dans les deux couplets de l’aria, elle oppose deux types de comportements. Celui d’un alma superba (une âme orgueilleuse) qui n’accédera jamais à il premio felice (l’heureuse récompense). En face, l’âme qui men degno si crede (qui s’en croit la moins digne). Celle-là siégera assurément dans les regni immortali (royaumes immortels). Par de redoutables vocalises, la soprano Silvia Vajente souligne ardemment deux mots : sperar (espérer) et degno (digne). Comme pour mettre en balance la vanité de l’espoir des uns avec la dignité que confère l’humilité aux autres.
Humilità passe maintenant des principes aux réalités. A commencer par l’exemple d’Edith qu’elle honore du titre de britannic regni alma reina (noble reine des Britanniques). En l’occurrence, il ne peut s’agir ici de notre sainte (qui n’a jamais accédé au trône) mais, plus probablement, d’une œillade respectueuse en direction de la duchesse d’York (reine consort à partir de 1683). Dans cet édifiant recitativo, Humilità illustre les actions de sauvegarde qu’elle a prodiguée à la sainte (poiché sicura scorta è l’umiltade/car l’humilité est une escorte sûre). Cette première partie est marquée par un austère continuo (à l’image de la vie d’Edith) qui se résume à quelques accords distendus. Ensuite, dans une curieuse association de l’humilité à son contraire, l’orgueil (sovente mi do vanto/ souvent je m’enorgueillis), elle se flatte de convertir les puissants en pénitents. Dans cet exercice d’autocongratulation, l’écriture est plus expressive et plus empressée, pour la ligne de chant comme pour le continuo. Notablement lorsque ce dernier prend son autonomie pour figurer l’éclipse des puissants emportés vers les abîmes par le grave nerveux du violoncelle ou la gamme ascendante qui jaillit du clavecin pour simuler l’envol de l’âme vers le Ciel. Enfin, le rigorisme reprend ses droits pour décrire le sort tragique réservé à toute activité humaine en reformulant le verset 19 du chapitre 3 du Livre de la Genèse : non rimane dell’uomo altro che polve (il ne reste de l’homme que de la poussière). Si ces paroles fixent le cap spirituel, le continuo signale son caractère pathétique dans une ritournelle instrumentale.
Le discours rhétorique entre maintenant dans sa seconde phase : la Proposition. Pour Balthasar Gibert, l’orateur doit y énoncer « tout ce qui détermine l’état de la question ». Dans notre oratorio, cet exposé est confié à Edith. Son propos adopte une forme en arche dans lequel deux piliers constitués d’un aria et d’un récitatif soutiennent une maxime morale centrale déclamée par Grandezza et Nobilità. Les supports de l’arche se partagent l’examen des deux volets de la proposition soumise à Edith : le trône et le mariage.
Dans le premier aria, Edith invoque les speranze gradite (espoirs agréables) afin qu’ils anéantissent les tentations terrestres qui l’assaillent. Elle leur désigne l’audace piacere, le brame mal nate di pompa, di fasto (les plaisirs audacieux, les désirs inconvenants de pompe et de faste). Avec une énergie péremptoire, Laura Andreini fait vibrer cette ligne mélodique qui déborde d’une joie féroce. Elle est structurée autour de deux reprises ornées de vocalises expressives et soulignées par une ritournelle instrumentale. L’une invoque les nobili schiere (nobles bataillons) célestes tandis que l’autre désigne l’adversaire qui agresse son âme. Un appel dont elle regrettera aussitôt la lâcheté dans un récitatif tourmenté. Elle y confie son dilemme : certes, l’accès au trône offre des privilèges, mais l’expérience montre que ces avantages sont fugaces. Alors, che mi giova regnar se il tempo vola (à quoi bon régner, si le temps s’envole) ? Conclusion dont se saisit aussitôt un duo constitué par Grandezza et Nobilità. D’un commun accord, elles professent deux principes de morale chrétienne. Le premier est porteur d’espoir : seules les qualités de l’âme échappent à la mort. Pour faire briller ce message positif, les deux lignes de chant s’enlacent sur le mode de l’imitation et folâtrent sur un tempo pétillant. En revanche, le second repose sur un constat fataliste : il ne restera de l’homme que de la poussière. Ce message est précisément celui que devra retenir l’auditoire. Aussi, pour s’assurer qu’il sera aisément mémorisé, le musicien ralentit le rythme, use du procédé pédagogique de la répétition et parsème la ligne mélodique de notes longuement tenues pour qu’elles puissent plus aisément s’insinuer dans les cœurs.
Le second récitatif caresse l’hypothèse d’un mariage princier associé aux charmes d’une vie confortable. Une perspective qu’Edith écarte aussitôt pour ne pas offrir à son âme un si mal nato piacer (plaisir si inconvenant). La conclusion s’impose. Fidèle écho de celle qui l’avait conduite à écarter le trône : Che mi giova goder se il tempo vola (à quoi bon être heureuse si le temps s’envole ?) assène-t-elle en scandant chacun des mots à l’intention de son auditoire. Dans l’aria suivant, elle associe le mariage et le plaisir charnel. Le rythme fulgurant, comme les flèches de l’arciero lusinghiero (l’archer flatteur) Cupidon, fait vibrer une mélodie presque rieuse. De même, reconnaît-elle, la vie de cour prodigue des envies de pompa e fasto (la pompe et le faste). Avec toute l’énergie de la passion, Laura Andreani affronte ces deux obstacles au salut. Pour vaincre le plaisir, elle mobilise la memoria della morte (le souvenir de la mort). Et pour l’emporter sur l’envie, elle raille son inanité. En cela, son double argumentaire correspond celui que développe l’Imitation (Livre I, chapitre 1): « c’est vanité de suivre la sensualité de la chair » et « c’est vanité de se passionner pour les honneurs et de travailler à devenir grand ». Voilà le public fixé sur les enjeux de l’oratorio.
Bien entendu, ces préceptes peuvent déconcerter une partie du public. Du moins les lecteurs férus des aphorismes de Baltasar Gracian (1601-1658). Particulièrement ceux qui encouragent l’homme à user pleinement de sa liberté et à gagner « la Fortune à force de la cajoler » (L’Homme de Cour, 1647, maxime XXI). Alors, pour convertir les récalcitrants aux thèses de l’ascèse, Orsini emploie un procédé rhétorique visant à compléter la Proposition d’une Amplification Oratoire. Il n’y fera que « répéter ce qu’il a déjà dit, non pas en mêmes termes, mais avec des expressions plus nobles et plus énergiques, qui donnent à son sujet une nouvelle dignité » (Balthasar Gibert). Sur le plan stylistique, le librettiste adopte la formule des dialogues au cours desquels Edith s’entretiendra, à tour de rôle, avec chacun de ses contradicteurs.
A commencer par Senso (les Sens ou « la corporéité des passions » selon René Descartes). Dans un récitatif suivi d’un aria, Senso invite Edith à al regno de’ piaceri aprir le porte (ouvrir la porte au royaume des plaisirs). D’ailleurs, réitère-t-il dans le propos conclusif de l’aria, il ciel non è tiranno : brama il core de l’uomo e non l’affanno (le Ciel n’est pas un tyran : il désire le cœur de l’homme, non son tourment). Afin de marquer son ancrage terrestre, Stradella confie l’incarnation des Sens à une basse chantante soutenue par un continuo dominé par l’austère violoncelle. Celle de Michele Mignone, intense et finement taillée, confère une allure presque solennelle à cette invitation hédoniste. Dans un mouvement parallèle (récitatif suivi d’un aria), Edith se laisse d’abord tenter mais se ravise aussitôt : à quoi bon les divertissements qui vive solo un momento (qui ne vivent qu’un instant) ? Stradella matérialise le moment précis de cette prise de conscience par une accélération soudaine du tempo. Comme s’il voulait reproduire ce bref instant où l’âme reprend ses esprits. Une délivrance que traduit la tonalité de l’aria da capo (le seul que nous ayons identifié dans cet ouvrage) dans lequel Edith congédie les plaisirs. Pour autant, Edith peut-elle s’en réjouir ? Pas vraiment, car qual vivente lieto mai fu (quel vivant fut jamais heureux) ? Pourtant, Stradella félicite Edith de ne pas sombrer dans l’apathie tout en se conformant aux prescriptions de l’Imitation (Livre III, chapitre 54)) : « il faut réprimer la licence de nos sens ». Par conséquent, optant pour le versant positif de sa conduite, il façonne une ligne de chant chamarrée, parsemée d’intervalles redoutables et de mélismes aspirés vers les aigus. Difficultés techniques que la maîtrise vocale de Laura Andréani magnifie avec assurance.
Voici que s’avance Bellezza (la Beauté, « assemblage de traits ou de caractères, également propres à charmer les sens et à intéresser le cœur » selon le Dictionnaire des notions primitives). Son discours mêle de brefs récitatifs à de courts arias. Marco Angioloni leur insuffle autant de candeur que de conviction. Comme surgissant des pages grégoriennes dans lesquelles il jouait le premier rôle, le ténor adopte, de prime abord, la posture du célébrant qui annonce la parole de Dieu : Di chi brama il tuo ben ascolta i detti (Ecoute les paroles de celui qui désire ton bien). Par son truchement, Bellazza développe ensuite un argumentaire en deux temps. Dans un premier aria, elle démontre que la mortification finit par rendre cruel. Pour évoquer les sacrifices que s’inflige le pénitent, le tempo progresse à l’allure d’un chemin de croix dans un climat assombri par un continuo affligé. Il s’échauffe lorsqu’il en dénonce les effets délétères. Sa thèse : même l’âme aspire aux plaisirs. Dans une ligne mélodique ascendante, elle interroge Edith : la beauté de ton visage qui rend’ogn’alma soggetta (assujettit toutes les âmes) n’est-elle pas un don que t’a fait la nature ? Celle-ci ne partage pas cette opinion. Dans un récitatif empruntant sa forme au rondeau (deux parties réglées par un refrain), elle assure ne pas vouloir s’élever « pour les qualités avantageuses et pour la beauté du corps, puisqu’elle s’altère et se flétrit » (Imitation, Livre I, chapitre 7). Deux affects vont s’affronter. L’ascèse domine l’essentiel du texte. Dans une succession de phases d’agitations et d’accablements, Edith détaille les pratiques de mortification qu’elle s’inflige. Le musicien figure chacune de ces souffrances par un trait expressif singulier. Ici, le coup frappé sur le clavecin pour rendre son visage difforme ou pour symboliser le supplice de l’autoflagellation. Plus loin, les privations agitent un rythme enfiévré. Enfin, dans une gamme expirante, le violoncelle pleure ces yeux noirs qui perdent leur grâce. En revanche, une profession de foi joyeuse se niche dans le refrain. Edith y souligne la félicité que lui procure son assujettissement à Dieu. Car chié piacer non si dee se non a Dio (on ne doit de plaisir qu’à Dieu). Dans un aria apaisé qui conclut sa dispute avec Bellazza, elle repousse définitivement les signes extérieurs de beauté, persuadée de leur caractère mensonger (ah, troppo mendaci). Puis, elle renouvelle sa profession de foi heureuse et déclare se consacrer désormais à Dieu. Car « Dieu est seul la véritable joie de son cœur » (Imitation, Livre II, chapitre 5).
Grandezza (la Grandeur ou « toute dignité éminente, tout poste qui donne une grande puissance et une grande autorité » selon le Dictionnaire des notions primitives) est flanquée de Nobilità (Noblesse ou le « corps politique d’un Etat » selon le même Dictionnaire) et de Senso. Sa fonction souveraine la conduit à s’exprimer en premier. Notons que l’expression de cette souveraineté est confiée à une voix d’alto. Cette distribution satisfait la prédilection du public pour les voix aiguës, notamment celles des castrats (le Néron de l’Incoronazione di Poppea (1642) de Claudio Monteverdi (1567-1643) était initialement interprété par un soprano masculin). Sur un ton solennel, Grandezza spécule sur la postérité de la princesse et s’étonne qu’elle goder, e tu regnar disdegni (ose mépriser le bonheur de régner). Le trio la prévient ensuite que souvent on torna ad amar quel che disprezza (désire à nouveau ce qu’(on) a méprisé). Ce terzetto adopte l’allure d’un madrigal montéverdien dans lequel les voix s’enchevêtrent avec grâce. S’il revient au continuo de sonner la conclusion, ce sont les voix qui enchantent. D’autant qu’elles pétrissent une pâte riche mariant le grave et l’aigu. Pourtant, Edith n’est pas convaincue car « la paix règne toujours dans les cœurs humbles » (Imitation, Livre I, chapitre 7). Elle préfère le Paradis aux regni incostanti (royaumes inconstants). Un Paradis dont elle entrevoit déjà les beautés dans les deux strophes d’un aria. L’âme s’y projette, soulevée par d’ardentes vocalises. La ligne de chant courtise les aigus, comme si elle tentait de nous familiariser avec ce séjour séraphique dans lequel la virtuosité vocale de Laura Andreini nous installe déjà.
La rhétorique musicale entre maintenant dans une nouvelle phase : la Confirmation ou « tout ce qui sert à établir notre prétention », explique Balthasar Gibert. Pour y parvenir, l’orateur dispose de deux moyens : la Preuve ou la Réfutation. Orsini opte pour le second. Afin de mettre en lumière la fausseté des arguments adverses, le librettiste insère dans son oratorio une forme de dénouement dramatique inspiré de l’opéra. Les différentes parties vont s’affronter. De cet affrontement naîtra la sentence morale finale.
La première compétition oppose Grandezza et Humilità. Si la première s’étonne que l’on puisse mépriser ce à quoi d’autres aspirent, la seconde s’inquiète che si gioisca ove periglio vedo (que l’on se réjouisse là où je vois un danger). Dans un duetto digne d’une scène d’opéra, elles convergent d’abord pour lancer un appel à contribution : qu’il se manifeste, celui qui sait comment apporter la paix à nos âmes. Sans attendre de réponse, leur unité explose. Le discours s’enflamme et l’échange dégénère en salves d’apostrophes. Silvia Vajente et Sylvain Manet incarnent parfaitement ces points de vue irréconciliables et parviennent à donner à cette algarade un caractère théâtral.
La seconde confrontation voit s’affronter Edith, Bellazza et Senso. Ces deux personnages fictifs vont la surprendre en pleine méditation. Mais auparavant, dans un récitatif couronné d’un aria, notre sainte invite les tentations à l’assaillir. Car l’indizi son del nostro ben i mali (les malheurs sont les indices de notre bonheur). L’Imitation (Livre I, chapitre 22) ne dit pas mieux : « le plus heureux est celui qui souffre quelque chose pour l’amour de Dieu ». La mise en musique de ces deux mouvements révèle autant le sens du contraste du compositeur que sa perspicacité dans l’analyse du sens du texte. Ainsi, tandis que le libellé du récitatif décrit la vie confortable qu’offrent les palais, le théorbe blâme cette vision orgueilleuse par le pincé accusateur de ses cordes graves. De même, l’aria baigne dans un climat enjoué alors que le texte en appelle aux sinistri eventi (sinistres événements). Tout le drame intérieur d’Edith est résumé dans ces effets de clair-obscur.
Voici que Bellezza l’arrache à sa réflexion en réitérant le propos de Grandezza : pourquoi fuis-tu ce que d’autres désirent ? Pour ne pas s’opposer à la volonté du Ciel, rétorque-telle. Mais pourquoi te fouetter, réplique Senso ? Pour infliger des blessures aux sens et se perfectionner, rétorque la sainte. Pourtant, en humaniste résolu, Orsini se devait de condamner la violence de la pratique régulière de la « discipline » (l’autoflagellation), encore fréquente dans les couvents. Aussi, dans le dernier aria de cet épisode, ce n’est pas Edith, mais Senso, qui prononcera les paroles raisonnables. Suole senza sferza in regio petto (le sens doit se soumettre à la raison) assène Michele Mignone sur un ton de procureur. Dans ce finale incandescent soufflent de redoutables vocalises, aiguillonnées par les accords accablants du théorbe.
Grandezza, Nobilità et Bellezza se coalisent maintenant pour lancer une nouvelle salve d’arguments. La première lui propose de se reposer, espérant qu’elle se ravisera à son réveil. La seconde déplore le grand vide potentiel résultant de l’absence de descendance. Pour matérialiser ce vide, le chant s’exhale du lointain. La troisième regrette l’oubli éternel de son nom auquel s’expose la princesse. A chacun, Edith oppose une profession de foi exaltée. D’abord, le sommeil empêche de se consacrer aux œuvres nécessaires à son salut. En d’autres termes : « souvenez-vous toujours que votre fin est proche et que le temps perdu ne revient point » (Imitation, Livre I, chapitre 25). Ensuite, une vie livrée all’instabil fortuna (à la fortune instable) finit par sombrer. Car « c’est une vanité que de penser avec empressement aux choses présentes et de ne prévoir pas les futures » (Imitation, Livre I, chapitre 1). Enfin, il est digne de s’oublier soi-même sans oublier Dieu. De fait, « si vous vous occupez entièrement de Dieu et de vous, vous serez peu touché de tout ce que vous verrez au dehors » (Imitation, Livre II, chapitre 5). Dans une ultime charge contre les pratiques de mortification, le trio tente de réconcilier le plaisir du corps et celui de l’âme. Dans ce passage aux accents charmeurs, Stradella emprunte à nouveau au madrigal son écriture généreuse, souple et chatoyante. Mais la séduction n’emporte pas la partie. Au contraire, elle conduit Edith à adopter un ton accusateur. Elle s’en prend successivement à tous les avantages matériels associés à la fonction royale pour tenter de démasquer leurs méfaits. A chacun, elle assène un farouche : Dite su, che siete (Dites-moi, qui êtes-vous) ? Dans une suite de duos habités par un feint repentir, Nobilità, Grandezza et Senso confessent leur crime : vi tradimo e ci credete (nous vous trahissons et vous nous croyez). Repentirs dont le manque de sincérité est cependant dénoncé par la mise en musique de Stradella. Car c’est dans un aria enjoué que Grandezza ensevelit l’orgueil des rois dans le feretro de’ potenti (catafalque des puissants). Tout aussi fanfaron, Senso s’amuse de ceux qui, à l’appel de leurs sens, s’endorment contenti entro del mare (dans la mer des bonheurs) et se réveillent in mar di pianto (dans un océan de larmes). En l’occurrence, le musicien ne reformulerait-il pas le texte dans un langage musical qui parle de sa propre expérience de vie dissolue ?
Atteints mais non éteints, Senso et Nobilità insistent. Dans un récitatif que Michele Mignone carmine de coloris finement réalistes, Senso la pousse dans ses retranchements : tu préfères donc une vie misérable dans une cella romita (cellule solitaire) au palais royal ? Puis, plus subtilement, il invoque un exemple biblique : David a-t-il refusé le trône lorsque Dieu le lui a désigné ? A l’interpellation de Nobilità, Edith apporte une réponse contradictoire. Celle de Marie Béatrice d’Este qui accepte : quando il gran Diol lo scettro e i regni dona, non si dee rifiutar regia corona (quand notre grand Dieu offre sceptre et royaume, on ne doit point refuser une royale couronne). Mais aussi celle d’Edith de Wilton qu’une voci interne al core (voix intérieure) dissuade d’accéder au pouvoir. Une contradiction que le texte ne résout pas dans le duo entre Edith et Nobilità. En revanche, la musique l’éclaire d’une lumière radieuse. Comme si Stradella tenait à célébrer cette liberté individuelle de choix que l’humaniste Orsini ne faisait que suggérer. En somme, Edith et Marie Béatrice ont toutes deux leurs raisons. Une fois encore, le musicien n’est plus l’otage du texte, comme aux débuts de la musique vocale baroque, mais s’affirme comme l’égal du librettiste et coproducteur de l’œuvre dans sa globalité.
Le discours musical parvient maintenant au stade de la Péroraison. Cette ultime étape où l’orateur expose « tout ce qui sert à conclure lorsqu’on a prouvé ce qu’on voulait établir » (Balthasar Gibert). Une conclusion qui nous semble bifurquer vers deux catégories de public bien distinctes. Ceux qui ont pris la moniale de Wilton pour modèle trouveront dans sa profession de foi finale des raisons de persévérer. Les autres goûteront la version plus profane qui a forgé le destin de la princesse de Modène.
Dans un récitatif suivi d’un aria, Edith l’affirme : le renoncement au monde (le récitatif) la conduira vers la béatitude (l’aria). L’intensité dramatique du récitatif est le produit d’un texte militant auquel la musique donne une allure combattante. Particulièrement cette marche harmonique qui, en gravissant les degrés, voit progressivement Edith se séparer de son entourage pour abandonner le monde. Laura Andreini habite manifestement la partition tant elle libère la passion que Stradella a fait entrer dans ses notes. Autant le récitatif fait vibrer, autant l’aria baigne l’auditeur dans un climat de paix et de quiétude. Elle sait désormais qu’elle peut tout, si Dieu le veut. Certes, Belezza l’incite à prendre le temps de la réflexion. Mais sa détermination est totale : piovon celesti grazie all’alma, allora che obbedisce il suo Dio senza dimora (l’âme reçoit des pluies de grâce alors qu’il obéit à son Dieu sans hésiter). Emportée par un aria éblouissant, débarrassée des servitudes terrestres, elle s’élance sur le chemin qui la conduira vers le veri contenti (vrai bonheur). Préfigurant cet état de grâce, la ligne mélodique est enrichie de plaisantes vocalises. Edith est bienheureuse. Et c’est à Grandezza qu’il revient de prononcer l’éloge funèbre de ce saint personnage. Sur le ton attentionné de la vénération, Sylvain Manet caresse délicatement ce beau texte poétique.
La version laïque de la péroraison est à la fois plus concentrée et plus enjouée. Dans cette conclusion en forme de madrigal, Nobilità, Grandezza et Bellezza tracent une autre voie qui assure néanmoins une eterna pace (paix éternelle). Pour cela, nul besoin de souffrir. D’ailleurs, nos peines ne sont-elles pas fugaces lorsqu’elles s’évanouissent à l’image de la nuit chassée par le jour ? Cet hymne à l’espoir est porté par trois voix qui s’enlacent, se poursuivent sur le mode de l’imitation mais se retrouvent toujours dans un unisson pour scander les messages que devra retenir l’auditoire. Jusqu’à cette marche harmonique qui laisse derrière elle les pleurs et les douleurs pour gravir le chemin lumineux qui conduit à la degna mercè (digne récompense). Une conclusion qu’Humilità conteste en assénant une déclamation qui prétend trancher le débat tout en sonnant la fin de l’oratorio : chi semina i dolor miete i contenti (qui sème la douleur, récolte le bonheur).
Finalement, ce texte austère (et parfois confus), sublimé par une musique fleurie et expressive, mérite mieux qu’une écoute passive. Car, sur le mode d’un discours rhétorique à l’ancienne, cette œuvre soulève un débat de société qui fait écho aux conversations de salon de la société aristocratique du XVIIème siècle italien. Quelle est la meilleure manière de servir Dieu et d’assurer son salut : la claustration et la mortification (comme Edith) ou l’exercice de la fonction sociale à laquelle destine sa naissance (comme la princesse de Modène)? Le librettiste alimente le débat par une profusion de références extraites des livres de dévotion (essentiellement l’Imitation de Jésus-Christ, selon nous) mais en tempère le caractère totalitaire par une touche d’humanisme. Humanisme que le musicien entérine en modérant le caractère rigoriste de certains passages et en exaltant les passages relatifs à la liberté individuelle.
Deux ensembles talentueux livrent leur lecture de cette œuvre : Mare Nostrum et Il Groviglio. Le premier se distingue par un corps instrumental plus fourni et une plus grande maturité des interprètes. Le second charme par la fraîcheur et la simplicité de son exécution. Mieux que le premier, il réverbère ces sonorités intimes que l’on pouvait entendre dans les salons des particuliers. Nos jeunes talents donnent chair et sang aux passions, explorent les mécanismes de l’extase et entraînent l’auditeur dans une longue, et souvent plaisante, réflexion sur le sens à donner à sa vie. Un oratorio qui, au demeurant, entre en communion avec les intentions du concepteur de ce genre musical, Philippe de Neri (1515-1595) : « C’est le désir du Saint que ses pères, unis aux fidèles, se servissent de mélodies variées d’une musique harmonieuse, pour s’exciter au goût des choses célestes et s’élever à la contemplation » (règle de l’Oratoire in L’esprit de saint Philippe de Néri, fondateur de l’Oratoire romain, 1900). Tout en nous faisant applaudir les qualités d’écriture d’Alessandro Stradella et les talents des interprètes, Il Groviglio parvient à nous mettre en relation avec l’esprit de ce genre musical et sa fonction sociale. Il nous baigne ainsi dans l’illusion d’entendre des sons échappés du passé.
Publié le 14 juin 2021 par Michel Boesch
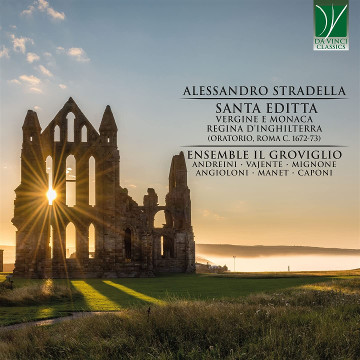 ©
© 

