Scylla et Glaucus - Leclair
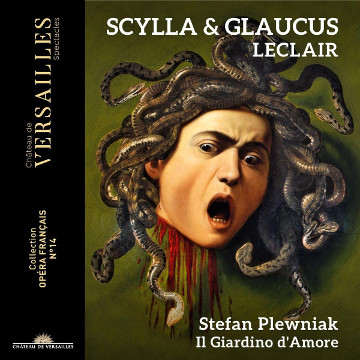 © Le Caravage : Medusa (Méduse), 1597
© Le Caravage : Medusa (Méduse), 1597 Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notices trilingues (français-anglais-allemand) de Julien Dubruque, 3 CD, durée totale : 162 minutes, 49 secondes. Château de Versailles Spectacles -
Compositeurs
- Scylla et Glaucus
- Tragédie lyrique en un prologue et cinq actes de Jean-Marie Leclair (1697-1764), sur un livret d’Albaret
- Créée à l’Académie royale de musique, Paris, le 4 octobre 1746
Chanteurs/Interprètes
- Mathias Vidal (Glaucus)
- Chiara Skerath (Scylla)
- Florie Valiquette (Circé)
- Victor Sicard (Le Chef des peuples/ Licas/ Hécate/ un Sylvain)
- Cécile Achille (Vénus/ Dorine/ Propétide/ une Dryade/ Fille du Chœur 2)
- Lili Aymonino (l’Amour/ Témire/ une Sicilienne/ Propétide/ une Bergère/ Fille du Chœur 1)
- Chœur :
- Sopranos : Sylvia Stępień, Katarzyna Bienias, Ewa Kuryłowicz, Marta Czarkowska
- Altos : Ewa Puchalska, Ewelina Rzezińska, Kinga Głogowska
- Ténors : Aleksander Rewiński, Andrzej Marusiak, Aleksander Słojewski, Andrzej Borzym
- Basses : Krzysztof Matuszak, Krzysztof Chalimoniuk, Piotr Pieron
- Orchestre Il Giardino d’Amore :
- Violons : Ludmiła Piestrak, Natalia Moszumańska, Reynier Guerrero Álvarez, Juliusz Żurawski, Joanna Gręziak, Nœmi Kuśnierz
- Altos : Magdalena Chmielowiec-Kozioł, Wojciech Witek
- Violoncelles : Katarzyna Cichoń, Thibaut Reznicek
- Contrebasse : Łukasz Madej
- Clavecins : Ronan Khalil, Ewa Mrowca- Kościukiewicz
- Théorbe : Etienne Galletier
- Flûtes : Julie Huguet, Ewa Gubiec
- Hautbois : Agnieszka Mazur, Jan Hutek
- Basson : Leszek Wachnik
- Trompettes : Lubomir Jarosz, Jacek Jurkowski
- Percussions : Wojciech Lubertowicz
- Musette : Vincent Robin
- Violon et direction : Stefan Plewniak
Pistes
- 1.CD 1 : Ouverture
- 2.Prologue - Scène 1 - « Reine de la Nature », Chœur des peuples d’Amathonte, Chef des peuples
- 3.Sarabande
- 4.Air gracieux
- 5.« Quel bruit soudain », le Chef des peuples
- 6.Scène 2 – « Redoutable Vénus », le Chef des peuples, Propétide 1, Propétide 2
- 7.Bruit de tonnerre
- 8.Scène 2 & 3 – Symphonie pour la descente de Vénus
- 9.Scène 3 – « Pour vous dont je reçois », Vénus, le Chef des peuples
- 10.« Des nations il triomphe », le Chef des peuples
- 11.« Dans un auguste fils », l’Amour
- 12.« Que, digne fils », Vénus, l’Amour, le Chef des peuples
- 13.Gigue
- 14.« Venez, qu’Amour vous couronne », l’Amour
- 15.Passepied
- 16.« Votre zèle pour moi », Vénus
- 17.Ouverture
- 18.Acte I - Scène 1 – « Non, je ne cesserai jamais », Scylla
- 19.Scène 2 – « Que votre empressement », Témire, Scylla
- 20.« Nos Bergers, nos Sylvains », Scylla
- 21.Scène 3 – Marche des Bergers et des Sylvains
- 22.« Aimez, Nymphe charmante », Chœur de Bergers et de Sylvains
- 23.« Une beauté sévère », un Berger, un Sylvain
- 24.Air des Sylvains
- 25.Musette
- 26.« Loin de nos retraites », une Bergère, Chœur de Bergers
- 27.Premier Menuet
- 28.« Nos bois savent faire », une Dryade, un Sylvain, Dryades et Sylvains
- 29.Deuxième Menuet
- 30.« Chantons », Chœur de Bergers et de Sylvains
- 31.Scène 3 & 4 – « Perdez une vaine espérance », Scylla, Témire
- 32.Scène 5 – « Nymphe, tout sur ces bords », Glaucus
- 33.« L’Amour n’offre », Scylla
- 34.« Croirai-je que les chants », Glaucus, Scylla
- 35.« Quand je ne vous vois pas », Glaucus, Scylla
- 36.Scène 6 – « Ne faut-il », Glaucus
- 37.Air des Sylvains
- 38.CD 2 - Acte II - Scène 1 - « Oui, je dois craindre encore », Circé, Dorine
- 39.Air « Mon cœur est fait pour s’enflammer », Circé
- 40.« Apprends ce qu’aujourd’hui », Circé
- 41.« Vous voyez le danger », Circé, Dorine
- 42.Scène 2 – « Fille du dieu brillant », Glaucus, Circé
- 43.« Vous pouvez d’un seul mot », Glaucus
- 44.« Circé, sensible à vos alarmes », Circé
- 45.« Aux champs siciliens », Glaucus, Circé
- 46.Scène 3 – « Ministres de mon art », Circé
- 47.Passacaille « Amants dont le prix », Coryphée 1, Coryphée 2, Chœur
- 48.« Quel espoir séduisant », Glaucus, Circé
- 49.Scène 4 – Prélude « Quelle secrète puissance », Licas, Glaucus
- 50.Scène 5 – « Il me fuit hélas », Circé
- 51.« Courons à la vengeance », Circé, Ministres de Circé
- 52.Entracte
- 53.Acte III - Scène 1 : Symphonie
- 54.« Témire, l’inconstant », Circé, Témire
- 55.« On se rend plus tôt », Témire
- 56.« Glaucus n’aurait-il », Témire, Circé
- 57.Scène 2 – « Me fuirez-vous encore », Glaucus, Scylla
- 58.« Mais pourquoi », Glaucus
- 59.« Pourquoi vous obstiner », Scylla, Glaucus
- 60.Duo « Que le tendre amour nous engage », Scylla, Glaucus
- 61.Scène 3 – « Chante Scylla », Chœur
- 62.« Chantons, Scylla, chantons », Chœur
- 63.Loure
- 64.Premier Air en Rondeau
- 65.Deuxième Air en Rondeau
- 66.« Jeunes cœurs », Fille du Chœur
- 67.Deuxième Air en Rondeau
- 68.Premier Air en Rondeau
- 69.« Ta gloire dans ces lieux », Scylla
- 70.« Mais que vois-je », Scylla, Chœur
- 71.« Juste ciel ! », Glaucus, Scylla
- 72.Scène 4 – « Tout fuit, tout disparaît », Circé
- 73.CD 3 - Acte IV - Scène 1 : Symphonie
- 74.« Glaucus, par tout l’amour », Circé, Glaucus
- 75.« Ne te souvient-il plus », Circé
- 76.« Trompé par vos enchantements », Circé, Glaucus
- 77.Scène 2 – « Où courez-vous Glaucus ? », Scylla, Circé, Glaucus
- 78.Scène 3 – « Ah ! C’est trop conserver », Circé, Dorine
- 79.« Ah ! Que la vengeance a de charmes », Circé, Dorine
- 80.Scène 3 & 4 – « Mais déjà de ses voiles sombres », Circé
- 81.Scène 4 – « Noires divinités », Circé
- 82.Scène 5 – « Que Circé nous inspire », Chœur des Divinités Infernales
- 83.Premier Air de Démons
- 84.« Brillante fille de Latone », Circé
- 85.Deuxième Air de Démons
- 86.« Brillante fille de Latone », Chœur
- 87.« Du flambeau de la nuit », Circé, Chœur
- 88.Troisième Air de Démons
- 89.Scènes 5 & 6 – « La terre s’ouvre », Circé, Hécate
- 90.Troisième Air de Démons
- 91.Acte V - Scène 1 – « Rien ne s’oppose plus », Glaucus
- 92.« C’est votre fidélité », Scylla, Glaucus
- 93.« Mais la fête va commencer », Glaucus
- 94.Scène 2 – « Chantons, bénissons », Chœur
- 95.Premier Air de Ballet
- 96.« Peuples de ces climats heureux », Glaucus
- 97.« Chantez, chantez l’Amour », Glaucus
- 98.« Chantons, chantons l’Amour », Chœur
- 99.Deuxième Air de Ballet
- 100.« Viens, Amour, quitte Cythère », une Sicilienne, Chœur
- 101.Troisième Air (majeur), Quatrième Air (mineur)
- 102.« C’est au bord de cette fontaine », Glaucus, Scylla
- 103.« Quel bonheur », Glaucus, Circé
- 104.Symphonie « Voilà cette nymphe », Circé, Glaucus
Dans le sillage de Lully et RameauComme son illustre devancier Rameau, c’est à presque cinquante ans que Jean-Marie Leclair se décide à conquérir l’Académie royale de musique avec cette tragédie en musique, Scylla et Glaucus, qui constitue son premier - et hélas dernier - essai dans ce genre comme nous l’indique le compositeur dans sa dédicace à la comtesse de La Mark. Il est alors essentiellement reconnu pour ses œuvres instrumentales (concertos et sonates) dans lesquelles il fait montre d’une maîtrise technique violonistique éblouissante et d’une rare élégance d’écriture. On ne lui connaît guère de pages vocales, ni dans les genres du grand ou du petit motets pas plus que dans celui, souvent préparatoire aux œuvres scéniques d’envergure, de la cantate. Pourtant, il frappe très fort avec ce qui constitue l’une des meilleures partitions lyriques du XVIIIe siècle français. Il sait répondre aux canons académiques : un somptueux prologue, hommage subtil au monarque, qui annonce néanmoins la tragédie, cinq actes avec des divertissements variés de couleurs pastorales ou infernales et un dénouement tragique, tranchant avec le modèle ramiste d’alors privilégiant une fin heureuse, renouant ainsi avec l’esprit du fondateur toujours aussi révéré plusieurs décennies après sa mort, Lully.
La partition frappe par la richesse de son écriture, notamment sur le plan instrumental où le violoniste virtuose confie aux pupitres de son instrument des parties redoutablement exigeantes. La grandiose Ouverture offre d’emblée des gammes fusées (Circé semble s’y profiler) et des motifs tourmentés aux harmonies troublées pour se lancer ensuite, dans son second volet, dans une course effrénée (Scylla et Glaucus poursuivis par la magicienne ?) où le contrepoint se trouve magnifié par de splendides effets : triples cordes, arpègements, marches harmoniques… Plus loin, le Bruit de tonnerre fait songer à la page éponyme d’Hippolyte et Aricie, de même tonalité et aux figurations très proches. La symphonie pour la descente de Vénus joue sur les variations de texture qu’offrent les dialogues entre trompettes, timbales et cordes dont le triomphal Passepied se fait l’écho par la suite.
Les danses sont la plupart du temps magnifiquement caractérisées : l’Air pour les Sylvains par ses immenses enjambées fait immanquablement penser à Rameau et contraste singulièrement avec le charme ineffable de la Musette qui lui succède. Les menuets par leurs effets d’écho font songer à Lully. La Passacaille du deuxième acte est un modèle se sensualité, renouvelant sans cesse ses éclairages, oscillant entre la majeur (tonalité de l’ouverture) et la mineur (passage central). Au troisième acte, les deux airs en rondeau dissimulent deux gavottes d’une grâce, tantôt langoureuse (celui en mi mineur), tantôt délicieusement aérienne (celui en mi majeur illuminé par les flûtes). Le quatrième acte s’ouvre sur un Prélude très développé en si mineur, à l’écriture recherchée. Mais c’est sans doute le divertissement infernal qui frappe le plus par la virtuosité de ses airs de démons en mi bémol majeur d’une violence dont Rameau se souviendra pour Zoroastre trois ans plus tard… (voir mon compte-rendu). Si le mouvement de forlane du cinquième acte semble renouer avec Campra, ses gammes fusées comme ses tourments harmoniques font en revanche penser encore au Bourguignon auquel le Lyonnais rend bien souvent hommage. Mais rien ne laisse présager l’effroyable symphonie finale – « pour exprimer les aboiements des monstres qui environnent Scylla et des gouffres » -, d’une écriture véritablement délirante et d’une réelle difficulté. Le compositeur précise d’ailleurs sur la partition : « Du mouvement que permettra l’exécution ». Gammes fusées ascendantes et descendantes, doubles et triples cordes, arpèges en triples croches : tout concourt à offrir un tableau d’épouvante pour conclure en feu d’artifice instrumental la tragédie dont la fin est assez abrupte (à l’instar de celle du Phaëton de Lully).
Stefan Plewniak, violoniste virtuose, insuffle à son Giardino d’Amore une énergie de chaque instant, magnifiant, malgré des effectifs assez modestes, la richesse de la palette orchestrale de Leclair. De la première à l’ultime page, il est difficile de ne pas s’émerveiller devant une telle maîtrise dans la mise en place des traits les plus délicats, qui plus est, à des tempi souvent très alertes et avec une puissance de son très impressionnante. Si les cordes sont, évidemment, tout particulièrement à l’honneur, les vents ne sont pas en reste et brillent eux aussi par la chaleur et l’éclat de leurs timbres (quelles trompettes, notamment !).
Au plan vocal, la maîtrise de Leclair laisse pantois. Ses chœurs font regretter qu’il n’ait laissé aucun grand motet. Certaines pages y font penser au vu de l’ampleur de l’édifice choral élaboré. Avec plus de quatre-vingts mesures le Chantons, bénissons à jamais de l’acte V éblouit particulièrement. Leclair, dont bon nombre de mouvements de sonates témoignent d’un contrepoint châtié, voit ici les choses en grand. Au troisième acte, le Chantons Scylla est animé d’une grâce virevoltante, augmentée par les innombrables guirlandes de triolets des premiers violons tandis que les seconds doublent la partie des dessus (particularité de l’écriture de Leclair). Les chœurs de démons, à l’acte IV, ne cèdent en rien à ceux de Castor et Pollux. Reprenant la texture à trois voix d’hommes typique de ce genre de page, ceux-ci exhalent une rage irrépressible (Que Circé nous inspire et Brillante fille de Latone) défendue ici avec superbe, tout comme le Circé, courez à la vengeance réunissant la totalité du chœur et traversé d’une fièvre contagieuse.
Globalement, malgré un français encore perfectible, le Chœur s’avère très convaincant, qu’il s’agisse des pages monumentales ou de celles parodiant des danses. Retenons ainsi la délicieuse musette Loin de nos retraites, où dialoguent une bergère et un chœur de bergers, ou l’irrésistible menuet en écho Nos bois savent taire, où Dryades et Sylvains transmettent une allégresse particulièrement jubilatoire. Mais la palme du charme est difficile à décerner : comment ne pas balancer en effet entre la grâce enjôleuse de la Passacaille, qui, malgré son tempo particulièrement allant (plus chaconne que passacaille !) prodigue ses charmes avec insolence et l’inoubliable Sicilienne du dernier acte (Viens Amour, quitte Cythère). On ne sait ce qu’il faut le plus admirer : la beauté mélodique immédiate ou le raffinement de l’écriture de l’accompagnement, débutant sur des pizzicati des cordes pour évoluer vers des arpèges aux valeurs de plus en plus courtes procurant une sensation apaisante de scintillement. Le passage central, au relatif, se pare d’une mélancolie fort touchante, limitant le chœur aux seules voix de femmes. Malgré un tempo plus allant - qui ne signifie pas précipitation - que dans d’autres versions, on se laisse séduire sans la moindre résistance.
Les rôles secondaires sont globalement bien défendus, donnant vie à de nombreux personnages apparaissant la plupart du temps de façon assez brève dans les divertissements ou comme faire-valoir des rôles principaux. Tous témoignent d’un métier solide autant dans les récitatifs que les petits airs ou danses parodiées comme nous l’avons souligné plus haut. Parmi les quatre rôles endossés par Victor Sicard, retenons surtout une terrifiante Hécate dont le récitatif Pour toi seule par deux fois j’ai passé l’Achéron, secoué des tremblements de la basse continue. Pour Cécile Achille et Lili Aymonino, les contributions sont également démultipliées mais c’est essentiellement en Filles du chœur qu’elles nous ensorcellent dans la somptueuse Passacaille déjà mentionnée, leurs voix se mariant à merveille, ou encore comme bergère (la Musette) et Sicilienne pour la deuxième par son timbre lumineux et ses accents particulièrement gracieux.
La Scylla de Chiara Skerath sait illustrer l’évolution de son personnage qui se refuse tout d’abord à l’amour avant de se rendre aux avances de Glaucus. Leclair lui a réservé de beaux monologues. C’est tout d’abord le raffiné Non je ne cesserai jamais introduit par une riche texture orchestrale qui s’allège lorsque la voix entre, les violons servant de basse et les flûtes offrant un délicieux contre-chant à la tierce supérieure. Le deuxième, d’un ton grave (en sol mineur) mobilise un accompagnement fourni et des intervalles expressifs (Serments trompeurs), dont l’impression se renforce au retour de la première partie grâce à une transition traversée d’un saisissant mouvement chromatique ascendant parallèle entre les dessus et la basse. La voix est belle et le ton noble. Mais elle sait aussi vocaliser avec délicatesse dans le grand air Ta gloire dans ces lieux t’appelle où les mots gloire, vole se parent de guirlandes de triples croches parfaitement ciselées ici.
Si certains de ses aigus apparaissent un peu tendus, Mathias Vidal, tout à fait chez lui dans ce répertoire, campe un Glaucus convaincant, même si Leclair sert finalement assez peu son rôle. Il lui réserve néanmoins quelques belles pages comme cet impressionnant récitatif accompagné Vous pouvez d’un seul mot par vos enchantements, notamment lorsque sur le mot terrible, souligné par un accord de septième diminuée, la voix s’élance avec puissance pour obtenir l’aide de Circé. Relevons également l’air Mais pourquoi des serments emprunter le langage, marqué par un entêtant accompagnement de triolets de doubles croches des violons. La voix se fait solaire dans l’air festif Chantez Scylla, tout émaillé de traits décoratifs des violons (traduction sonore du style rocaille) ou beaucoup plus intime dans cet étonnant air avec basson obligé Si l’amour voit languir. Cédant au goût du public d’alors, Leclair offre également à Glaucus une ariette Chantez, chantez l’amour, dont Rameau a offert maints exemples dans ses actes de ballet notamment et permettant à Mathias Vidal de briller une dernière fois avant le terrible dénouement.
Mais ces deux protagonistes sont finalement éclipsés par la figure dévorante de Circé, sorte d’hybride entre Armide et Médée, incarnée ici par une Florie Valiquette qui s’amuse manifestement beaucoup à incarner cette vraie méchante à qui est consacré sans doute l’un des meilleurs rôles de tout le XVIIIe siècle en ce qui concerne la tragédie en musique. Certes, on se serait passé volontiers de quelques ricanements sardoniques au cinquième acte mais ce n’est là qu’un détail tant Florie Valiquette se révèle à la hauteur des énormes exigences de ce rôle, assurément choyé par le compositeur. Il lui offre en effet ses pages les plus inspirées : récits accompagnés grandioses, monologues, airs avec chœur, pour étoffer le profil psychologique complexe de cette magicienne aux pouvoirs infinis. Dès son entrée au deuxième acte, après un magnifique prélude, le ton est donné : Oui, je dois craindre encore les amoureuses peines, qui trouve un écho quelques pages plus loin dans Apprends ce qu’aujourd’hui mon art m’a fait connaître. Délicate dans Circé sensible à vos alarmes, autoritaire dans Ministres de mon art, désespérée dans Il me fuit, hélas, la voilà vindicative (Mais pourquoi redoubler mes peines), pour s’élancer dans une course frénétique Courons à la vengeance, où la voix vocalise avec grande aisance et galvanise le chœur lui emboîtant le pas pour achever le deuxième acte avec brio. La fin de l’acte III s’établit sur un immense monologue Tout fuit, tout disparaît, où le talent de tragédienne de Florie Valiquette fait encore merveille, servant superbement tous les épisodes de ce récitatif accompagné. Le quatrième acte nous révèle sa veine démoniaque par un fascinant Noires divinités de la rive infernale, encore assombri par cet accompagnement disloqué des violons sur Que Circé vous inspire une fureur nouvelle et trouvant son paroxysme dans l’invocation à Hécate Déesse redoutable, aux terribles harmonies. Enfin, non sans sadisme, elle jubile de la mort de sa rivale et du désespoir de Glaucus sur un simple récitatif sur les paroles suivantes :
Que ce rocher monument de ma rage, près de ce gouffre dangereux,
Soit un écueil encor mille fois plus affreux :
Et qu’offrant à jamais un funeste assemblage pour le malheur de l’univers,
Et Charybde et Scylla, soient la terreur des mers.
En 1986, Sir John Eliot Gardiner nous révélait cette partition splendide dans une version - à l’instar de ses Boréades - devenue mythique. Outre ses English Baroques Solists et son fabuleux Monteverdi Choir, il avait réuni une distribution de rêve : la belle Donna Brown y incarnait Scylla, Howard Crook illuminait le personnage de Glaucus et les petits rôles réunissaient Agnès Mellon, René Schirrer, Elisabeth Vidal, Catherine Dubosc ou encore Françoise Golfier, tous excellents. Mais surtout, l’incroyable Circé de Rachel Yakar dominait ce plateau par une intelligence du rôle admirable et une voix alors à son zénith. Bien plus proche de nous (2015), la version de Sébastien d’Hérin et ses Nouveaux Caractères ne manquait pas d’atouts (voir le compte-rendu de mon confrère dans ces colonnes), notamment sur le plan orchestral, sans nous convaincre tout à fait au plan vocal par une distribution un peu inégale. Tel un météore, l’opus signé par Stefan Plewniak, proposé dans le cadre de la richissime collection Château de Versailles Spectacles, renouvelle encore l’approche de cette partition magistrale qui mérite bien plusieurs enregistrements. Sans se placer tout à fait au même niveau que la version de Gardiner pour laquelle nous conservons une légère préférence, elle vient talonner néanmoins celle-ci par les évidentes affinités d’un chef violoniste et de son flamboyant Giardino d’Amore avec la musique splendide de Leclair. On aurait bien tort de la négliger.
Publié le 07 mars 2023 par Stefan Wandriesse
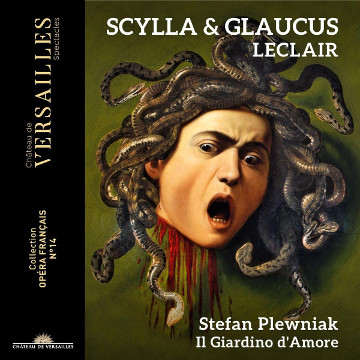 © Le Caravage : Medusa (Méduse), 1597
© Le Caravage : Medusa (Méduse), 1597