 ©
© Auteurs
- Véronique Lochert :
- Les femmes aussi vont au théâtre/ Les spectatrices dans l’Europe de la première modernité
- 376 pages
Édition
- Presses Universitaires de Rennes - 2023
 ©
© Spectatrices d’aujourd’hui, combien et qui étiez-vous, vous qui fréquentiez les lieux de spectacle public aux siècles d’Isabelle d’Este, de Margaret Cavendish, duchesse de Newcastle Upon Tyne, d’Elizabeth Pepys ou de notre marquise de Sévigné : Marie de Rabutin-Chantal ? Spectatrices parmi les spectateurs, quelles places occupiez-vous dans le public et sur scène ? Comment les organisateurs, les auteurs et les interprètes vous considéraient-ils ? Quelles représentations inspiriez-vous ? Que vous ayez été mécènes, propriétaires de salles, femmes dramaturges ou artistes, ouvreuses, costumières ou simples spectatrices « consommatrices du divertissement théâtral », quelles parts avez-vous prises dans l’événement théâtral et les innovations touchant la production dramatique ?
Pour tenter de répondre à ces questions, et à bien d’autres, Véronique Lochert, maîtresse de conférences en littérature comparée à l’Université de Haute-Alsace et experte du théâtre des XVIème et XVIIème siècles européens, a interrogé vos écrits (œuvres dramatiques et leurs paratextes, correspondances, mémoires…). Elle livre ici le fruit de vos entretiens. Une restitution qu’elle croise avec les travaux qu’elle a déjà publié sous son nom ou auxquels elle a contribué. L’ensemble formant un magistral point d’étape de l’étude du « rôle culturel des femmes » dans l’activité théâtrale européenne durant la première modernité (de la fin de la Renaissance à la veille du Siècle des Lumières).
Ces données collectées dans quatre pays (Italie, Espagne, France, Angleterre… mais pas (encore ?) le monde germanique) sont passées au crible d’études transversales rigoureuses pour faire « apparaître le rôle moteur de la différence sexuelle dans les pratiques théâtrales » (mais si peu (encore ?) celui de l’opéra). Ses investigations franchiront cinq étapes successives. A chacune d’elles correspond l’un des cinq chapitres de sa publication.
Posant les fondements, l’ouvrage s’ouvre sur une photographie d’ensemble de « la réalité des pratiques spectatoriales féminines ». Les trois sections suivantes interprètent les représentations des spectatrices telles que les révèlent trois types de sources. D’abord, les paratextes dramatiques (prologues, épilogues, dédicaces, préfaces, didascalies, arguments ou autorisations de publication). Ils renseignent sur « la manière dont l’œuvre théâtrale est adressée à une destinataire féminine qui se trouve par là même décrite, imaginée et intégrée au texte ». Ensuite, les productions littéraires (particulièrement celles des théâtrophobes) échangées dans le tourbillon de la controverse européenne sur la fréquentation des théâtres par les femmes. Elles permettent de déchiffrer « les enjeux sociaux de l’activité théâtrale qui met directement en question les rapports de genre ». Enfin, l’analyse des « représentations du public féminin… (qu’incarnent) les personnages de spectatrices imaginés par les dramaturges ». Une belle opportunité pour explorer les prémices d’une « reconnaissance de l’activité critique des spectatrices ». L’ultime chapitre recueille les témoignages de « quatre figures singulières – grandes dames de l’aristocratie, écrivaines, mais aussi bourgeoise discrète ». Des visages de spectatrices indépendantes et résolues, antithèses de la spectatrice ingénue, docile, sujette à l’hypersensibilité.
Tel quel, son programme aurait suffi à séduire un lecteur curieux d’histoire pluridisciplinaire. Pourtant, Véronique Lochert prolonge son enquête, déterminée à identifier les forces qui travaillent en profondeur la société au moment où les femmes s’invitent au théâtre. Soutenue par le « procès de civilisation » (Norbert Elias – 1897-1990) qui « entraîne une « féminisation » de la société autour des valeurs de la courtoisie, de l’humanisme et de la sensibilité », la femme investit peu à peu ce lieu culturel initialement sous domination masculine. Autrices, actrices, spectatrices « deviennent un objet d’attention et de discours ». Discours qui, se convertissant ici en objets d’étude, ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de recherche.
Dès l’Introduction, Véronique Lochert jalonne l’itinéraire de son projet d’écriture. Traçons, à très gros traits, sa trajectoire. Elle interroge d’abord la nature des transformations socioculturelles qui s’enclenchent au moment où la femme s’introduit dans l’univers théâtral. La différenciation sexuelle soulève la question d’un « genre féminin ». Un concept qui se construit, puis imprègne un univers réglé par des « rapports sociaux fondé(s) sur une différence des sexes où l’homme a toujours été la norme » (depuis l’embryogenèse d’Aristote). Ainsi, au moment où « auteurs et acteurs se montrent… de plus en plus sensibles à la nécessité de satisfaire différentes catégories de spectateurs », le théâtre se saisit du rôle moteur de la différenciation sexuelle pour exploiter le filon de « l’érotisation des rapports entre acteurs et spectateurs et (afficher) l’importance des jeux de séduction internes au public ». En établissant un « lien étroit qui unit symboliquement l’art dramatique et les catégories du féminin », « l’instance féminine » participe à la théorisation de la pratique théâtrale, « proposant un modèle pour penser de nouveaux modes de réception ». Par effet de contagion, le théâtre finit par prendre part aux « débats sur le statut des femmes et sur la fabrication du genre ». Débats qui ont traversé les siècles et se poursuivent aujourd’hui.
Au fil de notre lecture, nous signalerons à notre lecteur les données qui nous paraissent remarquables (thèmes, argumentaires, informations). Il les approfondira lorsqu’il consultera lui-même cet ouvrage de 375 pages d’une écriture fluide et magistralement documenté (ample bibliographie et index nominum compris).
Contrairement à l’ouvrage La voix du public en France aux XVIIème et XVIIIème siècles (sous la direction de Sarah Nancy et Julia Gros de Gasquet, PUR, 2019 (voir notre chronique), celui que propose Véronique Lochert ne contient aucune iconographie. Aussi, avons-nous pris l’initiative de condenser, en quelques images, les enseignements majeurs que délivre l’autrice.
Chapitre I – « También van a la comedia las mujeres ». Conditions matérielles et pratiques sociales
Moins de trois pages suffisent à Véronique Lochert pour convaincre le lecteur que « la spectatrice n’est pas un spectateur comme les autres ». « D’objet regardé » dans un espace placé d’abord « sous le contrôle des hommes », elle parvient, au fil du temps, à « devenir sujet du regard et de faire entendre (sa) voix ». Pour identifier les ressorts et les mécanismes à l’œuvre dans cette mutation, l’autrice propose de se concentrer d’abord sur les « enjeux spatiaux du théâtre ». Non sans un avertissement préalable sur la rigueur nécessaire pour interpréter les textes, beaucoup d’entre eux étant de parti pris (moralisateurs, misogynes ou théâtrophobes).
Après avoir observé la diversité sociale que recouvre le vocable « spectatrice », Véronique Lochert examine chacun des espaces que traverse la spectatrice, de son domicile à l’après-spectacle.
Peu de traces autorisent une véritable étude quantitative de la composante féminine du public. Tout juste peut-on estimer que les femmes s’y taillent une part croissante dans le courant du XVIIème siècle. Une approche plus qualitative éclaire davantage la diversité des statuts sociaux qui se massent à l’entrée des salles. Diversité de classes (des représentantes de la haute aristocratie aux femmes de condition modeste). Multiplicité des fonctions sociales (de la reine à la marchande). Large palette de « métiers » exercés un soir de spectacle : actrices, ouvreuses, « distributrices de liqueurs et de confitures » en Italie, vendeuses d’oranges en Angleterre. Sans compter les activités collatérales pratiquées par une pléiade d’entremetteuses ou de courtisanes. Celles-ci étant probablement les premières à s’insinuer dans ces lieux de divertissement masculins que sont les salles closes des théâtres.
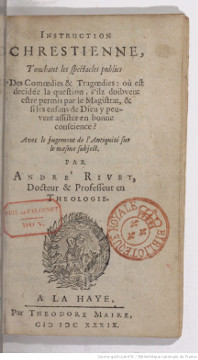
André Rivet (1573 ?-1651) - Instructions chrétiennes touchant les spectacles publics, 1639 - Gallica, BnF
« Il est plus difficile d’aller au théâtre quand on est une femme ». D’abord, en raison de la distribution des rôles sociaux et des servitudes domestiques. Par ailleurs, dans une société caractérisée par ses structures patriarcales, le contrôle social contraint les femmes à limiter leurs déplacements dans l’espace public. Contraintes qu’il convient de nuancer car elles fluctuent selon le statut matrimonial (jeunes filles mises à l’abri des galants et protégées des effets nocifs du spectacle), la classe sociale (elles pèsent moins lourdement dans l’aristocratie) ou le pays (la France et l’Angleterre sont plus libérales que l’Italie et surtout l’Espagne). Mais partout, « aller au théâtre représente pour les femmes une activité sociale… qui leur permet de franchir la limite de plus en plus marquée entre l’espace privé et l’espace public ».
« Les femmes se rendent rarement seules au théâtre ». Car l’accès à la salle de spectacle suppose de traverser trois cercles à l’intérieur desquels la sécurité, l’ordre et le confort peuvent être aléatoires. D’abord, l’environnement du lieu du spectacle (quartier sain ou mal famé). Ensuite, la cohue à l’entrée du bâtiment (les « embarras de la foule »). Enfin, les rixes provoquées par la course aux meilleures places. Pour être bien placé, il faut souvent se lever tôt et renoncer à manger. Autant d’incommodités dont les spectateurs invités aux spectacles de cour sont préservés lorsque le placement « obéit aux codes de l’étiquette et témoigne des faveurs accordées aux courtisans ».
En matière de représentations théâtrales, deux mondes finissent par coexister : celui des réjouissances privées et celui des divertissements payants. Hormis les exhibitions publiques ouvertes à tous (les spectacles de foire), le XVIIème siècle voit le curseur du divertissement se déplacer des palais et des demeures bourgeoises vers de nouveaux espaces « dont l’accès n’est conditionné que par le paiement du prix d’entrée ». Ce « passage de l’économie de la fête à l’économie marchande » modifie profondément la physionomie du public féminin. D’abord interdites dans ces « espaces clos » considérés comme dangereux « en raison des rencontres qu’il(s) favorisent », elles finissent par s’y glisser, de plus en plus nombreuses. Les courtisanes en premier. Suivies par les aristocrates qui s’amusent ensuite à reproduire dans leurs palais l’ambiance triviale des théâtres publics (voir l’anecdote du lâcher de souris dans la salle de théâtre royal du Palacio del Buen Retiro de Madrid). D’autres lieux de spectacle s’offrent également aux femmes : les couvents et les collèges. Les collèges dans lesquels, après une période de circonspection, les jésuites finissent par s’adapter aux besoins des spectatrices en glissant dans leurs tragédies des intermèdes en français spécialement destinés aux « personnes à qui la langue latine n’est pas trop familière ». Au demeurant, l’entrée des femmes dans les lieux de spectacle les conduit ensuite à se faufiler dans les espaces connexes, tels les salons, tavernes ou cafés où l’on discute du spectacle à la sortie du théâtre.
Espace collectif, « le théâtre est aussi un espace social placé sous haute surveillance ». Le principal danger social étant celui du mélange. Les variations du prix des places opèrent une sélection des spectateurs tandis que les règlements de la police des théâtres traquent les infractions à l’ordre moral et social. Ils prescrivent notamment la disposition du public dans l’espace théâtral, séparant les femmes des hommes, le commun des notables. Cette « ségrégation spatiale » reproduit la hiérarchie sociale (société de classe). Quant au « contrôle social des rapports entre les sexes », il prend appui sur des considérations morales profanes (les préceptes des Anciens), sociales (le maintien de l’ordre social) ou chrétiennes (la protection contre le vice). Avec un succès relatif. Car, dans ce « lieu vivant, accueillant un public mouvant et divers », les cinq sens sont constamment sollicités. De fait, la « vision idéale d’un espace bien ordonné » est contrariée par les propos des acteurs (l’ouïe) et les jeux de lumières dans la salle et les jeux de scène (la vue), le besoin d’uriner satisfait sur place (l’odorat), la consommation de friandises source de badinages (le goût), la promiscuité des corps et les frôlements volontaires ou subis (le toucher).
L’architecture des salles de spectacle concoure à ces ségrégations. Dans un assez long développement, Véronique Lochert décrit la « géographie genrée de l’espace théâtral ». Espace hiérarchisé reflétant la structure de la société (chacun à sa place). « Espace profondément sexualisé qui exprime les rapports de genre » (à chaque sexe son territoire). A l’origine, dans les spectacles de cour, le public était assigné à trois catégories installées dans trois zones distinctes : le prince et son entourage, les dames mises à l’honneur « dans des emplacements privilégiés qui les offrent au regard de toute l’assemblée » (tribunes ou gradins), enfin les hommes. Dans les théâtres publics, cette séparation perdure. Mais c’est le critère économique qui produira l’effet discriminant. Ainsi, le parterre (les places y sont les moins chères) est-il très majoritairement occupé par les hommes. Il est vrai que son inconfort (le spectateur est debout) et son insécurité (la promiscuité) dissuadent les spectatrices. Cette séparation sexuée s’effacera lorsque les parterres seront équipés de banquettes (sauf en France où « le parterre ne s’assoit qu’à la fin du XVIIIème siècle »). Les loges sont prisées par les dames et se transforment en lieux de sociabilité. S’y ajoutent des amphithéâtres (« au-dessous des loges et plus haut que le parterre », en Italie) et des galeries destinées à accueillir, ici les bourgeoises, là les femmes du peuple, pas loin des courtisanes (Londres). De ce fait, une valeur morale finit par être affectée à chacun de ces espaces. Même si, dans la réalité, nombre de spectateurs se déplacent pendant la représentation et franchissent les frontières matérielles ou virtuelles fixées par les règlements ou installées par les propriétaires des salles (la cazuela hispanique réservée aux femmes de condition modeste était, à l’origine, fermée à clé). Avec le temps, ces frontières finissent par se brouiller, réveillant la crainte des maris de voir leurs épouses contaminées par les mauvaises mœurs.
Cette « sexualisation de l’espace théâtral (institue)… une complexe économie des regards. Les espaces perçus comme les plus féminins dans les différents pays européens sont aussi ceux qui assurent la plus grande visibilité à leurs occupants ». Car, s’il faut voir, il faut surtout être vues. Comme à la cour où « le spectacle principal est celui de la puissance du prince », « l’organisation de l’espace des spectateurs importe plus que ce qui se passe sur scène ». « L’architecture des théâtres invite…(donc) les spectateurs à se regarder ». Ainsi les salles italiennes sont-elles configurées en U pour que « les regards des spectateurs (soient) orientés vers les autres spectateurs ». Dès l’ouverture des portes, la représentation commence. S’enclenche alors un double spectacle : celui de la salle et celui de la scène. Ils partagent cependant un point commun : la femme, « actrice ou spectatrice…, attire à elle les regards masculins ». Certaines spectatrices ne s’y trompent pas lorsqu’elles « élaborent avec soin le spectacle qu’elles offrent aux galants ». Exposée à la vue de tous, la femme risque cependant de « mettre en danger sa vertu et son honneur ». Car ces jeux de regards, encouragés par les techniques d’éclairage, se heurtent aux « limites de la condition féminine, définie par sa passivité et sa vulnérabilité ». Mais elles représentent également une force, « faisant sortir la femme du non-être auquel la condamne son invisibilité sociale » (particulièrement en Espagne).
Ainsi, la spectatrice est-elle placée au centre de « l’économie des regards ». Déjà à la Renaissance, « les dames… constituent l’un des plaisirs que les spectateurs vont chercher au théâtre ». D’ailleurs, dans la conception d’un spectacle, la salle et la scène forment un tout. L’attention des spectateurs se déplace graduellement « de la contemplation des parures féminines (offertes aux regards des hommes en étant placées sur des lieux surélevés tels des gradins, tribunes ou galeries) à celle de l’œuvre du scénographe ». Le spectacle qu’offre le public des spectatrices éclipsant, à l’occasion, la performance des acteurs sur scène (voir le récit des noces de César d’Este (1562-1628) et de Virginia de Médicis (1568-1615) en 1585). Ainsi la spectatrice devient-elle un élément du décor et sa contemplation, une activité destinée meubler la longue attente avant le lever du rideau. Ces regards peuvent être chargés de curiosité, de concupiscence ou d’arrière-pensées politiques. De curiosité à l’égard des modes locales (les espagnoles abusant du maquillage rouge qui les transforme en « écrevisses cuites »). Du désir qui échauffe les échanges de regards et les jeux d’éventails. De célébration ou de désapprobation politique lorsque les Grands s’exposent « aux regards inquisiteurs du public ». Les comédiens eux-mêmes peuvent animer un double jeu de regards. Les regards qu’ils s’attirent : les comédiennes en quête d’encouragements interpellant le public masculin ou les jeunes acteurs et les travestis suscitant la sympathie des spectatrices. Mais aussi les regards qu’ils détournent. Notamment vers les spectateurs qui, eux-mêmes, les dévient vers certaines composantes du public. Particulièrement les spectatrices. Ainsi la réception féminine du spectacle constitue-t-elle « un spectacle second à l’intérieur du spectacle ». Soit lorsque certaines catégories de spectatrices sont représentées sur scène, comme les « prudes » de Molière (1622-1673). Soit lorsque des spectatrices deviennent elles-mêmes l’objet de divertissements. Exemple : ne disposant pas des codes pour dissimuler son trouble (rougissements, soupirs) lors d’allusions obscènes ou de situations scabreuses, « l’innocence et la sincérité de la spectatrice débutante la livrent entièrement à la jouissance du regard masculin ». Situation que Véronique Lochert qualifie « d’initiation forcée et publique de la jeune fille aux émotions de l’opéra ». Une autre modalité du viol. En tout état de cause, moralisateurs et théâtrophobes se saisissent de ces situations pour dénoncer ces échanges « de regards réciproques entre hommes et femmes au sein du public ». Regards qui peuvent mettre les femmes en danger.
Face à cela, les spectatrices optent pour des « stratégies de dissimulation afin (d’avoir le plaisir du spectacle) tout en échappant au jugement moral ou aux conséquences sociales et politiques » auxquels elles seraient exposées. L’éventail, le voile (Espagne) ou le masque quittent leur statut d’accessoire de mode ou de déguisement pour devenir l’instrument par lequel la spectatrice réalise son « rêve transgressif de voir sans être vu ». Dans un premier temps, le masque protège la réputation des femmes honnêtes dans un endroit où différents groupes sociaux se mêlent (les carnavals). Mais, lorsque les courtisanes se l’approprient par dissimuler leurs activités galantes, il devient « un instrument de confusion… brouillant les frontières entre la dame de qualité et la prostituée ». Ainsi, devenu suspect, le voile finit par être interdit à Madrid (1639). De même pour le masque dans les théâtres britanniques (1704). Finalement, ces accessoires placent les spectatrices dans une situation ambiguë, manifestant autant sa vulnérabilité (son besoin de protection) que sa duplicité (sa volonté de dissimuler). Prenant appui sur cette ambivalence, les moralistes finissent par établir « un lien polémique entre le comportement des spectatrices et l’honnêteté du théâtre ». Malgré cela, « soumises à de nombreuses restrictions dans la vie sociale, les femmes figurent parmi les premières bénéficiaires de cette nouvelle sociabilité qui transforme la manière dont les individus privés voient et sont vus ».
Chapitre II : « A voi bellissime donne ». Quand le théâtre s’adresse aux femmes
L’exploration des paratextes dramatiques jette une lumière singulière sur « les enjeux de la distinction d’une catégorie féminine du public ». Cette distinction s’opérant dans un contexte où la relation privilégiée qu’entretenait le producteur de spectacle avec le prince évolue vers une relation plus complexe. Celle que tisse une entreprise marchande avec un public hétérogène. Véronique Lochert s’intéresse particulièrement à sa composante féminine.
Au théâtre, le prologue est l’instrument par excellence pour s’adresser aux spectatrices.
Déjà, Plaute (Poenulus) appelait les matrones à rire en silence, les prostituées à libérer les places à l’avant du théâtre et les nourrices à laisser les marmots au domicile. A la Renaissance italienne, « l’adresse aux femmes devient un lieu commun du prologue, avant de connaître une grande fortune en Angleterre ». En revanche, cette relation entre la comédie et son public féminin se construit plus timidement en France (à l’exception des prologues des tragédies protestantes soulignant « le processus édifiant de la représentation »).
Depuis que le mécénat royal se montre moins généreux, beaucoup se joue en amont de la pièce. Car désormais, le sort d’une pièce est à la merci du public. Durant ce moment clé d’avant représentation, l’auteur et les acteurs tentent d’obtenir son attention et sa bienveillance (la captatio benevolentiae des rhétoriciens). Ainsi, se tournant vers sa composante féminine, des prologues italiens de la Renaissance font « l’éloge des spectatrices, dont la beauté, la noblesse, la vertu et la culture font honneur à la pièce représentée ». Mais, avec le temps, le discours adressé aux femmes se charge de lieux communs misogynes ou de références puisées dans le registre grivois. Le lien de connivence finit par se déplacer vers le public masculin.
Le prologue dirige donc les regards du public vers sa composante féminine. Aussi, « avant d’être une spectatrice, c’est-à-dire un sujet regardant, elle est… un objet regardé ». Jusqu’à rivaliser avec la comédie. Or, au théâtre, c’est sur la scène que se joue la pièce. Aussi, le prologue doit-il remplir une seconde fonction. Celle d’inviter « les spectateurs à détourner les yeux de la beauté des femmes pour les porter sur la beauté du spectacle ».
« Pour que le spectacle ait lieu, il faut que le public se taise ». Une nouvelle fois, le registre des lieux communs abreuve l’argumentaire des auteurs de prologues. Convoquant, au besoin, le goût du bavardage sur des sujets futiles qui caractériserait la gent féminine. Pour amener les spectatrices à faire silence, les prologues se moquent de leurs sujets de conversation (vanités, médisances, cosmétique…). Ou, plus sérieusement, les enjoignent de se conformer au « modèle féminin d’une conduite fondée sur la discrétion et la passivité ». Ce portrait de la femme passive reflète, au demeurant, l’image du « modèle du rapport amoureux » selon les canons de l’époque. Véronique Lochert l’inscrit dans une formule : « une érotique de la réception ». Car, « en faisant de la spectatrice le récepteur privilégié du spectacle, les prologues féminisent le public tout entier, placé dans la position de la dame courtisée par son amant ». Ici, l’auteur marivaude ou prend la pose de l’amant éconduit (le poète aveugle Luigi Groto (1541-1585) dans La Dalida). Ailleurs, il « invite les dames à le récompenser par des faveurs honnêtes » (par un doux regard), voire plus charnelles. En fin de compte, cette poétique hédoniste et joyeuse qui se dessine dans les prologues et épilogues du XVIIème siècle, repose sur trois piliers : « le rôle du corps dans la réception, le plaisir comme finalité de la représentation, les liens unissant la réalité et la fiction… Plaisir sexuel et plaisir esthétique (étant) mis en parallèle et (apparaissant) comme la principale finalité du spectacle ». Comment cette « promotion joyeuse du corps » contaminera-t-elle la « civilisation des mœurs » ? Une intéressante piste de recherche en perspective.
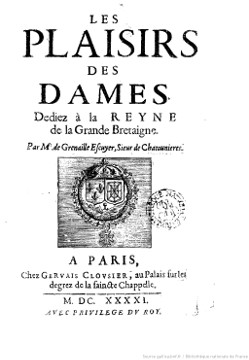
François de Grenaille (1616-1680) – Les Plaisirs des Dames, 1641 - Gallica, BnF
Si le prologue est l’instrument des théâtres, la dédicace est celui des livres.
Un « nouveau système paratextuel » se met en place avec la multiplication des épîtres dédicatoires, préfaces, autorisations de publication, poèmes encomiastiques (tissant des éloges) ou arguments divers. Un système fondé sur la théorie du don/contre-don : en récompense de l’hommage public qu’il rend à sa dédicataire, l’auteur en attend protection, soutien et rémunération (financière ou symbolique). Ainsi se nouent des « rapports de clientélisme » dans lesquels des femmes jouent un rôle clé.
Mais comment bien choisir sa dédicataire ? Et dans quel but ? D’une façon générale, dédicacer son ouvrage à une femme, c’est offrir au lecteur, singulièrement à la lectrice, une garantie a priori : celle de l’honnêteté d’une pièce débarrassée de toute obscénité. Car la femme porte traditionnellement en elle « l’exigence de décence et de vertu ». C’est également introduire dans le jugement critique une dimension émotionnelle.
Parmi ces femmes, il y a celle dont la position éminente dans la hiérarchie sociale offre une caution prestigieuse : l’auteur garantit la qualité de son ouvrage par l’intérêt que lui a porté une mécène illustre. Dans le même temps, il s’en prévaut pour élargir sa notoriété. Il y a celle qui s’est personnellement investie dans la création théâtrale : en l’inspirant au moment de sa conception, à la relecture du manuscrit devant un cercle d’intimes, en participant, financièrement, physiquement ou symboliquement, à sa représentation privée ou semi-publique ou au financement de sa publication. Ce cercle des dédicataires renommées s’élargit à des personnalités n’appartenant pas forcément au milieu aristocratique. Voici les dédicaces amoureuses qui, sous couvert d’un personnage fictif, courtisent une femme bien réelle ou se vengent de sa cruauté. Voilà celles qui, par le comique ou la provocation, prennent le parti des lectrices en dénonçant certaines hypocrisies préjudiciables aux femmes. D’autres dédicaces, « débarrassées de la rhétorique pesante de l’éloge et du topos humilitatis » (modestie affectée), célèbrent une actrice ayant incarné le rôle principal ou se tournent vers des proches partageant certaines valeurs (le protestantisme) ou certaines expériences de vie (l’exil). Sans oublier celles qui sont porteuses d’une stratégie sociale. Par exemple, s’adressant à des jeunes filles, elles présentent extérieurement l’aspect d’un divertissement innocent alors qu’elles ouvrent le champ à « une réflexion sur l’éducation des jeunes filles » et, plus largement, sur l’accès des femmes à la culture.
Dans une époque où la pièce de théâtre « se développe comme genre à lire », la dédicace accompagne le texte de la scène jusqu’au cabinet de la lectrice. De fait, « la lecture est fréquemment envisagée comme le prolongement et le renouvellement du plaisir pris à la représentation ». Et pour celles qui n’ont pas accès aux salles de spectacles (religieuses, jeunes filles, veuves), la lecture de la pièce constitue une récréation d’autant plus honnête que « le faux éclat de la représentation » est gommé au profit d’une réflexion guidée par le paratexte. Cette modalité donne même naissance au genre littéraire particulier des closet drama britanniques (théâtre destiné à la seule lecture). Socialement, cette pratique paraît « conforter l’enfermement des femmes dans l’espace privé ». Pourtant, elle « leur donne une liberté plus grande que celle dont elles jouissent dans la société ».
Au fil du temps, ces paratextes finissent par reconnaître le « rôle culturel joué par les femmes ». Deux modalités sont actionnées par leurs auteurs. La première, de nature descriptive, dote chacune des catégories féminines identifiées « de comportements, de jugements et de goûts plus ou moins différenciés ». Ainsi, dans le prologue de La Cecca (1596), Girolamo Razzi (1527-1611) oppose « les dames honnêtes, qui n’expriment leur désapprobation qu’à travers « un silence modeste », aux femmes vulgaires qui les singent et critiquent tout pour paraître savantes ». Cette spécification est souvent caricaturale et teintée de misogynie. Une seconde modalité est guidée par les intentions de l’auteur : la captatio (créer une connivence), la tactique (sélectionner l’une des catégories dont l’adhésion emportera celle des autres) ou la réflexion théorique (étudier les mécanismes de la réception et du jugement critique propre à chaque sexe).
Hormis dans les couvents féminins, rares sont les prologues s’adressant exclusivement aux femmes. Lorsqu’ils personnalisent leur rapport au public (spectateur ou lecteur), leurs auteurs préfèrent jouer de la rivalité entre ses deux composantes sexuées. Par exemple, en louant le modèle de réception du public féminin (réception bienveillante et silencieuse), l’opposant au contre-modèle du public du parterre (turbulent et critique). Ils fondent ainsi leurs espoirs sur le « pouvoir d’influence (que les femmes) exercent sur les hommes » dans le domaine de la culture. Reconnaissant, dès lors, à leur médiation esthétique « le statut d’arbitre du goût ».
Examinant les mécanismes du jugement féminin, Véronique Lochert identifie quatre de ses caractéristiques. D’abord, « la faiblesse d’une appréciation hypocrite et instable ». Si l’instabilité d’humeur figure parmi les stéréotypes misogynes les mieux partagés, celui de l’hypocrisie résulte de l’observation des comportements des spectatrices qui, « tantôt se scandalisent, tantôt assistent sans sourciller à des pièces indécentes ». Ensuite, « le caractère central du critère de décence ». Car c’est le « goût de l’honnêteté qui est censé caractériser les femmes ». Si la dédicace à une femme attribue à l’œuvre sa légitimité morale, elle renvoie également aux spectatrices/lectrices le modèle de conduite morale auquel l’ordre social les appelle à se conformer. Au grand dam des dramaturges qui réclament d’être appréciés sur l’intérêt de leur production plutôt que sur son degré de bienséance. « Le rôle de l’émotion et de l’expérience personnelle » constitue un troisième facteur constitutif du « goût des dames ». Celles-ci étant priées de se fier à leur cœur et leur vécu plutôt qu’au jugement des polémistes. Enfin, les auteurs saluent la capacité des spectatrices/lectrices « à former un jugement éclairé aussi pertinent que celui des savants ». Particulièrement en France et en Angleterre où se créent de nouvelles instances (sociétés mondaines) qui deviennent de véritables centres de gravité de l’autorité littéraire.
Pour autant, existe-t-il des types d’ouvrages qui incarneraient le « goût des dames » ? D’une façon générale, Véronique Lochert observe d’abord que l’instance féminine est plus fortement sollicitée lorsque s’épanouissent des genres rénovés : les pastorales dans les années 1620, la tragi-comédie dans les années 1630, la comédie dans les années 1660 mais, plus rarement, la tragédie. Ce mouvement de fond enrichit le panorama des goûts féminins en matière de production dramatique : « un public moderne, favorable aux nouveautés, dont l’invocation permet d’encourager les genres émergents ». Plus précisément, les auteurs de paratextes adressent aux femmes quatre types d’œuvres. Pour les pièces célébrant le comportement exemplaire d’une héroïne, la dédicace établit le parallèle avec les qualités exceptionnelles de sa dédicataire. D’autres paratextes associent le public féminin aux sujets amoureux. Cependant, l’action missionnaire post-tridentine jette la suspicion sur cette thématique. Désormais, les auteurs devront « justifier leurs dédicaces par l’honnêteté de l’amour représenté ou l’utilité de la mise en garde proposée ». A l’inverse, les pièces à sujet religieux prospèrent. Erigées en modèles de conduite, elles « font de la modestie, de la vertu et de la piété les qualités féminines par excellence ». Enfin, « nombre de pièces font écho aux différentes querelles des femmes qui ponctuent les XVIème et XVIIème siècles ». Cependant, usant de circonvolutions littéraires et cultivant l’ambiguïté des propos, leurs auteurs tentent de ne fâcher personne tout en faisant mine d’épouser la cause des femmes.
Poussant plus avant cette approche du goût féminin, Véronique Lochert s’intéresse au caractère sensible de l’expérience de la réception féminine d’une œuvre dramatique. Elle observe que, grâce au détour par la fiction, les auteurs de paratextes accèdent à « un espace théorique alternatif » dans lequel ils peuvent débattre des genres dramatiques ou des procédés dramaturgiques sans pour autant recourir au langage sérieux des théoriciens du genre. Ainsi, lorsque dans les années 1680, « la relation entre la tragédie et le public féminin se resserre », c’est « au travers des caractères du féminin que les dramaturges interrogent leur art et cherchent à en préciser les pratiques ».
Cette « théorie oblique » parle le langage métaphorique. A commencer par la formule de Lise Wajeman (L’Amour de l’art. Erotique de l’artiste et du spectateur au XVIème siècle, Genève, Droz, 2015) : « L’art prend corps au XVIème siècle, et ce corps est celui d’une femme ». Cette formule constitue, de notre point de vue, la pierre de touche du long développement que Véronique Lochert consacre au pouvoir des métaphores. D’abord, dédicataires, actrices ou spectatrices enfilent le costume de « figures allégoriques et fictives » telles les Muses, les Sybilles, les Grâces ou autres allégories morales païennes ou chrétiennes. Les auteurs introduisent ensuite cette « féminité allégorique » dans la « dimension esthétique (que leur paratexte transforme en) un lieu de théorisation important sur le théâtre ».
Véronique Lochert l’explore sous trois angles. Le premier prend acte de la féminisation métaphorique de l’œuvre dramatique : « défense des femmes et défense du théâtre vont de pair ». Jusqu’à sa dévalorisation lorsque les théâtrophobes constatent : « comme la femme, vaine, instable et trompeuse, le théâtre est un art de la fiction, peu estimé et relégué dans l’espace du divertissement ». Le second réfléchit aux liens entre éthique et esthétique. La Beau en est le moteur. Surtout dans le dialogue dialectique entre deux types de beautés : la beauté naturelle (éloge des beautés du corps féminin dans les prologues et appréciation de l’œuvre dramatique pour la qualité de son sujet et la solidité de sa disposition) et la beauté artificielle (l’hypocrisie du fard et l’attirance trompeuse pour « tout ce qui brille »). La beauté naturelle renvoyant « à une beauté plus essentielle, celle de l’esprit et de l’âme ». Rappelant, au demeurant, « l’exigence de moralité qui pèse sur les femmes ». Le troisième inscrit la réflexion dans la durée. Notamment lorsqu’il exprime le besoin de renouvellement des codes et de la quête permanente de la nouveauté. Tous deux formulés en termes imagés : « pièces réduites au statut de maîtresse dont on se lasse vite » ou « parallèle traditionnel (établi) entre nouveauté dramatique et jeunesse féminine ». En somme, « le recours à la métaphore féminine permet aux dramaturges de donner un habillage plaisant aux idées du théâtre, en sollicitant l’expérience personnelle des spectateurs et des spectatrices afin de les impliquer dans la réflexion théorique ».
L’outil métaphorique se met également au service de deux types de « scénarios fictifs » : le processus créateur de l’œuvre et la modélisation de sa réception.
La conception de la pièce est généralement représentée par deux images. D’abord, essentiellement dans les prologues, celle de l’amour comme représentation de l’inspiration artistique. Cette personnification du rapport qui se noue entre l’œuvre et son public suggère « l’établissement d’une relation amoureuse entre acteurs et spectateurs ». Ensuite, principalement dans les dédicaces, celle de la réalisation d’un portrait. Plus précisément d’un diptyque mettant en miroir les qualités du personnage fictif et celles de la dédicataire. Cependant, si les dramaturges français « prennent fréquemment la pose du portraitiste dans les longues dédicaces des années 1630 et 1640 », les poètes italiens préfèrent la métaphore de la paternité (assimilation de la pièce à l’enfant du poète).
Pour ce qui concerne la réception, d’autres figures sont suggérées aux spectateurs/lecteurs. « Associée à la féminisation de la pièce, la métaphore la plus fréquente dans le paratexte dramatique pour évoquer la publication est celle de l’entrée dans le monde de la jeune fille ». La dédicace active alors plusieurs leviers émotionnels : la fibre maternelle, la solidarité féminine, « la défense de la réputation des femmes et de l’honnêteté de l’amour ». Cette figuration de la modalisation s’élargit à d’autres formes. La pièce étant « personnifié sous les traits d’une femme », celle de l’hommage galant s’impose d’emblée (un homme, l’auteur, courtise une femme qui incarne les spectateurs). Jusqu’à pousser l’analogie avec la nuit de noce (le public invité à posséder la pièce), la métaphore virginale (pièce nouvelle représentée pour la première fois), voire le viol (mauvais traitements infligés à la pièce). Toutes ces associations métaphoriques établissent des passerelles entre fiction et réalité. Jusqu’à créer des tensions lorsque « la représentation dominante des femmes, caractérisées par la faiblesse et l’inconstance, dans une société patriarcale teintée de misogynie, entre… en conflit avec les attentes du public féminin ». Tensions qui, par ailleurs, nourrissent les débats sociétaux « sur la nature des femmes et leur place dans la société ». Le théâtre finit par alimenter une dynamique sociale lorsque ses héroïnes sont « supposées exercer… une influence sur les spectatrices en leur offrant des modèles et anti-modèles de comportement ».
Chapitre III : « Theaters are snares unto fair women ». Les spectatrices dans la polémique théâtrale
Débarrassés de leurs outrances, les pamphlets anti-théâtraux constituent une source d’information singulière et de premier ordre. D’abord, parce que, en filigrane de leurs argumentaires dénonçant la toxicité des spectacles, ils témoignent de l’accroissement de la fréquentation féminine des théâtres, esquissent les caractéristiques sociales des spectatrices et visualisent la condition de la femme dans la société. Ensuite, et surtout de notre point de vue, parce qu’ils orientent le regard de l’observateur, non plus sur la conception de l’ouvrage (la technicité de l’auteur en référence aux règles de l’art) mais sur les mécanismes de la réception du spectacle (les effets produits par le théâtre sur son public). Enfin, cette observation fournit de précieux auxiliaires pour interroger la nature de la relation ambivalente qu’entretiennent le théâtre et son public (une expérience sensible et sensuelle susceptible d’alimenter les passions), le rapport entre fiction dramatique (la femme fantasmée) et vie réelle (la femme dans la société) ou le type de résistance qu’oppose le système de valeur d’une société à l’activité théâtrale.
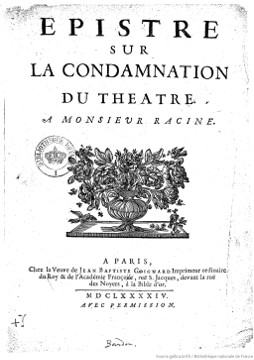
P. Bardou ( ?- ?) – Epistre sur la condamnation du théâtre A Monsieur Racine, 1694 - Gallica, BnF
Car, à mesure que croît la fréquentation féminine dans les salles, le volume des mises en garde grossit. Esquissant une « sociologie du public », Véronique Lochert dénombre les menaces intrinsèques de l’activité théâtrale : temps et argent dilapidés dans un loisir profane futile au détriment de l’activité laborieuse et pieuse, lieu maléfique de mélange des sexes, effets toxiques des intrigues amoureuses sur le lien conjugal, dangers pour l’équilibre social lorsque coïncident une activité théâtrale intense et le charivari carnavalesque… Pour ses adversaires, le théâtre corrompt parce que son public est grossier et immoral et que le pouvoir de séduction du spectacle incline les personnes fragiles à la licence. Les détracteurs du spectacle populaire (la critique touche moins les divertissements curiaux car leur public est plus instruit et sélectionné) en appellent donc à la responsabilité des pères et des maris. Ainsi, la réaction devient-elle essentiellement « une affaire d’hommes ». En réalité, ces critiques agissent comme les révélateurs de tensions sociales préexistantes. Tensions d’autant plus intensément ressenties que, au moment même où les discours publics « cherchent à renforcer les lignes de démarcation entre les classes comme entre les sexes », le théâtre encouragerait à « l’efféminement » et inciterait à « l’obscénité ».
Véronique Lochert explore d’abord la critique de l’efféminement. Soulignant que, en l’occurrence, l’opposition du masculin et du féminin n’est pas forcément d’ordre sexuel. En effet, l’efféminement désigne ici une évolution psychologique (individuelle ou collective) provoquée par « le goût de l’oisiveté, du luxe et des plaisirs ». Marqueurs spécifiquement féminins, disent les dictionnaires. Antithèse de la « virilité guerrière ». Or, par son emprise sur les corps et les émotions, l’expérience théâtrale provoque un « affaiblissement de la masculinité et des valeurs qui lui sont attachées ». Le danger est d’autant plus grand que le processus de l’imitation (Platon) inhérent à l’activité théâtrale altère l’identité. Car, en se travestissant (hommes dans des rôles de femmes et femmes revêtues de costumes masculins), les acteurs « brouillent les frontières entre les sexes ». Ce qui finira par fissurer l’ordre social, prophétisent-ils. Par ailleurs, le pouvoir d’influence des héroïnes que l’on applaudit entre en compétition avec les rôles prescrits aux femmes par la société (notamment le devoir de modestie). Aussi, le théâtre devient-il « l’emblème de déviances qui affectent l’ensemble des activités humaines ».
« Il est révélateur que ce soit dans la bouche d’une spectatrice fictive que le terme « obscénité » fasse son entrée dans la langue française », observe Véronique Lochert en se référant à La Critique de l’Ecole des femmes (II,5) de Molière. Pour les adversaires du théâtre, c’est la présence de femmes dans le public qui incite des « hommes mal intentionnés » à prendre « plaisir à blesser la pudeur des spectatrices ». « En ce sens, ce sont bien les spectatrices qui font l’obscénité au théâtre ». Transformées instantanément en objets du regard masculin, les regards dirigés vers elles suscitent malaise et rougissement. La rougeur étant « la marque de la modestie féminine, mais aussi de son impuissance face aux mauvais procédés des auteurs et des acteurs ». Pour autant, « les femmes sont… capables d’apprécier les jeux obscènes aussi bien que les hommes ». Qu’il s’agisse de « l’obscénité grossière prisée par un public populaire… (ou de) « l’obscénité voilée, qui procure aux spectatrices de nouveaux plaisirs tout en préservant leur pudeur ». Pour pernicieuse qu’elle soit, cette dernière révèle l’influence « civilisatrice » qu’exerce la femme sur la production dramatique. Les théâtrophobes en déduisent que le public est complice des « actions déshonnêtes » représentées sur scène. Certains théologiens italiens n’hésitant pas à qualifier le fait d’aller au théâtre de péché mortel parce que, rien que par leur présence, les spectateurs poussent les auteurs et les acteurs à « satisfaire leur goût pour le vice ».
En France, cette approche de « l’esthétique de la réception » alimente le débat sur la question technique de la bienséance : le spectacle offert est-il en adéquation avec les exigences sociales ? Elle interroge également « la valeur pédagogique du théâtre et son utilité morale et sociale ». Or, en s’érigeant « maître public du peuple », le dramaturge entre en compétition avec le prédicateur (voir Anne Régent-Susini, Un anti-théâtre ? Prédication et voix du public (in Sarah Nancy et Julia Gros de Gasquet, La voix du public en Italie aux XVIIème et XVIIIème siècles -déjà cité). Notamment lorsque le divertissement profane prétend éduquer le public féminin alors même que l’Eglise travaille à son édification. Suscitant des stratégies d’influence et des conflits d’intérêt qui mériteraient d’être explorés plus en profondeur, nous semble-t-il.
Socialement assimilées aux enfants et culturellement défavorisées, les femmes se tournent « vers les œuvres de fiction pour se former ». Ainsi, « art visuel, accessible à tous », le théâtre devient une école pour celles et ceux qui ne savent pas lire. Pour les dramaturges défendant l’efficacité morale du théâtre, la scène enseigne le Bien. Au contraire, les théâtrophobes affirment que « la puissance de l’image et la force de l’exemple (peuvent être) mises au service du vice ». Dans cette atmosphère d’ambiguïté morale, la spectatrice est appelée à exercer son libre-arbitre en conférant « un statut d’exemple et de contre-exemple » aux actions représentées sur scène. Une liberté trompeuse, affirment les adversaires du théâtre. Car, érigées en modèles de comportement, « la puissance des héroïnes de théâtre… (exerce) une influence profonde » sur la femme et altère son discernement.
Universellement, la thématique amoureuse développée dans les comédies est la cible des critiques. L’amour vertueux n’offrant guère de matière à l’élaboration d’une intrigue captivante, le théâtre met « en scène les amours empêchées de jeunes gens qui se rebellent contre l’autorité paternelle », déroule des intrigues tissant des histoires d’adultère ou de jalousie, encourage les jeux de scènes suggérant la lascivité. Or, l’adversaire du théâtre craint par-dessus tout que ce spectacle ne suscite « l’admiration et l’imitation ». Pour lui, « la prééminence des héroïnes dans la fiction dramatique ne peut qu’exercer une influence néfaste sur des femmes que leur statut destine à la modestie et à la soumission ». De ce point de vue, dans la querelle du Cid, le personnage de Chimène « manifeste la tension entre les règles gouvernant le comportement des femmes dans la société et les principes dramatiques présidant à la création des héroïnes » : présentée sous les traits d’une héroïne caractérisée par la vertu et le sens de l’honneur (modèle de conduite féminine), elle cède à la puissance de la passion en continuant à aimer le meurtrier de son père (manquement à la bienséance).
Comment se nouent fiction dramatique et vie réelle des spectatrices ? Voici le schéma. Le genre féminin étant « défini par le primat du corps sur l’esprit », le processus de réception débute par la stimulation des sens, à commencer par la vue. Grâce au plaisir qu’elles produisent, les images perçues s’impriment dans l’imagination et la mémoire. « Les pièces vues au théâtre sont alors rejouées sur une scène intérieure, où elles prennent une valeur exemplaire, positive ou négative ». Ainsi se prépare « le passage de l’observation à l’action ». A ce processus s’ajoute un mécanisme d’identification dont « l’investissement émotionnel du spectateur » est le carburant. Se reconnaissant dans le personnage et en épousant les actions, la spectatrice s’initie « à de nouveaux désirs et à de nouveaux comportements ». Au terme « de ce processus de contamination entre fiction et réalité », la spectatrice devient actrice. Troquant « le rôle que lui imposaient son sexe et sa condition pour celui d’une héroïne de théâtre ». Mettant ainsi en péril jusqu’à l’honneur familial et l’ordre social. En Angleterre et en Italie, l’attention se porte également sur les détournements et manipulations « auxquels la participation affective du public donne lieu ». Certains comptent sur la lucidité des spectateurs ou leur capacité à prendre de la hauteur pour maîtriser les effets du spectacle. En revanche, pour les théâtrophobes, « dans l’économie sensuelle et passionnelle du théâtre, les émotions (telles que la pitié ou les drames de l’honneur espagnols) sont la source de désirs incontrôlables, qui sont condamnés à rester englués dans la réalité physique au lieu de s’élever vers des objets spirituels ». Pour autant, à bien des égards, « les mécanismes à l’œuvre dans la réception théâtrale sont… très proches de ceux que sollicitent les pratiques religieuses » : l’imagination (pour méditer sur les mystères chrétiens), la place de l’émotion et des larmes (dans la pratique mystique) ou l’imitation (encouragée dans un ouvrage populaire : De imitatione Christi). Dans cette compétition, le théâtre finit par devenir « la chaire du diable ».
Les argumentaires développés dans les traités anti-théâtraux sont éclairés par des micro-récits illustrant, par l’exemple, « la puissance du théâtre et sa capacité à transformer les individus et les structures de la société ». Ainsi, quelques métaphores marquantes pigmentent les textes. Comme l’action théâtrale comparée à un poison dangereux « pour l’institution du mariage et la cellule familiale ». Ou « l’efficacité théâtrale (exprimée) sous la forme d’un acte de violence accompli contre une femme ». Les récits de séduction (d’un gladiateur par une patricienne) tirés des auteurs anciens sont paraphrasés (une spectatrice « honnête et de haut rang » subjuguée par un acteur). A ces éléments littéraires s’ajoutent des anecdotes montrant comment « l’action de la fiction (agit) sur la conscience des spectateurs » : par l’émotion qu’elle suscite, une scène provoque la confession d’une femme qui avait assassiné son mari quelques années auparavant. Même le théâtre à sujet religieux n’est pas à l’abri des critiques : dans une pièce traitant de la conversion de Madeleine, une jeune spectatrice « tomba amoureuse du Christ, ou plutôt, de celui qui interprétait le rôle du Christ ». En somme, les anecdotes tentent de mettre en scène le pouvoir nocif du théâtre, ses violences émotionnelles (notamment exercée contre des femmes), ses effets incontrôlables et ses conséquences inattendues. « Cette émotion subie prépare souvent un passage à l’action ». Action qui, le cas échéant, provoque en retour une « punition divine qui s’abat sur les amatrices de théâtre » lors de l’incendie du Coliseo de Séville (1629).
Chapitre IV : « Where ? on the stage, Ladies ? » Ou quand la spectatrice devient personnage
Particulièrement en Angleterre et en France (le sujet reste à approfondir pour l’Italie et l’Espagne), une nouvelle étape est franchie lorsque la spectatrice devient un personnage de fiction et monte physiquement sur scène. Comme à l’ouverture de la comédie The Staple of News (1625) de Ben Jonson (1572-1637) : « alors que les sièges disponibles sur la scène sont généralement réservés aux gentilshommes, (quatre dames) s’installent sur le plateau et affichent l’intention de critiquer les nobles, les érudits et les poètes. Cette visibilité nouvelle conférée aux spectatrices, alors même que leurs personnages continuent à être incarnés par des boy actors en Angleterre jusqu’en 1642, témoigne de l’intérêt manifesté par les dramaturges à la réception féminine ». Lieu de la transgression, le théâtre fait maintenant monter sur scène des personnages fictifs qui « offrent aux femmes venues au théâtre, d’autres modèles féminins, caractérisés non par le silence, la passivité ou l’enfermement dans l’espace domestique, mais par l’action, l’autonomie et la visibilité ».

Adrien de Montluc (1571-1646) – Les Ieux de l’Incogny, 1630 - Gallica, BnF
A partir des années 1660, le nombre de ces personnages augmente, notamment dans les comédies de mœurs. Cette évolution révèle que le théâtre « fait désormais pleinement partie de la vie sociale ». Les rôles de spectatrices construits « par ces textes reflètent la diversité sociale et culturelle du public féminin ». Ainsi, plusieurs types de portraits stéréotypés sont croqués. Ceux de la « spectatrice novice » côtoie la « spectatrice experte » qui se frotte à la « spectatrice savante ». Certes, cette « spectatrice n’a pas l’épaisseur ni l’énergie des héroïnes… Néanmoins, par leur présence et leurs commentaires, les personnages de spectatrices mettent en valeur la participation des femmes à la création dramatique – qu’elles influencent en exprimant leurs goûts – et à la réception – dont elles incarnent aussi bien les échecs que les réussites ». Réception qui, par exemple, constitue l’enjeu de La Critique de l’Ecole des femmes (1663) de Molière.
Parce qu’elle assure « la transition entre le monde réel et l’univers de la fiction », l’ouverture de la représentation apparaît comme un moment indiqué pour que des spectatrices fassent irruption sur la scène. A leur manière, elles entendent imposer leurs attentes et participer à la conclusion du contrat qui se noue entre les comédiens et le public. D’une façon générale, ces incursions interviennent lors des prologues dramatisés français, des inductions anglaises (échanges comiques) ou des « teatro breve (pièces courtes espagnoles) qui se développent sur les marges et dans les interstices des comedias ». A titre d’exemple, le misogyne Ben Jonson imagine quatre commères « superficielles et bavardes ». Plus subversive dans Apollo Shroving (1627) de William Hawkins, Lala grimpe sur scène. Elle « interrompt le prologue prononcé en latin pour réclamer un spectacle en anglais » à l’intention de toutes les spectatrices présentes. Puis elle se dirige vers les coulisses pour tenter d’obtenir un rôle masculin. En somme, sortant de la passivité définissant le rôle des femmes, « Lala incarne avec force le pouvoir du public féminin, qui ébranle les barrières dressées entre les sexes » et réclame une réforme du théâtre. Par ailleurs, des enjeux plus commerciaux font rapidement leur apparition. L’objectif est d’attirer les femmes au théâtre. Car « une femelle dans une loge attire les mâles », analyse Thalie dans le prologue des Chinois (1692) de Jean-François Regnard (1655-1709) et Charles Dufresny (1648-1724). Ces jeux de connivence (vers le public masculin pour Jonson et la catégorie féminine pour Hawkins) finissent par converger vers « un mouvement d’union et de conciliation » mettant « sur un pied d’égalité les différentes catégories de spectateurs ». Un sentiment d’égalité fugace qui ne durera que le temps du spectacle.
En Angleterre tout particulièrement, « le public (est) perçu comme un participant actif à la configuration de l’événement théâtral ». Déjà William Shakespeare (1564-1616) évoque les différences sexuées dans The Tragedy of Hamlet. Notamment lorsque le héros de la pièce dénie « à Ophélie le statut de sujet regardant pour la réduire à un objet de désir ». Il en approfondira l’analyse dans A Midsummer Night’s Dream. Il y souligne l’hétérogénéité des figures de spectatrices (dont la reine Elisabeth Ière (1533-1603). Figures qu’il intègre dans la dynamique de la pièce. Encore discrètes dans le théâtre de Shakespeare, les spectatrices sur scène « acquièrent une énergie et une indépendance nouvelles dans les pièces produites sous les règnes de Jacques Ier (1566-1625) et de Charles Ier (1600-1649), témoignant de l’évolution des perceptions et des pratiques ». Dans les espaces clos des private theatres, la taille réduite de la salle favorise la participation active du public au spectacle. Ainsi, dans The King of a Burning Pestle (1607), Francis Beaumont (1584-1616) fait monter sur scène un épicier et son épouse, Nell. Cette dernière prend le contrôle de la pièce et l’agrémente de ses commentaires. Sous les traits caricaturaux de la spectatrice, Nell incarne ici le pouvoir des femmes sur la production théâtrale. Ailleurs, par exemple dans The Roman Actor (1626), Philip Massinger (1583-1640) concentre dans le personnage de l’impératrice Domitia « tous les traits négatifs attachés par les théatrophobes à la réception féminine, en particulier la concupiscence ». Passant successivement, au cours de la pièce, du statut de spectatrice à celui de commanditaire, metteuse en scène puis autrice d’une pièce enchâssée, Domitia prétend exercer les différents « métiers » qui font le spectacle. Une manière, pour Massinger, de signaler « le danger couru par les acteurs face aux désirs déréglés des spectateurs ». Richard Brome (vers 1590-1652) proposera, dans The Antipodes (1638), une vision plus positive. « Une apologie du théâtre qui repose en grande partie sur le comportement d’une spectatrice » novice, Diana. « C’est la réception de Diana qui va permettre de révéler à la fois l’utilité du théâtre et l’honnêteté des femmes, unies dans la même défense ». Tout le contraire de la Margery Pinchwife, l’héroïne de The Country Wife (1675) de William Wycherley (1640-1715), dont le comportement confirme les critiques des théâtrophobes dénonçant les effets corrupteurs du théâtre.
Un peu plus tard, dans les années 1670, le théâtre se consacre davantage à la peinture des mœurs. Dans l’esprit du public, il « n’apparaît pas comme un lieu de création dramatique, où l’on va voir des pièces, mais comme un lieu de sociabilité, où l’on va faire des rencontres ». Un lieu public parmi d’autres, en somme. Ainsi perd-il de sa nocivité. En parallèle, le comportement de spectatrice évolue : elle s’offre plus aux regards qu’elle ne regarde la pièce. Confrontées aux injonctions contradictoires de la société (le devoir archaïque de modestie face à la soif de rencontres), « les femmes sont contraintes à la duplicité et les spectatrices à la mauvaise foi ». Le masque devenant l’instrument de la dissimulation et des apparences trompeuses. Pourtant, même « si elles accèdent au statut de sujet désirant, les spectatrices se voient dénier tout accès à la compréhension, à la critique et à l’interprétation ». Les stéréotypes fleurissent dans les textes, moquant l’ignorance traditionnellement attribuée aux femmes, leur propension à la passion ou leur génie de la dissimulation qui leur font rendre des jugements hypocrites. Disqualifiée dans les comédies anglaises de la Restauration, la réception féminine représentée à l’intérieur des pièces témoigne « de l’établissement de nouveaux rapports, à la fois plus directs et plus conflictuels, entre les spectatrices et les dramaturges ».
« Par rapport aux spectatrices anglaises, émues, séduites, fascinées par la scène, les spectatrices françaises paraissent bien raisonnables ». D’une façon générale, leurs travers se réduisent à quelques « défauts mondains : pruderie, coquetterie, préciosité ». Plus qu’ailleurs, le débat provoqué par l’entrée des femmes dans l’univers de la critique dramatique s’intéresse à « la légitimité du jugement féminin et, à travers elles, la définition de nouvelles formes de réception ». Ce phénomène spécifiquement français, Jean Donneau de Visé (1638-1710) l’observe lorsqu’il constate le nombre de dames faisant « profession ouverte de voir tous les beaux ouvrages, d’en juger et de protéger leurs auteurs ». Ce « statut d’arbitre culturel » est notamment le fruit d’une plus grande liberté des « femmes françaises » et de leur expertise dans l’art de la conversation. Le premier personnage à représenter le goût des femmes pour le théâtre est Sestiane. Ce personnage des Visionnaires (1637) de Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1676) voue au théâtre une passion excessive et désordonnée tout en en connaissant parfaitement les règles. D’autres suivront, généralement figurées en coquettes, précieuses ou femmes savantes. Elles incarnent l’émergence d’une critique galante. Une critique mondaine « guidée par la sensibilité plus que par l’entendement » et qui s’élabore dans le cadre d’une « activité publique… où les exigences de la comédie sociale l’emportent souvent sur l’évaluation effective de l’œuvre », disent les savants. Ces derniers lui opposant la critique traditionnelle élaborée dans l’espace docte d’un cabinet et qui prend appui sur une valeur sûre : la poétique aristotélicienne. Pourtant, beaucoup d’auteurs encouragent l’accès des femmes au champ théorique. Et, même si elle ignore les règles de l’art, ils estiment que la spectatrice se distingue par la liberté qu’elle prend « de juger par elle-même, à partir des impressions que la pièce produit en elle ». Elle invente ainsi « le modèle d’une critique avisée… préférant la langue spirituelle – et parfois mordante – de la conversation au vocabulaire spécialisé du docte ». En définitive, la critique féminine est globalement acceptée en France. En revanche, c’est l’affectation du savoir, « qui n’est souvent que le masque de l’ignorance », qui alimente les satires des dramaturges (les précieuses ridicules de Molière). Raillerie de la pédanterie qui, toutefois, s’applique avec au moins autant de sarcasmes à la population masculine. Finalement, plutôt que « d’opposer les sexes, (il convient de) se nourrir de leur différence », jugent les sages.
Finalement, cette « dimension genrée du débat critique contribue à la promotion du théâtre et de son public féminin ». Elle profite aux femmes qui font entendre leur voix dans des espaces qui « échappent temporairement aux hiérarchies sexuées ». Cette relation d’égalité avec les hommes conduit à ce que « la classe sociale et le niveau de savoir apparaissent comme des signes distinctifs plus déterminants que le sexe dans l’élaboration d’un jugement ». Par exemple, « les travers dénoncés par Molière dans Les Précieuses ridicules et Les Femmes savantes sont plus bourgeois que féminins ». Une spécificité de la réception féminine du théâtre transparaît pourtant à la lecture des textes : « promptes à l’identification, les spectatrices ont tendance à évaluer l’univers fictionnel à l’aune de leur expérience personnelle, en le considérant comme le prolongement de la réalité quotidienne ». Comment aurais-je agi à la place d’Andromaque, s’interroge la Vicomtesse de La Folle Querelle ou la Critique d’Andromaque (1668) d’Adrien-Thomas Perdou de Subligny (1636-1696) ? D’autres pièces représentant des épisodes d’adultères « sollicitent l’implication des spectatrices dans un débat où querelle des femmes et querelle dramatique tendent à se rejoindre ». Cependant, l’aptitude des femmes au jugement reste un lieu commun controversé dans les « comédies de spectateurs » (courtes pièces dans lesquelles des représentants fictionnels du public se livrent à l’examen d’une pièce). Les uns moquant « le ridicule des réactions de pruderie ». Les autres, hôtes réguliers des salons mondains, saluant leur implication dans le débat critique. Ainsi, comme « dans le Panégyrique de l’Ecole des femmes (de Charles Robinet (1608-1698)), chacun est conscient du caractère ludique de la conversation critique, qui exige des désaccords pour être plaisante ». Dans ces joutes échauffées par des hommes, la femme se pose, tour à tour, en autrice aux côtés du poète, en spectatrice et en arbitre du bon goût. « Aux femmes la sociabilité mondaine, aux hommes le statut d’auteur », résume Véronique Lochert. Pour autant, et même si « la fréquentation des théâtres (demeure) pour les femmes un loisir agréable alimentant la conversation de salon », l’expérience théâtrale agit en « instrument d’émancipation sociale ». Notamment lorsque « les auteurs valorisent implicitement l’autonomie de jugement, qui permet à l’individu de dépasser les distinctions de genre et de classe ». A une condition : que le jugement des femmes se cantonne à l’expression de « leur sensibilité naturelle ».
Chapitre V : Paroles de spectatrices
Dans le dernier chapitre de son ouvrage, Véronique Lochert confronte son analyse magistralement éclairante au témoignage des quatre spectatrices que nous avons nommées à l’ouverture de notre chronique. Ces femmes, de culture et d’époque différentes, opposent aux auteurs consultés par Véronique Lochert, l’opinion de quatre « vraies spectatrices qui prennent la plume au sortir de la comédie… ou s’expriment sur le théâtre ». Certes, raconté par des aristocrates instruites, leur récit est loin d’être représentatif du public féminin hétérogène qui se croise dans les théâtres. De même, leur position sociale les conduit à s’exprimer selon les codes de la morale et de la bienséance de leur classe. Pour autant, leur expression jette un regard singulier sur l’expérience théâtrale vécue par une composante de la catégorie féminine.
La fraîcheur et la sensibilité de leurs propos ne peut se résumer dans le cadre de notre chronique. Notre lecteur trouvera, dans l’ouvrage de Véronique Lochert, quatre magnifiques portraits intimes de spectatrices privilégiées. Nous ne donnerons ici qu’un maigre aperçu de la quarantaine de pages qu’elle leur consacre.
La parole est à Isabelle d’Este (1474-1539). « Souvent présentée comme l’incarnation féminine de la Renaissance… elle hérite de son père (Hercule Ier) un goût marqué pour le théâtre, saisi à la fois dans sa dimension textuelle, à travers le travail des éditeurs et des traducteurs, et dans sa dimension spectaculaire, en particulier grâce aux intermèdes conçus pour accompagner les comédies antiques ». A la fois mécène et spectatrice avide du plaisir que procure la représentation théâtrale. Sensible « à la virtuosité spectaculaire » tout en restant très attentive à la rhétorique théâtrale. N’hésitant pas « à attirer les regards sur sa propre personne en produisant un spectacle alternatif à l’ennuyeuse représentation qui se poursuit sur scène ». Isabelle d’Este goûte la scénographie autant que le jeu des comédiens. Adoptant, au besoin, la posture d’une actrice pour mettre en scène sa vertu. Pour autant, elle n’est guère effarouchée par les allusions osées. Il est vrai que « l’impératif moral, qui sera mis en avant par le Contre-Réforme, ne pèse pas encore sur la réception féminine ».
Margaret Cavendish (1623-1673) est « aujourd’hui reconnue comme une figure importante de la pensée et de la littérature anglaise du XVIIème siècle ». Philosophe, essayiste, dramaturge (pièces destinées à la seule lecture), romancière et poète, elle estime que la finalité du théâtre doit viser « la constitution du moi en sujet ». En d’autres termes, méprisant le spectacle commercial (une spectatrice passive achète le plaisir d’un divertissement), elle applaudit le théâtre lorsqu’il devient « l’instrument d’un rapport intime à soi-même ». Lorsqu’il forme la personnalité et que ses effets se prolongent dans la vie quotidienne. A l’inconfort de la salle autant que pour se prémunir contre les risques « d’emprise émotionnelle » provoqués par le pouvoir de séduction de certains acteurs, elle « préfère la liberté et la maîtrise que confèrent la lecture et l’imagination ». Une imagination qui doit prendre « le contrôle du spectacle ». Et si, d’aventure, elle se rend au spectacle (notamment à la représentation des pièces de son mari, William), elle ne se comporte pas en simple spectatrice. Devenant actrice et autrice, elle y affiche sa singularité et s’offre en spectacle, revêtue de costumes excentriques. Grande lectrice, Margaret Cavendish apparaît « comme la première femme critique et comme l’autrice de la première critique portant sur l’œuvre de Shakespeare ». Un théâtre dont elle admire tout particulièrement la finesse des portraits de ses héroïnes. Dramaturge à ses heures, elle adopte un parti pris d’écriture « opposant le naturel à l’artifice des règles ». « J’écris sur mes propres fondations », se plaît-elle à écrire. Fondations qui ignorent délibérément les règles de l’art et laisse libre cours à « la force de l’invention ». Femme et écrivaine, elle affirme son autonomie, dans le domaine littéraire comme dans le champ social. Notamment lorsque, dans ses pièces, elle « ouvre un espace de liberté où les contraintes genrées n’ont plus cours ».
Elizabeth Pepys (1640-1669), épouse du diariste Samuel Pepys (1633-1703), est une « spectatrice plus ordinaire et régulière » que Margaret Cavendish. Dans son journal, son époux enregistre leurs impressions d’après-spectacle. De ces « notations succinctes… se dessine indirectement le portrait d’une spectatrice qui aime le théâtre, exprime ses goûts et manifeste l’indépendance de son jugement ». Souvent, le couple fréquente le théâtre : « un plaisir partagé ». Mais Elizabeth s’y rend également seule, accompagnée de sa servante, de proches ou d’amies. De retour au foyer, le couple prolonge le spectacle dans ses conversations et ses lectures de pièces à voix haute. A cet égard, « le théâtre démontre… son pouvoir d’union sociale ». En toute autonomie, Elizabeth exprime des avis tranchés sur les pièces, leurs représentations et ses comédiens. Jusqu’à donner le nom de son acteur préféré à son chien. D’autant que son jugement critique est soutenu par une solide expérience spectatoriale. Au point de parvenir à débusquer les plagiats. En définitive, « ces maigres traces de l’intense activité de spectatrice d’Elizabeth Pepys montrent combien le jugement critique, échangé et discuté avec les proches, joue un rôle central dans le plaisir pris au théâtre par le public ».

Robert Nanteuil (1623-1678) – Madame de Sévigné, XVIIIème siècle - Gallica, BnF
Notre Madame de Sévigné (1626-1696) ferme la marche. L’importance de sa culture théâtrale « apparaît d’emblée à qui parcourt ses lettres émaillées de citations en vers de Corneille et de références à des scènes de Molière… Vu, lu, récité, appliqué, critiqué, (le théâtre) joue un rôle central dans… son rapport au monde, aux autres et à elle-même ». Elle participe pleinement « à la production de cet enjouement spirituel qui caractérise la société mondaine ». Si elle s’enchante du jeu des comédiens autant que de la fiction dramatique, elle estime surtout que le théâtre « contribue… à la formation de l’esprit des jeunes filles » et en recommande la lecture. Au plaisir de la réception s’ajoute celui du jugement critique. Elle aime à confronter « ses connaissances en matière théâtrale aux émotions produites en elle par le spectacle et ses goûts personnels aux critiques formulées par ses pairs ». D’autant que le théâtre offre l’avantage « d’une réception en plusieurs temps » : avant (lecture donnée par les auteurs), pendant (les émotions ressenties in situ) et après la représentation (à la relecture du texte). Enfin, observatrice de la vie sociale, c’est particulièrement de sa fréquentation de Molière qu’elle tient son habileté à relier la réalité et la fiction afin de « saisir la nature humaine dans toute sa vérité ». Ce « trait caractéristique de la réception féminine » lui permet de considérer « la vie avec la distance amusée d’une spectatrice de comédie ». Lui inspirant autant de bons mots que de parallèles dramaturgiques entre la scène et la société.
De ces quatre portraits de spectatrices et d’autrices, Véronique Lochert dégage plusieurs constats. Certains ouvrent de véritables perspectives de recherche. D’abord, ces femmes contestent les images stéréotypées de la spectatrice vulnérable et influençable. Chez ces aristocrates, « plaisir du texte et plaisir du spectacle s’unissent » pour nourrir un jugement critique autonome « sur l’appréciation de la qualité de la pièce et le jeu des comédiens ». Ensuite, la réception féminine se positionne à la croisée des chemins vers soi (l’expérience individuelle d’une personnalité singulière) et vers les autres (l’expression de l’appartenance à un groupe qui se réalise dans l’exercice de la conversation familiale ou mondaine). Enfin, « la fréquentation des œuvres dramatiques (ouvre) un accès à la vie culturelle publique ». En somme, le théâtre est un levier d’émancipation des femmes lorsqu’il est employé comme « instrument d’expression de soi et… (d’)appui dans leur quête d’autonomie ».
Conclusion : La spectatrice émancipée ?
De toute évidence, « les spectatrices jouent un rôle actif dans la réception du théâtre ». Mieux encore. Les femmes y exercent un véritable pouvoir. Celles qui remplissent des fonctions d’autorité, comme les reines, « jouent un rôle déterminant dans la circulation des pratiques artistiques… (et) contribuent à la légitimation sociale et culturelle de l’art dramatique ». Les actrices, pour leur part, « offrent aux spectatrices l’exemple réel d’une réussite féminine… (non sans violer) ouvertement toutes les règles de comportement prescrites aux femmes dans la société ». Pour sa part, le public féminin populaire, notamment espagnol ou anglais, parvient à faire entendre sa voix pour imposer ses choix aux auteurs et acteurs intéressés à plaire. En fin de compte, une autorité croissante est reconnue aux spectatrices, entraînant une féminisation du goût. De fait, dans les structures patriarcales d’alors, « des femmes de toutes conditions sortent de l’espace domestique où certains voudraient les enfermer et prennent part à une expérience publique collective ». Au grand dam des moralistes, des religieux et des politiques qui en viennent à condamner le caractère subversif du spectacle.
Cette expérience théâtrale peut être observée de deux points de vue différents. Le premier se penche sur les intentions des auteurs. Le second, largement développé dans l’ouvrage de Véronique Lochert, s’intéresse à ce que « ressentent et (ce) que pensent les spectatrices devant les intrigues et les personnages incarnés sur scène ». Ainsi le théâtre ouvre-t-il un espace de débat qui finira par donner naissance à une critique spécifiquement féminine. Un espace dans lequel la spectatrice exerce sa liberté, repousse les limites qui lui sont assignées. Pour cela, « le théâtre est sans doute l’un des espaces de la société les moins soumis aux normes genrées qui règlent les comportements des hommes et des femmes ». Son pouvoir d’attraction s’exerce d’autant plus fortement qu’il offre aux spectatrices un triple plaisir : « le plaisir social de la sortie au théâtre », « le plaisir procuré par la fiction dramatique et la représentation scénique », enfin, « le plaisir de la conversation critique ».
Au fil de notre lecture, nous nous sommes forgé une conviction : Voulez-vous comprendre une œuvre ? Alors n’oubliez pas de regarder du côté de son public. A longueur de pages, avec finesse et précision, Véronique Lochert démonte patiemment le mécanisme de la dialectique de l’expérience théâtrale. Quiconque entend transcender le plaisir immédiat d’une représentation (théâtre, musique ou danse) trouvera dans cet ouvrage une multitude de clés. Elles lui ouvriront des horizons qui l’éclaireront sur la manière de comprendre pourquoi et comment une œuvre devient le fruit d’une large coproduction à laquelle toutes les catégories composant le public prennent leur part.
Le caractère remarquable de cet ouvrage tient à la radiographie qu’il réalise d’un public en mouvement. Particulièrement de sa composante féminine. Et l’enjeu est de taille. Car, durant cette première modernité, la femme est soumise à un jeu de contraintes l’enfermant dans un statut de minorité juridique. Moralistes, religieux, politiques s’attachent à lui prescrire des normes de comportement et lui imposent des modèles de conduite. Or, la fiction théâtrale lui décrit un autre monde possible. Un monde imaginé qui finira par se dresser contre l’ordre moral et social. A ce titre, Véronique Lochert fait œuvre d’historienne. En effet, la dynamique de ses chapitres engage son lecteur à traverser successivement les champs de l’esthétique, de l’éthique et du sociétal.
Autre particularité marquante à saluer. L’autrice ne se place guère du point de vue de l’émetteur (l’auteur, la pièce, sa représentation) mais privilégie une approche par le récepteur (les effets produits et les phénomènes sociaux qu’ils alimentent). Une démarche innovante qui mériterait d’être appliquée à l’étude de la composante masculine. Car, même si le théâtre est un domaine sous emprise masculine, il n’existe pas, à notre connaissance, d’étude comparable sur la thématique de la réception masculine.
Enfin, l’excellence de cet essai réside dans son accessibilité. Chaque développement théorique repose sur un nombre imposant d’exemples et de notes de bas de page qui en éclairent l’éventuelle complexité. Anecdotes, citations ou faits historiques constituent autant de balises dans ce texte qui a tout d’une production académique. A partir d’une masse impressionnante de données textuelles, Véronique Lochert dessine des portraits de spectatrices à la fois réalistes et analytiques. Plongés dans la lecture de son essai, nous finissons par ressentir leurs émotions, nous joindre à leurs conversations, les accompagner dans l’épreuve de leur émancipation.
Un ouvrage indispensable. Quoi dire de plus ?