La voix du public en France aux XVIIème et XVIIIème siècles
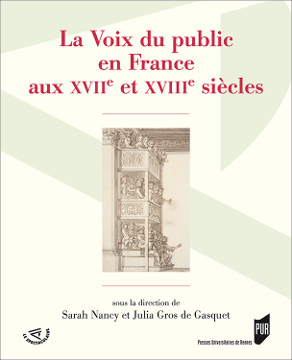 ©
© Afficher les détails Masquer les détails Auteurs
- La voix du public en France aux XVIIème et XVIIIème siècles
- Ouvrage collectif sous la direction de Sarah Nancy et Julia Gros de Gasquet
- Sarah Nancy, Introduction
- 1. Diversité des voix, diversité des lieux - Sophie Marchand : Du « plaisant parterre » à « l’orateur de parterre ». L’anecdote dramatique comme scène de la voix publique - Judith Le Blanc : « Quand le Français ne rit pas, il faut toujours qu’il chante ». Manifestations de la voix chantée du spectateur parisien au XVIIIème siècle - Jennifer Ruimi : « Ridere regnare est ». Les parades ou le devoir de rire - Raphaëlle Legrand : Sifflets, battoirs, rumeurs et clabauderies. Les sons du public à la Comédie-Italienne
- 2. Polémiques, querelles, transgressions - Christian Biet : Le lieu théâtral, le bruit des langues et le brouhaha des corps - François Lecercle : «Oh my husband, my husband ! ». Le cri de la spectatrice et le dérèglement de la mécanique pathétique - Erik Leborgne : Le Vénitien à Paris. Casanova à l’Opéra - Anne Surgers : « Va, pensiero ». Mémoire et difficiles éclats actuels de la voix du public
- 3. Perception, intériorité, conscience critique - Théodora Psychoyou : Son, bruit, musique. Charles Perrault et l’approche réflexive de la perception auditive - Myriam Dufour-Maître : La voix de l’admiration. Le théâtre du « vieux Corneille » et l’éclat du public - Eve-Marie Rollinat-Levasseur : Les spectateurs de Molière. Du brouillage des voix à l’art de faire du buzz - Anne Régent-Suzini : Un anti-théâtre ? Prédication et voix du public - Nathalie Kremer : Entre la vue et l’ouïe. La continuité créative de l’œuvre dans le théâtre de Diderot
- 4. Poétique et politique - Hélène Merlin-Kajman : Voix publique et voix du public. Le cas de la querelle du Cid - Laura Naudeix : Risques et enjeux de la mise en scène du public dans la Muse historique de Loret - Brice Tabeling : La voix privée du public - Fabien Cavaillé : Du théâtre comme parlement. La voix unanime du public écoutée par les théoriciens du XVIIIème siècle - Christine Hammann : Rousseau et l’ « applaudissement universel »
- 5. Se ressouvenir du son : restitution, inspiration - Mylène Pardoen : Une machine à sons pour restituer l’Histoire ? Réflexions à partir du projet Bretez - Anne Duprat : La Clorise arrêtée. Voix publique et voix du public dans le Cyrano de Bergerac (1897) de Rostand - Propos réunis par Julia Gros de Gasquet : « Comment et pourquoi se ressouvenir des sons de la salle ? » Points de vue de Xavier Bisaro, Bénédicte Louvat et Marie-Madeleine Mervant-Roux - Alexandre Markeas - Logis et Phônè, pièce pour quatuor d’euphoniums avec le Quatuor Opus 333 : V. Desplantes, P. Wibart, C. Morvan et J. Daufresne
- Sarah Nancy : En guise de conclusion – La « voix du public » et les sons du passé
- Bibliographie - Index - Les auteurs
Édition
- Presses universitaires de Rennes - 2019. Collection Le Spectaculaire, série Arts de la scène
Ils ont inventé le théâtre participatif« Les codes de civilité théâtrale actuels supposent que les spectateurs restent assis, silencieux, et attendent la fin du spectacle pour manifester leurs émotions », schématise le sociologue Dominique Pasquier (Spectateurs de théâtre : l’apprentissage d’un rôle social, 2016).

Un maintien aux antipodes de « l’expérience des spectacles » telle que la pratiquaient les théâtrophiles et mélomanes. Du moins ceux qui personnifient la voix du public en France aux XVIIème et XVIIIème siècles. Voix plurielles que scrutent minutieusement Sarah Nancy et Julia de Gasquet ainsi que leurs vingt-deux contributeurs. Les co-rédacteurs de cet ouvrage collectif représentent essentiellement les milieux du théâtre et de la littérature. Quelques musiciens ou musicologues leur viennent en appui. Mais aucun historien ni chercheur dans le domaine des sciences de l’homme et de la société ne figure dans la liste des auteurs.
Pour autant, chacun des chapitres se lit avec l’enthousiasme de la découverte. Car, en adoptant la position d’observateurs des spectateurs, les auteurs inversent, en quelque sorte, l’ordre du rituel scénographique. Davantage qu’au jeu des acteurs, c’est sur les réactions du public que se concentrent leurs expertises respectives. Il en résulte un ouvrage dont le contenu copieux est relayé par un solide appareil de notes de bas de page et une bibliographie méthodique ouvrant de multiples horizons aux travaux d’approfondissement ou d’explorations complémentaires. Sa lecture enrichissante est servie par cette typographie engageante qui caractérise les publications des Presses Universitaires de Rennes (PUR).
La richesse des informations contenues dans ce volume et l’originalité de l’approche qui a présidé à sa rédaction nous engagent à partager ici les grandes lignes de son contenu. Pour de plus amples développements et savourer la profusion d’exemples qu’il renferme, nous encourageons vivement notre lecteur à consulter les 332 pages de cet opulent ouvrage.
D’emblée, Sarah Nancy se soumet à l’exercice délicat de la motion de synthèse. Dès les premières lignes de son introduction, le projet est clairement énoncé : répertorier les manifestations de « l’instance spectatrice », les analyser et en saisir les enjeux. Bravant l’absence d’archives sonores, c’est par le canal indirect des représentations écrites que les contributeurs capteront l’écho des voix du passé. Ayant établi une corrélation entre la parole sur scène et les répliques qu’elle suscite dans la salle, ils examineront comment ces interférences finissent par construire l’identité du spectateur et son rapport aux autres. Si l’interaction salle/scène est parfois sollicitée (les pièces « à la muette » des Forains), il arrive qu’elle enjambe hardiment le « quatrième mur » de Denis Diderot (1713-1784), ce « grand mur » imaginaire qui sépare la salle de la scène. Une forme de rapport de force s’établit lorsque cette parole transgressive se déverse sur la scène. Si la relation conflictuelle oppose les spectateurs aux acteurs, elle divise également la salle elle-même, déchirant le parterre, le parquet et les loges. Le théâtre imagine alors diverses parades. En organisant l’espace séparant le spectateur du plateau (la salle à l’italienne). En s’efforçant de guider le comportement du public (spectacle conçu comme célébration du régime). Même en modélisant le comportement idéal du spectateur. Peu à peu, apparaissent des concepts tels que cette « voix unanime » qui « mise sur le silence ou l’unisson de la salle ». Cependant, au même titre que les assemblées religieuses, la nature hétérogène du public des théâtres et des opéras reste une constante. C’est pourquoi les voix dissidentes continueront de s’y exprimer. A l’image des sociétés humaines, elles reflètent les subtiles nuances du langage qui s’échelonnent entre les deux pôles aristotéliciens de la phônè (l’expression spontanée des émotions) et du logos (le langage citoyen de la raison). Finalement, grâce à son « potentiel participatif », le lieu du spectacle devient un espace politique d’apprentissage « des différentes manières d’être spectateur ou spectatrice et (des) différentes manières d’être ensemble ».
1. Diversité des voix, diversité des lieux

« Images » XVIIIème siècle : le couronnement de Voltaire © BNF Gallica)
Le public du XXIème siècle serait décontenancé. Car, à l’âge classique, le spectateur fréquente le théâtre et l’opéra « autant pour être vu que pour voir ». Il est donc « naturel d’y parler autant que d’écouter ». De fait, « penser le spectacle, c’est, au XVIIIème siècle, penser la relation qui s’établit entre l’œuvre et son récepteur », résume Sophie Marchand. Loin de constituer une anomalie, la voix du public est consubstantielle à l’œuvre artistique. Elle se révèle même utile lorsqu’elle renseigne l’auteur sur l’effet qu’elle produit. En fin de compte, c’est la voix du public qui détermine la valeur de l’œuvre. A l’appui d’éloquents exemples, Sophie Marchand esquisse une passionnante « typologie des parleurs ». Passons sur les « turbulents du parterre » qui s’épanouissent dans la perturbation. Plus intéressants, les « critiques du parterre » expriment généralement la « voix du bon sens ». S’ils obtiennent souvent des acteurs la rectification de la fiction, ils prétendent surtout « rendre raison à un public maltraité par une œuvre indigne de lui ». Quant au « plaisant du parterre », il se renvoie ou renvoie aux autres « l’image de (sa) supériorité intellectuelle et spirituelle ». Par ses mots d’esprits, il « détourne à son profit le dispositif spectaculaire et se fait applaudir sur la scène de l’esprit ». Lorsque le plaisant du parterre énonce « ce que les autres pensent tout bas », il parvient à renverser le rapport de force. Jusqu’à déplacer le spectacle sur le terrain de la politique. Peu à peu, le parterre (« c’est-à-dire la partie du public la plus nombreuse et la plus informe, la plus mobile, partant la plus dangereuse aux yeux des autorités ») se forge une « conscience identitaire » antagoniste de celle des loges fréquentées par une population privilégiée. Surtout à partir du XVIIIème siècle, il devient « l’important du parterre » en prenant conscience de l’étendue de son pouvoir depuis que « c’est le parterre seul qui décide du sort d’une pièce » (Friedrich Melchior Grimm - 1723-1807). Au point qu’auteurs et acteurs multiplient les efforts pour capter sa bienveillance ou canaliser son énergie. Voilà comment « la collectivité spectatrice (est) transmuée en opinion publique ».
Si les uns s’expriment en paroles « parlées », d’autres optent pour la parole chantée. Judith Le Blanc établit que la « participation chantée, loin d’être anecdotique, peut s’inscrire dans la dramaturgie même des œuvres ». Cela s’entend lorsque certaines catégories d’acteurs sont contraintes au silence par des institutions alléguant leurs monopoles (la Comédie-Française ou l’Académie royale de musique). Comme ces Forains qui inventent les pièces « à la muette ». Dans cette « sorte de karaoké avant l’heure », l’orchestre donne le ton au public qui chantera lui-même des parodies d’opéras dont les paroles défilent sur des écriteaux. Le public est totalement immergé dans le processus créatif. Durant ces mêmes Foires annuelles, un autre genre remporte un tel succès que différents théâtres s’en saisiront: la dramaturgie en vaudevilles. Particulièrement au moment du vaudeville final, les spectateurs sont encouragés à se saisir de vers-refrains souvent choisis dans « le best of des airs les mieux connus du public ». Ainsi, « le spectacle se propage… de la scène à la salle et de la salle à la rue ». La quasi-totalité de ces « airs-vaudevilles d’opéra » est prélevée dans des passages confiés aux chœurs. Jean-Baptiste Lully (1632-1687), déjà, ménageait « des espaces de participation chantante à l’intérieur même du dispositif théâtral ». En contrepoint de « l’autre lieu de chant par excellence qu’est l’église », le public de l’opéra se transforme alors en « communauté chantante ». Désormais, « le succès d’un opéra se mesure… à l’aune de sa capacité à faire participer le parterre ». Cette tendance influe forcément sur l’écriture poétique et musicale. Car il convient de veiller à « la qualité mnémotechnique de l’air » ainsi qu’à « l’alternance entre une musique simple, facile à chanter, et d’autres passages plus complexes ». Certes, cette « participation voulue et attendue » n’empêche pas quelques « interventions intempestives d’un public parasite ». Tel le spectateur qui chante en même temps que le soliste. Ou ces bouffées d’enthousiasme déclenchées pour saluer la présence d’un spectateur prestigieux. Si, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, la participation chantante du public se perpétue, notamment dans les comédies mêlées d’ariettes, le public est moins enclin à chanter. Ce nouveau rapport à l’opéra s’explique autant par l’inflexion sentimentale qui s’opère alors dans la société que par l’évolution des conditions matérielles d’écoute. Car, « n’est-on pas plus passif et donc moins chantant assis que debout ? ».
Après la chanson, place au rire dans tous ses éclats. Au XVIIIème siècle, alors que « la franche gaieté… a déserté les scènes officielles, (elle) retrouve… toute sa place dans les salons ». Particulièrement dans un registre caractérisé par « un comique bas, grossier (qui) parvient à provoquer un rire énorme, déréglé, mais salutaire » : la parade de société. S’il déchaîne inéluctablement des rires gras, ce genre littéraire dérivé du théâtre révèle objectivement la dégradation morale d’une certaine élite. Dans ce chapitre lumineux, Jennifer Ruimi trace les contours psychologiques de son public. Qu’il égaye le badaud des Foires ou qu’il régale les invités des salons mondains, l’humour de connivence constitue « le ciment de la communauté qui se réunit devant (ce) spectacle ». Toutefois, le rapport au rire indécent diffère selon le sexe. S’il émoustille volontiers les hommes, il incline les femmes à rire « sous cape » aux « mots à double entente, grossiers ou (aux) équivoques scabreuses ». Hormis son caractère parfois licencieux, la mise en scène des personnages peut également alimenter un « rire de classe ». Celui-ci fleurit sur différents stéréotypes tels le parler populaire ou l’immoralité supposée des gens de basse condition. Une population avec laquelle l’élite n’hésite pourtant pas à frayer durant ses « escapades à la Foire ». Elle s’y amuse à « rire librement devant des spectacles condamnables d’un point de vue moral et esthétique ». Cette promiscuité inspire d’ailleurs des « effets de disconvenance burlesque en acte » dont le « caractère carnavalesque » résulte, par exemple, de travestissements (le comte de Clermont grimé en marchande criarde). Mais ne nous y trompons pas. Sa légèreté agit comme le révélateur de tensions sociales qui agitent la seconde moitié du XVIIIème siècle. Car, on rit d’abord pour contester « l’ordre esthétique établi » et se réfugier dans « un espace sans ordre ni raison ». Ensuite, on rit pour « masquer l’angoisse » que provoque « un univers policé et raffiné ». Un univers essentiellement féminin dans lequel l’homme est contraint « de… prouver sa virilité ». Par le « renversement burlesque », la parade provoque alors un « rire régressif » aux vertus compensatrices. Enfin, on rit parce que le rire est bon pour la santé. Elle guérirait même de l’infortune si l’on en croit la devise latine placée en exergue du chapitre : Ridere regnare est (Rire c’est régner). Pour mémoire, cette formule figure sur une médaille satirique frappée vers 1721 pour moquer la banqueroute de John Law (1671-1729).
Parler. Chanter. Rire. Mais aussi émettre quantités de « bruits ». Raphaëlle Legrand dresse une étonnante typologie « de l’expression sonore d’individus isolés ou d’une collectivité unanime ou divisée » qui interfère avec la représentation théâtrale. Car, précise-t-elle d’emblée, réduire le public exclusivement masculin du parterre au silence relève d’une chimère. « La station debout, la bousculade de centaines de personnes agitées de mouvements divers, les discussions entre voisins occasionnelles, les cabales ou les tumultes réprimés par les soldats affectés à la police des théâtres sont autant de distractions générant une écoute participative et effervescente, une invite à entamer le dialogue avec les actrices et les acteurs, à se mettre en scène en tant que public devenu à son tour un spectacle pour le loges ». Quels sons se font entendre ? Jennifer Ruimi nous avait déjà familiarisés avec la participation chantante. Or, celle-ci s’accompagne souvent d’une « participation percussive » lorsque « les amateurs du parterre frappaient la cadence du pied ou de la canne (munie à l’époque d’un bout ferré) ». Quant à la « critique interruptive », elle bénéficie d’une large palette de modalités pour exprimer « les témoignages sonores d’approbation ou d’improbation ». Les applaudissements, sincères ou rémunérés, matérialisent l’accueil favorable du public, généralement à la fin de la représentation. Au cours du spectacle fusent « les éloges et les railleries ». Si le bravo italien ou le bis latin commandent la reprise d’un morceau apprécié, d’autres « cris et… interpellations » finissent par réduire les interprètes au silence. La « caisse à outil » des « sons inarticulés » est bien plus garnie. Et le sifflet y figure en bonne place. Produit par les lèvres des siffleurs, il est surtout amplifié par la large gamme d’instruments tels que le sifflet de rappel des chiens, le sifflet de marine, le sifflet qu’emploie le chaudronnier pour signaler sa présence sur les marchés ou de petits sifflets en terre. Ce concert de sons prend généralement la direction de la scène. Mais il peut volontiers se retourner vers les loges (au premier rang desquelles sont assises les dames) ou opposer différents groupes du parterre. Si ces réactions sonores saluent les débuts d’actrice ou d’acteurs, elles enveniment également des querelles autour de l’œuvre représentée. A titre d’illustration, les deux pages consacrées à la chute du Prisonnier anglais de Guillaume François Fouques Deshayes Desfontaines (1733-1825) et d’André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813) permettent de mesurer la violence et les effets de ces manifestations sonores. En l’occurrence, elles couronnent ici « le triomphe des censeurs » du parterre.
2. Polémiques, querelles, transgressions
Le parterre turbulent ne manque généralement pas d’imagination pour perturber la séance théâtrale. Trois captivantes pages illustrent d’ailleurs la variété de ces « accidents » survenus à l’Opéra de Paris au début du XVIIIème siècle. En réalité, ce type de comportement nuit autant à la performance des acteurs qu’à la réputation d’un théâtre. Il peut même porter atteinte à l’ordre public. Ce désordre entraîne aussitôt une répression de la part de la police des théâtres et suscite l’édiction de règles de « tranquillité publique » (à commencer par l’Edit royal de 1641). Pour leur part, « les bons citoyens collaborent au lissage des mœurs au sein de la séance,… les bons comédiens aident à la mise en place d’une civilité plus calme… (et) les bons auteurs proposent à la fois des textes dramatiques et des textes théoriques allant dans ce sens». Au cours des XVIIème et XVIIIème siècle, la conjonction de ces efforts permet de tendre vers « une civilité disciplinée » dans l’enceinte des théâtres. Avec précision, Christian Biet démonte les ressorts de cette lente régulation des conduites sociales qu’il nomme, plus loin, « un dressage esthétique et social » des publics des théâtres. La stratégie se déploie en trois temps. D’abord, il faut assigner aux œuvres « un but convenable ». Pour cela, un retour aux sources remémore la « fonction cérémoniale, religieuse et morale » du théâtre antique. Cette référence esthétique étant posée, le public est incité « à se concentrer sur les regardés » pour leur faciliter la tâche. De leur côté, se ralliant au « concept de vraisemblance », auteurs et acteurs s’emploient à ce que les spectateurs voient « non plus des comédiens, mais des personnages, non plus de la performance mais de la représentation ». De même, le jeu des acteurs consistera moins à histrionner qu’à créer, à l’intention du spectateur, « un univers second, un monde « dramatique » virtuel, linéaire et continu » afin de capter son attention permanente. « De préférence en silence et sans désordre ». De même, la « montée en puissance du texte » inverse la relation qu’entretenaient les auteurs et les comédiens. Si les seconds prenaient appui sur texte pour faire applaudir leur propre virtuosité, ils se mettent maintenant au service de la fiction telle que leur auteur l’avait conçue. Ainsi « le théâtre (est-il) devenu de la littérature ». Certes, malgré toutes ces initiatives, bien des pièces resteront longtemps encore « à la merci des accidents de séance ». Cependant, tout au long des XVIIème et XVIIIème siècles, une révolution esthétique, morale et sociale est véritablement en marche. Le théâtre devient peu à peu un lieu fermé, sous contrôle policier et soumis à « des transactions économiques fondées sur le fait que des spectateurs viennent voir un spectacle et non s’assembler pour le seul fait de s’assembler ».
Bien que plus attentif à la fiction et au jeu des acteurs, le spectateur continue d’interagir avec la scène. Contrairement aux croyances en vertu desquelles « les femmes sont censées être la partie la plus émotive du public », le trublion est un homme du parterre. D’emblée, François Lecercle classe ces réactions en trois catégories : « l’interpolation feinte » des « plaisants du parterre » qui exercent leur verve aux dépens d’acteurs défaillants; « la participation affective » d’un spectateur tombé sous le charme d’une actrice ou qui s’émeut des malheurs d’un personnage ; « le saisissement interpellatif » lorsqu’un spectateur se reconnaît dans la fiction. Pour analyser cette dernière situation, François Lecercle expertise deux anecdotes (dont le texte est intégralement reproduit en annexe) exploitées par Thomas Heywood (1575-1641) pour célébrer les vertus morales des représentations théâtrales. A Norfolk et à Amsterdam, deux dames poussent un cri lorsqu’elles se reconnaissent dans le meurtre représenté sur scène et finissent par confesser leur crime. Le dramaturge anglais prend appui sur ces faits divers pour insinuer que l’effet pathétique d’un crime représenté sur scène est bénéfique dans la mesure où il agit en révélateur des consciences coupables. La fiction dramatique accède ainsi au statut « d’accoucheuse de vérité ». Il en déduit que la représentation théâtrale dépasse le statut de simple divertissement. Lieu de révélation de la vérité, le théâtre devient « l’antichambre du tribunal ». Et bien plus encore, suggère-t-il : « le théâtre est un lieu qui relève du sacré ». Car, « sous l’effet de la mécanique affective mise en branle par la représentation, la spectatrice libère sa conscience et se met en règle avec les hommes et avec Dieu ». Il en tire une leçon qu’il suggère sans oser la formuler du fait d’un contexte idéologique hostile aux comédiens : « le théâtre est en concurrence directe avec le temple ». Plus efficace qu’un sermon, « la mécanique pathétique mise en œuvre par la représentation (théâtrale)… pénètre le for intérieur pour y débusquer les secrets coupables. Plus qu’une purgation (la fameuse catharsis), c’est une purification quelle engage ». Au demeurant, les deux exemples montrent que « les femmes ne sont pas plus exposées aux dangers de la représentation mais plus réceptives à ses bienfaits ». « Preuve que le théâtre, loin d’être l’instrument du démon, sert les desseins divins ».
Hormis les femmes, quelques visiteurs étrangers y font également entendre leur voix. Erik Leborgne interroge l’un d’entre eux : Giacomo Casanova (1724-1798). Durant son exil en France (1750), ses relations lui permettent de siéger au « parquet » (« les sept rangées de chaises devant la scène » réservées aux notables) pour assister à des opéras. Durant ces représentations, certains traits du jeu des acteurs déclenchent son rire. Or, son hilarité contraste avec l’émerveillement que suscitent ces mêmes aspects de la part du public autochtone. Certes, l’aventurier vénitien condamne légitimement les approximations des décorateurs qui, lors de la représentation des Fêtes vénitiennes d’Antoine Danchet (1671-1748)/ André Campra (1660-1744), commettent de grossières erreurs dans la cartographie de la place Saint-Marc. Mais en qualifiant de « cri » le « chant » de la célèbre cantatrice Catherine-Nicole Le Maur (1704-1786), il soulève une controverse avec l’entourage de la marquise de Pompadour (1721-1764). La discussion porte alors sur la supériorité qu’il accorde au « récitatif obligé des opéras italiens » sur le « récitatif accompagné de l’opéra français ». De même, il goûte peu les « dépliements/ développements » du danseur-vedette Louis Dupré (1689-1775) quand son ami, au contraire, idolâtre l’artiste et s’émerveille de ses prouesses techniques. Ces différences d’appréciations portent en germes la future Querelle des Bouffons durant laquelle Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) adoptera d’ailleurs des positions proches de celles de Casanova. Les observations critiques, souvent ironiques, enregistrées par le vénitien dans ses Mémoires illustrent ces tensions qui traversent déjà le public : lorsque le rire des uns entend sanctionner les fautes de goût d’une assistance conditionnée, les seconds manifestent leur incompréhension et taxent de mauvaise foi les railleries des premiers. A chaque culture sa vérité artistique !
Cette suite d’exemples montre combien le théâtre est un lieu d’échanges avant d’être un lieu de réception. Car, dans des pages aux riches iconographies, Anne Surgers rappelle que « le silence dans la salle n’est un usage accepté sans discussion que depuis les premières décennies du XXème siècle ». Georges de Scudéry (1601-1667), dans son Apologie du théâtre (1639), en rêvait. Christian Biet nous a précédemment révélé quelques leviers actionnés pour tenter de rendre les « spectateurs dociles et muets ». L’architecture et la scénographie y participent en enrichissant cet arsenal par la conception d’une « disposition des lieux du spectacle » captant davantage l’attention des spectateurs qu’elle ne délie leurs langues. Les réflexions portent d’abord sur le renforcement de « la frontière séparant la scène de la salle ». Séparation matérialisée d’abord par le « cadre de scène » (ouverture de la scène assimilée à l’ébrasement d’une porte ou d’une fenêtre) et, un peu plus tard, son corollaire, le rideau. Ce procédé avait été décrit par Sebastiano Serlio (1475-vers 1554) dans ses ouvrages consacrés à la perspective. Il est mis en œuvre en 1589, à l’occasion de la représentation de La Pellegrina (voir nos chroniques consacrées au concert et à l’enregistrement Stravaganza d’Amore). Ce procédé architectural à l’italienne produit automatiquement deux effets : « limiter la vue des spectateurs et diriger le regard vers le centre de la scène ». En Italie, il guidera le crayon des architectes lorsque l’opera in musica quitte la sphère curiale pour s’épanouir dans des lieux spécifiquement construits. Rien de tel en France. A peine une esquisse éphémère lorsque, en 1641, le cardinal de Richelieu (1585-1642) importe « le modèle italien et son cadre de scène dans la grande salle du Palais Cardinal » (futur Palais-Royal). Un lent mouvement conduit cependant, durant les XVIIIème et XIXème siècles, les aménageurs de salles de spectacles à accentuer « la séparation entre scène et salle ». Séparation poussée à l’extrême lors de la construction du Palais Garnier inauguré en 1875. Au même moment survient « la révolution de Wagner ». Richard Wagner (1813-1883) fixe au concepteur des plans de son Festspielhaus de Bayreuth, l’architecte Otto Brückwald (1841-1904), trois types de contraintes : isoler « chaque spectateur, en lui offrant la possibilité d’une réception individuelle satisfaisante de l’illusion de la scena-quadro » (unité spatiale dans laquelle se déroule la scène) ; accentuer « la séparation scène/ salle par une succession de cadres (et) par la fosse d’orchestre » ; procéder à « l’extinction des lumières dans la salle quand commençait la représentation ». Le rêve de Scudéry se réalisait enfin ! Depuis, les franchissements de « la frontière interdite » du « quatrième mur » resteront exceptionnels. Comme l’envahissement de la scène du Théâtre des Italiens, le 27 décembre 1787, ou la demande pressante du public de l’Opéra de Rome, en mars 2011, ému par la beauté du chœur Va pensiero (Va, pensée) du Nabucco de Guiseppe Verdi (1813-1901).
3. Perception, intériorité, conscience critique
Cris, murmures, sifflets, « bruits » et musiques sont-ils à mettre sur un même plan ? Théodora Psychoyou soumet la question à un scientifique : Claude Perrault (1613-1688). Il y apportera deux types de réponses. Celle du médecin, d’abord, privilégie l’expérimentation comme clé de l’argumentation scientifique. Le « décryptage rationnel » auquel il procède, bouleverse fondamentalement les références musicologiques. En effet, si « l’esthétique musicale du Moyen Age et de la Renaissance… est (fondée) sur le principe mathématique de l’ordre », « le jugement de l’oreille comme critère d’évaluation du beau » gagne maintenant du terrain. Un même objet (le son) croise désormais deux champs disciplinaires majeurs: la science physique étudie le « Son en général » tandis que l’esthétique considère que « la Musique a pour objet le Son en tant qu’il est agréable à l’ouïe », selon les termes employés en 1701 par Joseph Sauveur (1653-1716), titulaire de la première chaire d’Acoustique à l’Académie royale des Sciences. Sur le plan de la physique, les études expérimentales portent sur « les mécanismes de génération, propagation et perception » des sons. Elles débordent même sur la médecine (l’anatomie de l’oreille) ou une discipline que nous nommerions la « psychologie de la perception ». Dans le second tome des Essais de physique (1680) qu’il consacre à l’étude du bruit, il dissocie « bruit et musique et leur confère des significations propres ». Ses travaux novateurs se déploient sur trois axes : les phénomènes vibratoires, la production des bruits, la physiologie et la psychologie de la perception. Et lorsqu’elle examine les objets qui provoquent le bruit, son étude s’intéresse particulièrement aux « propriétés de certaines familles d’instruments de musique : bien évidemment les percussions mais aussi les cordes et instruments à vent, notamment les cuivres ». Lorsque le médecin fréquente l’opéra, d’autres réflexions éclosent. Il les consigne dans une préface (finalement non publié) de son essai De la musique des anciens. En pleine Querelle des Anciens et des Modernes, Claude Perrault entend « démontrer que les Anciens n’ont pas connu l’usage de la polyphonie » et que, par conséquent, la musique Moderne est supérieure à l’Ancienne. Se réflexions sont menées sur le mode du dialogue mondain. Les arguments des uns et des autres sont salués par des rires et des applaudissements. Et si le début du spectacle suspend leur conversation, les protagonistes « ne rompirent (leur silence) que pour se plaindre de la brutalité de la plupart des spectateurs qui faisaient en parlant plus haut qu’auparavant, un bruit effroyable qui empêchait d’entendre les violons ». Ambiance !
En principe, une représentation théâtrale est réputée réussie lorsque l’effet produit sur les spectateurs correspond à l’effet recherché par l’auteur et les acteurs. Mais il arrive que les affects du public contrarient les intentions du dramaturge. Myriam Dufour-Maître en fait la démonstration avec Pierre Corneille (1606-1684). Au faîte de sa gloire, ses pièces soulèvent le « brouhaha » au sens donné par le lexicographe Antoine Furetière (1619-1688) : ce qui « témoigne l’admiration ou l’applaudissement des assistants, quand il (se) trouve (dans le discours ou le spectacle) quelque chose d’éclatant qui touche l’esprit ». D’exclamations en applaudissements, le texte de Corneille est constamment interrompu, scandé par des témoignages sonores d’admiration saluant la beauté des vers, la hardiesse des maximes ou l’habileté des acteurs. L’écoute en souffre tant « que l’on avait toujours le déplaisir d’en perdre une bonne partie, (ce qui contraignait) tout le monde de retourner plusieurs fois au même spectacle pour en recevoir toujours quelque nouvelle satisfaction », regrette François Hédelin surnommé l’abbé d’Aubignac (1604-1676). Espérant le succès, beaucoup d’auteurs indexent leurs textes sur les « transports » prévisibles de leurs publics. Au contraire, Corneille préfère la « chaleur de l’attention » à l’éclat des voix. Il se consacre donc à l’édition de ses œuvres. En parallèle, il compose « un théâtre à écouter » qui prétend diriger l’attention du public sur « le dessein général et la conduite habile de la pièce ». Dans cette révolution stylistique, l’interruption brusque des tirades et l’enchaînement rapide des dialogues « empêchent… le public d’éclater en cris et applaudissements à l’issue de chaque morceau de bravoure. Ce faisant, ils favorisent le suivi de l’intrigue que l’on peut alors complexifier, tout en laissant au spectateur à « achever » mentalement la tirade interrompue. Les beautés ne sont peut-être pas moins nombreuses, mais le public n’a plus loisir d’y répondre, autrement que précisément cette « attention merveilleuse » ». Ces partis pris littéraires conduisent les critiques du « vieux » Corneille à se diviser. Les uns, adeptes du théâtre à voir, observent un public qui « demeura froid et sans émotion » (abbé d’Aubignac). En revanche, ceux qui sont sensibles au théâtre à écouter continuent d’y percevoir « l’éclat des beaux vers ». Tel est le « destin tragique de ces dernières tragédies, jugées « froides », au moment où Corneille demeure pour le public le poète de l’enthousiasme ».
Tandis que Corneille s’essaye à civiliser les réactions du public, Molière (1622-1673) les encourage, les capte puis y trempe sa plume. En entrepreneur de spectacles, non content de provoquer le rire pendant les représentations, le comédien compte sur « le retentissement que (celles-ci) donnent à la pièce dans « toutes les maisons de Paris » ». Eve-Marie Rollinat-Levasseur examine l’usage que fait Molière des bruits « que suscitaient les représentations de ses pièces ». Il écoute en permanence « les propos qui fusent », épie les attitudes du public, déchiffre les interactions sociales, par exemple entre le parterre et les loges (voir la scène 5 de La Critique de l’Ecole des Femmes). Lorsqu’il ne les transpose pas sur scène (voir l’Acte I, scène 1 des Fâcheux), les observations collectées lui fournissent un matériau de choix pour construire le profil psychologique de certains de ses personnages. Ainsi, les informations qu’il collecte se déplacent-elles de la salle à la scène puis retournent dans la salle pour faire rire aux dépens de ses critiques. Ce faisant, Molière fait « pleinement du théâtre un théâtre social ». Mais, précise Eve-Marie Rollinat-Levasseur, si le rire constitue pour l’auteur un indicateur de succès de ses pièces, il n’a pas véritablement de « portée très subversive sur le plan politique », même s’il « ridiculise cette partie du public (= certains courtisans) qui donnerait trop de la voix ». Il n’en reste pas moins que l’auteur tend un miroir à son public. Lorsque celui-ci s’y reconnaît ou y devine certaines catégories du public qui l’environne, un effet de brouillage social se produit en raison de l’apparence de réalité qui se dégage de la scène (lorsqu’Uranie dénonce la pudeur feinte de certaines dames dans la scène 3 de La Critique de l’Ecole des femmes). Ainsi, « la voix du spectateur précède celle de l’auteur tout en la suivant, comme dans une spirale sans fin ». Pourtant, « des tensions peuvent… apparaître entre le concert des voix et les voix intérieures ». La réception du Bourgeois gentilhomme en offre un exemple éclairant : parce que le roi n’a pas ri à la première représentation, certains courtisans s’autorisent à dénigrer la pièce. Il se trouve qu’à la seconde représentation, le roi a félicité l’auteur. Cette scène, parmi de nombreux autres exemples, révèle l’écart qui peut apparaître entre « le goût personnel et le sentiment affiché ». Cette « ambivalence chez le spectateur » invite à la prudence dans l’examen des témoignages d’époque.
Pour rencontrer un public docile et silencieux, faut-il pousser la porte des églises ? Pas forcément, préviens Anne Régent-Susini. Il est vrai que, pour souligner l’effet prétendument efficient de leurs sermons, les prédicateurs se plaisent à donner à voir « un public abîmé dans l’écoute, pur réceptacle de la parole proférée ». En réalité, malgré la rareté des sources, le « public sermonnaire » réagit aux paroles proférées et, plus encore, aux « perspectives eschatologiques » qu’elles ouvrent. L’ampleur du sujet et ses multiples prolongements contraignent Anne Régent-Susini à circonscrire son étude aux réactions des auditeurs populaires des sermons de mission intérieure (opérations menées pour répandre l’orthodoxie romaine jusque dans les campagnes françaises). Plusieurs types de voix s’y font entendre. La voix individuelle de la pénitente « possédée » (« programmée, ou du moins récupérée, par le discours missionnaire ») interrompant le cours de la cérémonie pour implorer le pardon. Ou, à l’opposée, la voix collective commandée et mise en scène par le prédicateur qui fait crier des formules quasi-liturgiques (« Miséricorde à Dieu » dans l’exemple cité). La « contagion vertueuse » matérialise une forme plus complexe encore d’expression des fidèles. En l’occurrence, « l’énergie salutaire des paroles du prédicateur » provoque « un entraînement imitatif » proche des « possessions passionnelles qui pouvaient s’opérer au théâtre ». Même si, à l’église, elles sont davantage contrôlées. De cet état de « communion pathétique » jaillissent des propos articulés. Mais aussi des manifestations non verbales telles que les gémissements et les sanglots. Jusqu’à ces « manifestations corporelles à la fois violentes et codées (se frapper la poitrine, se jeter à genoux) ». Certains de ces comportements démonstratifs finissent même par mettre un terme prématuré à l’homélie. Finalement, « c’est le corps de l’auditeur tout entier, et pas seulement sa bouche, qui devient une caisse de résonance des effets de la parole sacrée ». Cela, en parfaite concordance avec les orientations du Concile de Trente insistant « conjointement sur la revalorisation de la prédication et sur la nécessité d’un conditionnement corporel plus rigoureux des auditeurs ». Les séquences dévolues aux larmes appellent cependant un examen critique. Car les larmes appartiennent à un arsenal « narratif et rhétorique » multiséculaire. « Révélatrices ultimes de l’émotion intime » pour les Anciens, les pleurs sont censés laver l’âme du pénitent et cimenter l’unisson de la communauté (au même titre que le chant) pour l’Eglise. Hormis leur caractère rhétorique, « les manifestations lacrymales » interrogent également sur leur authenticité. D’autant qu’elles « ne valent que le temps de la représentation. De fait, le XVIIIème siècle verra, en France du moins, s’affirmer progressivement le triomphe d’une dévotion « bourgeoise », intériorisée et contenue, dans laquelle la « voix du public » n’aura plus guère sa place ». Dans les dernières pages de sa foisonnante contribution (dont nous ne donnons ici qu’un maigre aperçu), Anne Régent-Susini ouvre de multiples pistes de recherche. Notamment lorsqu’elle s’interroge sur l’histoire du « délicat partage entre intime et public » dans l’extériorisation et la symbolique de la piété.
Finalement, c’est au théâtre que nous trouverons ce « public qui soupire en silence ». Du moins, dans le théâtre tel que le conçoit Denis Diderot (1713-1784). De fait, explique Nathalie Kremer, en réinventant l’art dramatique, le philosophe « fait apparaître un nouveau type de spectateur, qu’on peut appeler un « être sentant » (et) dont le jugement découle davantage d’une écoute intérieure que d’une perception rationalisante ». Les réactions de ce public sont toutefois contrastées : « au silence de l’ennui de la foule mondaine s’oppose le silence de l’émotion de quelques « âmes sensibles » ». Malgré les critiques, c’est à cette seconde catégorie que Diderot entend destiner son théâtre. Particulièrement à partir de l’expérience qu’il tente avec son drame bourgeois, Le Fils Naturel (1757). Le caractère novateur de son écriture opère alors une distinction « entre le langage audible des vers prononcés et le langage invisible de l’impression qu’elle fait dans l’âme du spectateur ». Le public qui applaudit ne l’intéresse guère. C’est au « nouveau spectateur » qu’il veut s’adresser. A celui qui est capable d’entendre la petite « voix invisible » de l’œuvre. Oubliés les personnages qui frappent par leurs contrastes ou de « beaux vers » soulevant un enthousiasme éphémère. Seul le « langage immatériel » de l’œuvre permet, selon lui, de discerner sa « continuité créative ». Par « le silence profond du spectateur transporté, ému profondément par le spectacle », celui-ci devient « co-auteur de l’œuvre pour la réaliser pleinement ». En s’adressant à l’élite du public capable d’entendre le « langage invisible de l’œuvre », Diderot façonne une nouvelle catégorie de spectateur. Un public passif, silencieux, à l’écoute. Un public qui n’applaudit ni ne commente. Mais un public « sentant » dont la sensibilité résonne à « la continuité créative » de l’œuvre.
4. Poétique et politique
Lorsque Corneille se tourne vers l’édition, « le bruit de la salle sort dans la rue ». La voix du public devient polyphonie, mêlant les manifestations des spectateurs (ceux qui voient et entendent) aux commentaires des critiques en cabinet (ceux qui lisent). Ajoutons-y les interactions entre spectateurs, selon qu’ils fréquentent le parterre ou les galeries, ainsi que les interventions officielles d’une Académie Française aux ordres de Richelieu. Voici fixée la batterie des réactions qui attisent la querelle du Cid (1636). Hélène Merlin-Kajman passe en revue chacune de ces voix discordantes. Celle du peuple que l’adage vox populi, vox dei érige en juge souverain. Un juge qui, en l’occurrence, frémit d’enthousiasme (Chimène aime Rodrigue bien qu’il ait assassiné son père) mais aussi d’horreur (son devoir lui impose de tuer son amant). Particulièrement les femmes qui s’identifient à Rodrigue et les hommes qui s’éprennent de Chimène. Mais la critique s’empresse de disqualifier les femmes en les assimilant au peuple d’un parterre trop « sensible aux simulacres ». Elle se rit également des spectateurs fortunés qui inaugurent, avec le Cid, l’usage de prendre place sur la scène pour « se rapprocher de la fiction, d’y participer érotiquement ». Du fond de leurs cabinets, Georges de Scudéry (« l’adversaire acharné de Corneille pendant la querelle ») ou Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654) différencient le public en opposant l’unanimité de la voix de l’émotion du public (celle qui conforte Corneille) à la voix de la raison du lecteur (celle des censeurs). Cette dernière se manifeste par le canal de l’imprimé (gazettes et autres libelles) et bénéficie, de fait, d’une diffusion bien plus large que les applaudissements d’un soir. Finalement, la critique de cabinet prétend exercer une mission pédagogique : « former le jugement (des honnêtes gens) en introduisant dans leur regard le point de vue de la raison poétique… Il faut assister au spectacle « informé » par le livre pour ne pas se laisser « préoccuper » par le spectacle ». Et peut-être, à terme, réconcilier « la voix commune des honnêtes gens » avec les acclamations d’un parterre mieux éclairé. Au point de dépasser les querelles pour revenir aux sources du théâtre grec considéré comme « une fête collective identitaire » ?
Pour autant, la critique est-elle toujours objective ? Probablement pas, conclut Laura Naudeix à la lecture de la Muse historique de Jean Loret (vers 1600-1665). Dans sa « gazette en vers » destinée à sa protectrice, Marie de Longueville (1625-1709), il rend compte des fêtes et spectacles auxquels il est convié. Etant redevable envers ses hôtes ou ses commanditaires, « sa muse est plus « doucereuse » que « critique », selon ses propres aveux. Ses chroniques en vers livrent cependant quelques informations sur les réactions du public. Laura Naudeix en esquisse d’emblée une typologie graduée : de « la satisfaction muette mais éloquente » aux expressions du contentement (le rire, les applaudissements, les exclamations de louanges). Par quelques vers judicieusement choisis, chacune de ces nuances comportementales est associée à un contexte. Souvent celui d’un public mondain « programmé socialement ». D’une façon générale, Loret accorde plus de crédit à la « voix » individuelle qu’à celle « du tout-venant ». A fortiori en ces lendemains de la Fronde. A ses yeux, cette « voix vraiment collective est inquiétante car indistincte, ce qui représente une menace. Ainsi, il prend toujours en mauvaise part le mot « murmure », qui traduit, pour lui, un bruit confus et menaçant qu’il n’associe jamais » au « brouhaha » admiratif de Furetière. Ses relations en vers éclairent la civilité du spectateur mondain. Loin du « murmure » signifiant la confusion, le « silence » exprime « une marque d’adhésion particulièrement fine » tandis que la « contenance muette témoigne de la satisfaction ». « Une attention toute silencieuse » signe donc la réussite de la représentation. A peine mentionne-t-il des « commentaires et bavardages dans la salle » si l’on excepte une mazarinade de 1649. En revanche, il se plaît à rapporter quelques « boutades… émises lors de représentations de ballets, où les interprètes sont des membres de la cour, voire le roi lui-même ». Propos à mettre en relation avec ces curieux « livrets de ballets (qui) s’enrichissent des fameux « vers pour les personnages » confiés au poète Isaac de Benserade (1612 ?-1691)… Il semble possible d’y voir une volonté des organisateurs des ballets tant de perfectionner le divertissement du public, que de contenir sa propension à lancer des plaisanteries durant la représentation ». Et lorsque Loret rapporte la parole du public, « elle vaut comme porteuse de valeurs », tant à propos d’un ballet que d’un Te Deum ou d’une procession. En somme, une voix muselée par l’auteur lui-même. Il transforme ainsi la salle de spectacle « en un îlot plaisant » et unanime et, de fait, « crée… tacitement une pure fiction ».
Fiction que l’emploi de certaines figures de style tendrait à renforcer. Brice Tabeling s’intéresse à l’une d’entre elles : l’hyperbole. Au préalable, il analyse la genèse des « deux conceptions du public et de la voix ». D’une part, le public qui « bourdonne » mais « qui ne fait pas sens, qui est sans sujet et qui est pris dans l’émotion d’un pur présent » (phônè) ; d’autre part, un public moins nombreux mais qui se prononce « au terme d’une discussion collective… qui dure et peut agir » (logos) ». La querelle des Lettres de Guez de Balzac montre que le « bruit inarticulé de la multitude » s’entend également dans la catégorie habitée par le logos. Par exemple, dans l’utilisation de l’hyperbole. Dans ses Lettres à Phyllarque (1627), Jean Goulu (1576-1629) pose ainsi les termes de la controverse qui l’oppose à Balzac à propos de l’usage de cette figure de style. Résumons. L’orateur use de l’hyperbole « pour accentuer l’effet de son propos, pour amplifier une qualité ou un défaut de l’objet qu’il évoque ». Or, cette figure de style « oblige à une forme de laxisme, d’acceptation d’un rapport hésitant entre le mot et sa signification ». Un tel usage peut être toléré sous deux conditions. Premièrement, si l’hyperbole est identifiable. Deuxièmement, s’il est possible de mesurer « une distance supportable du langage par rapport aux réalités de manière à ce que le langage continue de signifier ». Pour Quintilien, la mesure de cette vraisemblance relève du « consensus collectif ». Guez de Balzac bouleverse cet ordre en affirmant que la raison individuelle est suffisante pour juger de la vraisemblance et que « la vraisemblance est plus belle que » la vérité. Nul besoin d’une « instance du public… chargée de déterminer les abus ou non de la figure à partir d’un code de valeurs et d’usages communs ». Désormais, deux voix du public se font face : « d’un côté, le logos de l’honnête homme, de l’autre, la phônè qui produit « des effets de langage qui ne relèvent pas de la signification et se tiennent aux marges du logos ». Tel le stratagème enfantin du marquis qui, à court d’arguments, se met à chantonner à la scène 6 de La Critique de l’Ecole des Femmes de Molière.
Jusque-là, trois « images de l’assemblée des spectateurs » nous ont été projetées : « un modèle consensuel » transcendant les catégories sociales présentes dans la salle ; « un modèle individualiste » dans lequel des réactions isolées jaillissent de la multitude ; « un modèle épidémiologique » qui interprète « les échanges émotionnels comme une communication maladive qui saisirait les personnes indépendamment de leur volonté ». A ces trois catégories, Fabien Cavaillé en ajoute une quatrième, celle de la « voix unanime ». Il en livre une première définition : « c’est d’abord un son qui monte de la salle, non une parole articulée, encore moins un discours ». Elle est donc « phônè plus que logos », dirait Brice Tabeling. Pour affiner la définition, Fabien Cavaillé convoque deux théoriciens. Le premier, l’abbé Jean-Baptiste Du Bos (1670-1742) identifie, dans ses Réflexions critiques sur la poésie et la peinture (1719), deux niveaux de perception de cette voix universelle. La discussion entre individus peut constituer la « manière rationnelle » de parvenir à l’unanimité. Mais la « voix universelle du sentiment » est plus sincère car elle n’est entachée d’aucun « jugement faussé des savants ». Le théâtre devient donc ce lieu où s’entre-communiquent les sentiments des personnes rassemblées : « un corps unique » parlant d’une « voix unanime ». D’ailleurs, écrit-il, « tous les hommes qui jugent par sentiment se trouvent d’accord ». Et même si cette alchimie devait être contrariée par l’esprit de contradiction de certains ou des manœuvres cherchant délibérément « à étouffer la voix commune des spectateurs », l’unanimité finira toujours par l’emporter. Dans son essai Du théâtre (1773), Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) va plus loin. Après avoir érigé la raison et la sensibilité en principes universels, il ouvre le théâtre à tout être doté de raison et de sensibilité. Par conséquent, il faut imaginer de nouveaux espaces dédiés aux spectacles. Des théâtres immenses, à l’image des amphithéâtres antiques. La «voix commune comme voix de l’Humanité » y transformera « le bruit de la salle… en jugement public ». Une étape supplémentaire est franchie lorsque, dans le Discours de réception à l’Académie française (1772) de Pierre-Laurent Buirette de Belloy (1727-1775), « la voix unanime des spectateurs devient une incarnation de la Nation ». Conception à la confluence « de la réflexion contemporaine sur la démocratie… et l’expression de la volonté générale ». Elle s’insinuera dans les débats des Constituants, notamment lorsqu’il sera question de la forme à donner à l’hémicycle parlementaire en s’inspirant de l’architecture des théâtres.
Pour Christine Hammann, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) explore une piste parallèle lorsqu’il s’intéresse à ce phénomène que Corneille appelait « l’applaudissement universel ». Engagé dans la querelle des Bouffons, il prend le contrepied des avis critiques relatifs aux comportements du public français. Un public qui, selon lui, fréquente l’opéra d’abord « pour assister à une performance d’acteur ». Loin d’exercer une « autorité menaçante », le parterre se montrerait plutôt d’une grande docilité. En revanche, il est méprisé par l’Académie royale de musique et peu respecté des artistes. Mais n’est-il pas lui-même « responsable de la médiocrité du spectacle » ? Car ses applaudissements résultent d’une « appréciation… purement intellectuelle, comme est mathématique la musique de Rameau », ironise-t-il. En tout état de cause, loin de « l’expressivité plus spontanée » du public italien. Le polémiste réfléchit également à sa propre expérience de compositeur. Ainsi observe-t-il à la loupe les réactions du public en deux circonstances : d’une part, l’expérience désastreuse d’un concert donné à Lausanne pour lequel, tout jeune homme, « il s’était improvisé compositeur et chef d’orchestre sans en avoir les compétences » ; d’autre part, le succès remporté par son Devin du village (1752). Au fil de la représentation de son opéra, il constate « la fermentation croissante » du public. Terme qui, analyse Christine Hammann, renvoie à « l’excitation interne du public et de la décomposition de ses parties pour former un nouveau corps, uni à celui du compositeur ». Cette fusion devient une « fête collective » dans laquelle « l’applaudissement universel » fonde « l’unité d’un peuple dans une communion à la fois esthétique et spirituelle ». Abolissant la séparation entre scène et salle, unissant le peuple dans un plaisir commun de participation à la festivité, le public se mue en communauté fondée « sur les bases d’une forme d’universalité sensible ».
5. Se ressouvenir du son : restitution, inspiration
Tous les bruits et les sons dont il vient d’être question se sont tus. Définitivement ? Peut-être pas, laisse espérer Mylène Pardoen. Car, avec le projet Bretez, la technologie se met au service de la compréhension d’un événement. A partir d’une « restitution sonore neutralisée» du paysage sonore dans lequel il s’est déroulé, il facilite une « perception réelle de l’histoire », par exemple à l’intention des visiteurs des musées qui « désirent comprendre les faits » (comme le soulignait la chronique consacrée aux Visiteurs de Versailles publiée dans ces colonnes). Deux autres cibles sont également évoquées : le chercheur en sciences humaines qui pourra «resituer les faits en faisant entrer en jeu » une part de sensible ; ces mêmes chercheurs ainsi que les conservateurs de musées qui y trouveront des pistes de réflexion, « notamment sur la façon de présenter l’Histoire au public ». Ces résultats sont le fruit d’un travail de recherche minutieux et rigoureux dont nous ne citons ici que les étapes majeures. La construction d’une première trame écrite débute par la collecte de toutes les sources (textuelles, iconographiques) qui regorgent généralement d’indices relatifs aux sons émis dans un contexte historique spécifique. A partir de ces éléments est construite « une scénographie sonore » à laquelle sera associé « un certain nombre de critères acoustiques, nécessaires pour rendre réalistes les ambiances sonores ». Tels que la restitution phonique de la salle (caractéristiques physiques et acoustiques) ou le rendu de leur ambiance sonore historique (bruit des machineries, jeux et expressions des acteurs, bruits du public selon sa place dans l’espace ou sa position debout ou assis). Enfin, la scénographie est confrontée aux deux échelles de temporalité : le temps long de l’événement figé dans un témoignage (le passé) et le déroulement chronologique de la restitution à destination du grand public actuel (le présent). Dans cette démarche complexe, « le compositeur se transforme en historien » s’efforçant de « recontextualiser sans influencer ». Le projet Bretez apporte à la démarche scientifique de l’historien l’assistance technique d’un formidable outil technique.
De la restitution à la reconstitution, il n’y aurait qu’un pas. Un pas que franchit Anne Duprat lorsqu’elle analyse l’Acte I du Cyrano de Bergerac (1897) d’Edmond Rostand (1868-1918). Dès la première scène, voici recréé le théâtre de l’Hôtel de Bourgogne « en 1640 ». Avec ses espaces (y compris les sièges disposés sur scène) et ses différentes catégories de public. Nous devrions assister à la représentation d’une pièce intitulée Clorise. Mais, après seulement deux vers, Cyrano de Bergerac invective l’acteur Montfleury qu’il juge déplorable. Un brouhaha envahit aussitôt le plateau. « Dans le chaos qui s’ensuit, chansons, disputes et cris d’oiseaux fusent, jusqu’à ce que la verve et l’épée du Gascon s’imposent, pour faire résonner enfin, dans l’ancien théâtre rendu à la vie, les vers de Rostand en lieu et place de ceux du dramaturge oublié ». De fait, les spectateurs de 1897 assistent, en direct, à la chute d’une pièce baroque enterrée séance tenante par un public fictif et à la naissance instantanée d’une nouvelle pièce composée par un auteur actuel pour un public réel. Sa mise en scène « de la joyeuse indiscipline du public parisien de 1640 » entend contredire « la représentation scolaire, désincarnée, de l’âge classique » pour donner « le dix-septième siècle de Richelieu en spectacle ». Même l’ouïe est accaparée par les « cris de Paris qui ponctuent toute la première moitié de l’acte… et la seconde (par) le bruit des instruments produit par les musiciens qui s’accordent et répètent sur scène ». Lorsque Cyrano expulse Montfleury et occupe définitivement la scène, « le « Parterre » s’oppose aux « Loges », avant que l’ensemble ne se fonde en un seul chorus » rassemblé autour de Cyrano devenu le personnage principal. En installant sur scène un public fictif, la scénographie de Rostand obtient deux résultats. Elle intègre « au rituel spectaculaire lui-même » une « transgression du rapport scène/salle… de façon à en contrôler entièrement les effets ». Il parvient ainsi à « une véritable clôture du spectacle sur lui-même, par le biais de l’effacement presque hypnotique de la présence du public (réel) convié à assister au spectacle comme à un rêve projeté ». Une innovation qui, au demeurant, ouvre un champ d’expérimentation au théâtre moderne.
Cette création d’Edmond Rostand relève-t-elle du souvenir ou du ressouvenir ? Si le premier relève du champ d’une mémoire par nature personnelle et parcellaire, le second « est tout entier reconstruction, par hypothèses et tâtonnements, d’une expérience première… Le ressouvenir est du côté de l’histoire, pas seulement de la mémoire ». Julia Gros de Gasquet explore le champ historique du ressouvenir en interrogeant trois spécialistes (Marie-Madeleine Mervant-Roux, Bénédicte Louvat et Xavier Bisaro). Une reconstruction aux contours évolutifs, comme le signale d’emblée Bénédicte Louvat à propos du projet de recherche collectif (Les sons au théâtre et à l’opéra, de la Renaissance aux Lumières en France et en Angleterre) conduit sous le patronage de l’Institut de Recherche sur la Renaissance, l’Age classique et les Lumières (IRCL). A son « programme initial, conçu d’abord comme une archéologie des sons produits » s’ajoute maintenant « une réflexion sur l’écoute et sur l’histoire de l’écoute ». Marie-Madeleine Mervant-Roux évoque d’autres explorations conduites en parallèle. Cette fois, sur « la dimension sonore et auditive de l’événement théâtral ». Pour la période comprise entre le XIXème et le XXIème siècle, elles portent principalement sur « les usages des appareils de reproduction et de médiatisation du son par et pour le théâtre, l’histoire des pratiques vocales scéniques ; l’acoustique des salles ; les archives sonores ; les modes de formulation et d’analyse des phénomènes sonores dans le champ théâtral ». Mais pourquoi se ressouvenir ? Xavier Bisaro brosse à grands traits l’évolution des grilles de lecture des textes et des œuvres musicaux. De l’approche « graphocentrique » (« la science de la partition et… son exégèse ») à la contextualisation de la notation musicale (déduire de la partition « des enseignements sur les manières de mettre en œuvre des signes qu’elle comporte ») et à son élargissement au spectacle dans sa globalité. Jusqu’à l’appréhension historique des sons « comme produit et agent de la vie sociale ». Au fil des enquêtes, de nouvelles pistes s’ouvrent. Comme l’interaction des sons et des bruits (prestations scéniques, machineries, interpellations de la scène par la salle ou entre spectateurs) et les contributions apportées à l’histoire du genre (les « corps chantants », les castrats, la visibilité publique des femmes). La variété actuelle des investigations repose sur deux constats partagés aujourd’hui dans un esprit « d’interdisciplinarité interculturelle » que formule successivement Marie-Madeleine Mervant-Roux. D’abord, « le théâtre ne (peut) se réduire au texte ». Ensuite, le théâtre est un « art à deux temps » car il s’entend (texte vocalisé, sons, bruits) au moins autant qu’il se voit (scénographie, lumières). Il est vrai que l’invention des technologies sonores modernes (depuis le phonographe) a largement contribué à remettre en cause le primat traditionnellement concédé à la perception visuelle (décors, effets spéciaux ou costumes dès le XVIIème siècle). Elles ont également incité les auteurs dramatiques « à repenser leurs univers auditifs, à réinventer le bruit et le silence ». Récemment encore, le projet pluridisciplinaire ECHO (2012) « aborde le théâtre européen… comme un espace organisé par et pour la voix dite « parlée »… Il contribue ainsi à la réflexion, aujourd’hui cruciale, sur le maintien de notre capacité à pratiquer (écouter, lire, mémoriser, dire, chanter) une langue travaillée et joueuse ». D’intéressants développements sont consacrés aux approches méthodologiques des sons enregistrés dans le passé ainsi qu’aux productions du « ressouvenir ». Notre lecteur trouvera dans l’ouvrage d’utiles indications sur les développements les plus récents. Il trouvera également les indications lui permettant d’accéder à la pièce pour quatuor d’euphoniums (Logos et Phônè) commandée au compositeur grec Alexandros Markeas dans le cadre du colloque La Voix du public et créée par le Quatuor Opus 333, le 6 novembre 2013, au théâtre de l’Ecole Normale Supérieure.
Si nous ne pouvons réentendre les voix du passé, du moins sommes-nous en capacité de les reconstruire, conclut Sarah Nancy. Au centre de ce travail de reconstruction, le couple phônè/ logos est examiné sous deux angles. Celui du signe, d’abord. Un domaine de recherche qu’Anne Régent-Susini concentre dans une formule : un « sémiotique de l’émotion ». Il se place à la croisée « des réactions débordantes et des réactions extrêmement codifiées ». Celui, ensuite, du temps ou de « la durée dans laquelle s’inscrivent les manifestations sonores. En effet, il faut parfois attendre que les émotions soient validées socialement pour qu’elles s’expriment ». La réaction du Roi à certaines pièces de Molière souligne comment « ce temps de réaction au spectacle permet (aussi) d’interroger l’espace intérieur du spectateur ». Mais ces enquêtes en appellent d’autres, tant le sujet offre encore de belles opportunités d’appréhender « la perception réelle de l’histoire » par le son.
Au moment de refermer cet ouvrage, nous relisons nos notes. Nous sommes impressionnés par le chemin que nous avons parcouru dans la connaissance d’un sujet qui échappe à bien des amateurs de théâtre ou de musique. La moindre de ses qualités est l’abondance des informations qu’il propose. Les regards croisés et les approches pluridisciplinaires élargissent considérablement le champ des investigations et donnent à l’objet de l’ouvrage une profondeur insoupçonnée. L’ouvrage se distingue également par son approche singulière. Il nous contraint à regarder au-delà de l’œuvre représentée. Une pièce de théâtre ou un opéra n’est pas seulement le résultat d’une commande. Il ne se réduit pas davantage au talent de son auteur, aussi extraordinaire soit-il. L’ouvrage démontre qu’une œuvre artistique est aussi l’œuvre d’un public. Ce que résume Bénédicte Louvat : « il nous est apparu qu’il était véritablement impossible de dissocier la production et la réception, l’archéologie des sons et l’archéologie de la perception et de la transcription de l’expérience sonore ». En présence d’un objet culturel, il nous faudra désormais nous interroger : quelle part le public a-t-il pris à sa réalisation ?
Publié le 17 mai 2021 par Michel Boesch
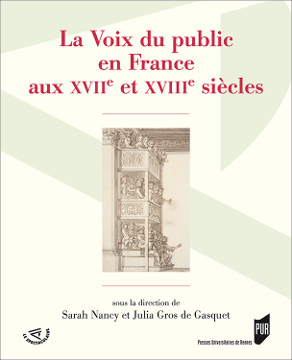 ©
© 
