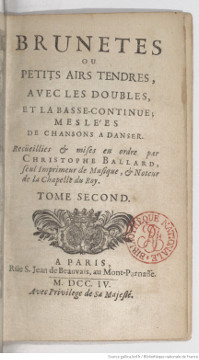Auprès du feu l’on fait l’amour - Charpentier
 © Gerard von Honthorst : La Marieuse - 1625
© Gerard von Honthorst : La Marieuse - 1625 Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notices trilingues (français-anglais-allemand), un CD, durée totale : 76 minutes 29 secondes. Château de versailles Spectacles - 2023
Compositeurs
- Auprès du feu l’on fait l’amour
- Airs sérieux & à boire de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
- (voir détails des pistes)
Chanteurs/Interprètes
- Claire Lefilliâtre, Gwendoline Blondeel, dessus
- Cyril Auvity, haute-contre
- Marc Mauillon, taille
- Geoffroy Buffière, basse
- Ensemble Les Epopées :
- Alice Coquart, basse de violon
- Mathias Ferré, basse de viole
- Pierre Rinderknecht, Léo Brunet, théorbe et guitare
- Stéphane Fuget, clavecin et direction
Pistes
- 1.Auprès du feu l'on fait l'amour · H.446
- 2.Beaux petits yeux d'écarlate · H.448
- 3.Tout renaît, tout fleurit · H.468
- 4.Que Louis par sa vaillance · H.459bis
- 5.Si Claudine ma voisine · H.499b
- 6.Ne fripez pas mon bavolet · H.499a
- 7.Celle qui fait tout mon tourment · H.450
- 8.Ayant bu du vin clairet · H.447
- 9.Rendez-moi mes plaisirs · H.463
- 10.Rentrez, trop indiscrets soupirs · H.464
- 11.Fenchon, la gentille Fenchon · H.454
- 12.Stances du Cid : Percé jusques au fond du cœur · H.457 / Que je sens de rudes combats · H.459 / Père, maîtresse, honneur, amour · H.458
- 13.Quoi! Rien ne peut vous arrêter · H.462
- 14.À ta haute valeur · H.440
- 15.En vain, rivaux assidus · H.452
- 16.Ruisseau qui nourrit dans ce bois · H.466
- 17.Feuillages verts, naissez · H.449a
- 18.Oiseaux de ces bocages · H.456
- 19.Tristes déserts, sombre retraite · H.469
- 20.Consolez-vous, chers enfants de Bacchus · H.451
- 21.Au bord d'une fontaine · H.443bis
- 22.Allons sous ce vert feuillage · H.444
- 23.Sans frayeur dans ce bois · H.467
- 24.Il n'est point de plaisir véritable
- 25.Non, non, je ne l'aime plus · H.455
- 26.Ah! Laissez-moi rêver · H.441
- 27.Veux-tu, compère Grégoire · H.470
- 28.Ah! Qu'on est malheureux d'avoir eu des désirs · H.443
- 29.Il faut aimer, c'est un mal nécessaire · H.454bis
Un coffret à bijoux sonoresLe label Château de Versailles Spectacles nous convie à une flânerie. A musarder dans les allées d’une galerie pittoresque où les peintures sont des Airs. Des Airs de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704).
Nos guides appartiennent tous à la Compagnie lyrique Les Epopées. Un ensemble dont le claveciniste et chef de chant Stéphane Fuget nourrit l’intelligence collective par la fertilisation croisée de remarquables talents individuels. Talents qui, dans nos oreilles, convertissent les sons en une suite de miniatures kaléidoscopiques.
Une suite dont nous peinons cependant à appréhender le fil. Quel est le projet ? La notice n’en dit mot. A peine le dos de jaquette qualifie-t-il, subrepticement, l’enregistrement de « florilège » organisé en « labyrinthe merveilleux dans la carte du Tendre ». En tout état de cause, un espace que fréquentent, la poésie, la passion et la gauloiserie.
D’évidence, les concepteurs du programme n’entendaient pas proposer la totalité des Airs de Charpentier. En dépit du terme « intégrale » figurant sur le site de l’ensemble Les Epopées, ils nous en offrent vingt-neuf sur la quarantaine aujourd’hui attribuées au compositeur. Une intégrale aurait pourtant trouvé une place de choix dans l’excellente collection qui prospère sous le patronage de Château de Versailles Spectacles.
Une quarantaine d’opus répertoriés dans la catégorie des « Airs ». Mais combien d’autres miroitent dans l’immense corpus que nous a légué Charpentier. Car seuls sont qualifiés « Airs » ceux qui ont été publiés comme tel dans un recueil dédié à ce genre musical.
Les concepteurs du programme n’envisageaient pas davantage de constituer un catalogue raisonné. Ainsi, le chapelet des airs égrenés s’affranchit-il de toute logique chronologique. Emmêlant des pièces publiées dans l’espace d’un demi-siècle, entre 1678 et 1728. Pareillement, la logique éditoriale n’a pas été retenue pour déterminer les enchaînements car le programme amalgame des pièces publiées dans le Mercure galant entre 1678 et 1681 et celles que distribue l’éditeur-libraire Ballard entre 1726 et 1729. Même l’approche thématique n’a pas semblé constituer une priorité. Des airs à boire narguent des airs en hommage au roi tandis que des extraits d’intermèdes ou de comédies côtoient chansonnettes, airs tendres ou sérieux. Un « florilège » façon « labyrinthe », disions-nous.
Cependant, la diversité du répertoire visité par Stéphane Fuget témoigne de l’extraordinaire vitalité d’un genre musical que le Dictionnaire de l’Académie Françoise (1694) définit, à l’article « Air », comme une « suite de tons agréables qui font un chant régulier ». Simplicité et raffinement en constituent le levain.
Or l’Air a une histoire. Une histoire dont Vincent Dumestre nous avait fait découvrir les premiers chapitres. Au travers de son « florilège » (trente-cinq airs sur les plus de trois mille connus), nous cheminions des « voix de ville » de Jehan Chardavoine (1538-1580) aux « airs de cour » d’Etienne Moulinié (1599-1676). Déjà, Claire Lefilliâtre et Marc Mauillon faisaient partie du voyage (voir notre chronique).
Nouveau projet ; nouvelle équipe. Celle-ci est renforcée par trois compagnons aux talents éprouvés : Gwendoline Blondeel, Cyril Auvity et Geoffroy Buffière. Malheureusement, l’absence d’identification des interprètes pour chacun des 29 titres et notre volonté de ne pas commettre d’erreur d’attribution, ne nous ont permis de personnaliser, ni tous nos coups de cœurs, ni nos quelques réserves. Pourtant, comme l’a montré l’enregistrement du Poème Harmonique auquel nous venons de renvoyer, l’exercice consistant à rapprocher un air et son/ses interprète(s) n’a rien d’insurmontable.
Aujourd’hui, Stéphane Fuget nous invite à reprendre la route. Celle qui mène des « airs de cours » aux « airs de ville», selon la formule riche en subtilité ciselée par Anne-Madeleine Goulet (Poésie, musique et sociabilité au XVIIème siècle – Les Livres d’airs de différents auteurs publiés chez Ballard de 1658 à 1694, Honoré Champion, 2004). Avant d’expliquer. Après la mort de Louis XIII (1601-1643) et, plus précisément, aux lendemains de la Fronde (1648-1653), « l’air de cour connut une mutation qui alla de pair avec l’élargissement de son public et le déplacement des foyers de création. De la cour où il avait été créé par les musiciens du roi, l’air de cour se répandit dans la ville, qui se l’appropria et le transforma… En marge de la musique officielle, explicitement soutenue par le pouvoir et ses institutions, se développa le courant de l’air sérieux qui sut retenir l’attention de quantité de musiciens et de poètes ». Peu à peu, ce genre musical s’acclimate à son nouvel environnement : les ruelles (un espace dédié à la conversation dans une « chambre à coucher »), les alcôves et les salons mondains. Un écosystème social et politique qui se cristallise autour de la conversation à la française.
Ces airs sont « gorgés de substance humaine », pour reprendre une expression chère à l’historien Lucien Febvre (Examen de conscience d’une Histoire et d’un historien, 1934). Pour entendre leurs battements de cœur, nous devons nous approcher au plus près des femmes et des hommes qui les ont confectionnés, interprétés, applaudis… ou pas. Les relier à leurs conditions d’existence.
Tirons d’abord parti du regard rétrospectif des historiens et prenons appui sur l’analyse des experts, principalement Anne-Madeleine Goulet.
Les airs sérieux sont nés dans les salons. Dans une atmosphère singulière : « un idéal de sociabilité (placé) sous le signe de l’élégance et de la courtoisie (oppose) à la logique de la force et de la brutalité des instincts, un art de vivre ensemble fondé sur la séduction et sur le plaisir réciproque », note Benedetta Craveri dans son ouvrage consacré à L’âge de la conversation (Gallimard, 2002). Plus précisément, durant la décennie 1650-1660. Celle du triomphe de la galanterie, « symbole du goût nouveau tout autant que manifeste social et esthétique », ajoute Anne-Madeleine Goulet en conclusion d’un ouvrage publié sous le patronage du Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV) : Poésie, Musique et Société – L’air de cour en France au XVIIème siècle, Mardaga, 2006.
Dans ces salons, poètes, compositeurs, chanteurs et amateurs d’airs s’accordent sur une manière d’être et de penser guidée par « l’épicurisme et l’appétit de jouissance ». On y vient d’abord pour se distraire. Cependant, en divertissant, les airs éduquent les esprits et polissent les mœurs. Jouant, en quelque sorte, le rôle « d’école de civilité ».
Tentons de mieux saisir l’esprit d’émulation qui anime « le microcosme des salons ». « On cherchait avant tout à tromper l’ennui, exigeait des divertissements toujours renouvelés, de l’imprévu, de l’extraordinaire. Eveiller l’intérêt, exciter la curiosité : tel était le souci de chacun » (Anne-Madeleine Goulet - Honoré Champion). Pour le mélomane, la simple écoute ne suffisait pas : « Il n’est pas juste de parler de Musique, à vous qui l’aimez avec tant de passion, sans vous donner moyen de chanter », écrit le Mercure galant (février 1678) à sa correspondante imaginaire. Et pour bien pratiquer le chant, poursuit-il, il faut s’imprégner de la poésie des mots avant de déchiffrer la partition : « lisez ces paroles… avant de vous attacher à la Note ». Pénétrée par le texte, saisie par la mélodie, la voilà prête à ravir son public. Comme le fait une certaine Isabelle, sans doute le double de Madeleine de Lyée, dame de La Calprenède (162 ?-1668), qui vocalise de façon exemplaire, « ayant une si belle méthode : elle ne grimace point en chantant, et prononce si bien les paroles de ces Airs, qu’on les entend aussi facilement, que lorsqu’elle ne fait que parler » (Anne-Marie-Louise-Henriette d’Orléans, duchesse de Montpensier (1627-1693) in Recueil des portraits et éloges en vers et en prose, 1659). Avec de la chance, l’un des auteurs est présent. Tel Charpentier qui, de sa voix de haute-contre, prenait certainement plaisir à présenter lui-même ses nouvelles compositions.
« Art de l’intimité, l’air sérieux… permettait de jouir du plaisir de la musique même lorsqu’on ne disposait que de très peu de moyens ». De fait, « l’air adaptait son format à l’exiguïté des ruelles » (Anne-Madeleine Goulet - Mardaga). Brièveté du texte poétique. Ensemble instrumental réduit à son plus simple appareil. Chanteurs solistes ou en nombre très limité (solo, duo ou trio, pour l’essentiel). Souvent de simples amateurs qui, à Paris ou dans les provinces, se pressent dans les librairies dès l’annonce de la parution d’un nouveau recueil d’Airs sérieux et à boire.
Ecoutons maintenant ce qu’ont à nous apprendre les contemporains de Charpentier. Nous leur poserons une seule question : pourquoi composez-vous et publiez-vous des Airs ? Dans diverses Epistres, dédicaces, Préfaces ou avis aux lecteurs, ils nous apportent les réponses suivantes.
Déjà, pour décompresser. Christophe Ballard raconte comment Sébastien de Brossard (1655-1730) lui avait confié des Airs qui sont le produit d’un « petit délassement de ses travaux plus sérieux pour l’Eglise » (Recueil d’Airs sérieux et à boire, 1691). Comme pour Charpentier, ces activités récréatives ne représentent qu’une part minime de son répertoire.
Pour enseigner la musique, indiquent d’autres. Car les Airs ont une vertu pédagogique. Simples, brefs et d’une grande variété, ils constituent d’excellents supports de travaux pratiques pour les apprentis musiciens. Dans le propos liminaire de son Douzième livre d’Airs sérieux et à boire, à deux et à trois parties (1678), Jean Sicard (vers 1620-vers 1683) les place même au cœur du programme de formation qu’il applique à sa fille : « C’est donc à vous… à qui je dédie mes Airs, je prétends que vous les chantiez jusqu’à ce que vous ayez appris à les bien chanter, et à les bien accompagner ; je veux même que vous appreniez ce que c’est que de composer un Air dans les règles, vous en trouverez ici de tous les différents caractères ». Une formation qui a porté ses fruits car Mademoiselle Sicard (on ne sait rien d’autre d’elle, pas même son prénom) sera la première compositrice française à avoir été publiée… dans les recueils contenant les productions de son père. Avant de céder au jansénisme convulsionniste, René Drouard du Bousset (1703-1760) revendique également une transmission héréditaire de la science des airs dans son Ier recueil d’airs nouveaux sérieux et à boire (1731) : « Je me flatte que quoi que ma jeunesse et mes talents me laissent sans doute inférieur à mon modèle (son père, Jean-Baptiste Drouard du Bousset (1662-1725)), l’Education que j’en ai reçue et l’écoulement d’une source si chérie mériteront un accueil favorable ». Notons qu’il n’y a pas d’âge pour s’entraîner à la composition d’Airs. Sous l’autorité d’un maître du genre, Bertrand de Bacilly (1621-1690), c’est une jeune demoiselle de cinq ans, Mademoiselle Michon (1674 ?- ?), qui dédie ses Journaux d’airs sérieux, d’airs bachiques et de chansonnettes à deux et à trois parties (1680) à François II de Goddes (1643-1701), marquis de Varenne et Capitaine aux Gardes Françaises. Le terme journaux évoquant probablement la progression de ses apprentissages. Enfin, lorsqu’il imprime ses Principes très faciles pour apprendre la musique (1705), Michel L’Affiliard (1656-1708), musicien attitré de la Chapelle Royale de Versailles, n’hésite pas à choisir des Airs pour sujets d’application de son solfège : « comme ce n’est pas toujours (la musique) la plus difficile qui est la meilleure, on doit pour raison, faire le choix de celle qui est la plus naturelle et qui vient des meilleurs Auteurs ».

Bertrand de Bacilly, Journaux d’airs sérieux… (1680), Gallica, BnF
D’aucuns les considèrent comme des leviers d’une stratégie marketing. Ainsi en va-t-il de la mise au point d’un sirop à l’Acte III, scène 9 de la comédie La Devineresse ou les faux enchantements coécrite, en 1679, par Jean Donneau de Visé (1638-1710) et Thomas Corneille (1625-1709), tous deux amis et partenaires de Charpentier. Le premier étant, au demeurant, le principal rédacteur du Mercure galant. La devineresse, Madame Jobin, promet à Madame des Roches de la faire « chanter comme un Ange. Je fais un Sirop admirable pour cela ». Pour en affiner le dosage, « il faut que vous me chantiez un Air, afin que selon ce que votre voix a déjà de force et de douceur, j’ajoute ou diminue dans la composition du sirop ». De la vendeuse de sirop, dirigeons-nous maintenant vers la « boutique barbifique » (du barbier). Dans cette chanson nouvelle parue dans La doctrine de la nouvelle dévotion cabalistique (1659), « un vénérable ouvrier/ Implore ton métier/ L’honneur de sa boutique/ Barbifique, barbifique/ Car c’est un Barbier ». De la lancette et du bistouri jusqu’au peigne et au relève-moustache, les seize instruments de sa caisse à outil sont célébrés dans une strophe spécifique.
Ou pour assurer une rentabilité durable à son industrie. Aussi, deux corps de métier vont-ils conjuguer leurs intérêts économiques réciproques : les éditeurs et les compositeurs d’airs.
Les imprimeurs ont constaté que les recueils d’airs remportaient des succès en librairie. Prenons pour exemple la maison Ballard. Depuis 1658 et jusqu’en 1694, elle publiait un recueil annuel d’airs choisis parmi « les meilleurs et plus célèbres de Paris et même du Royaume » (Avis au lecteur, édition 1694). A partir de cette date, Christophe Ballard (1641-1715) lance sur le marché le prototype de sa nouvelle collection : Airs sérieux et à boire de différents autheurs. Sur les conseils de ses amis, parmi lesquels Sébastien de Brossard, il imprimera désormais « un petit recueil des plus beaux pour les mettre en vente au commencement de chaque mois ». Il l’éditera ensuite en format trimestriel à partir des Airs sérieux et à boire de différents autheurs pour les mois d’octobre, novembre, décembre 1694. Hormis les « amis », la concurrence l’y contraignait également. Car, depuis 1674, le Mercure Galant offrait à ses lecteurs un ou deux nouveaux airs pour enrichir le contenu de son mensuel. Christophe Ballard apportera d’autres innovations pour stimuler les ventes. Ainsi, le format évolue-t-il dans un sens plus favorable aux interprètes. Du « format livre in-octavo » (dans lequel la basse continue pouvait être imprimée sur des pages distinctes de celles du dessus ou de la basse), l’éditeur passe au format oblong in quarto (« à l’italienne »). Plus pratique à l’usage et imprimé en gros caractères, complète Jean-Philippe Goujon dans son article consacré aux Recueils d’airs sérieux et à boire des Ballard (1695-1724) in Revue de Musicologie, Tome 96, n°1/2010. Succès éditorial assuré jusque vers le milieu des années 1720. D’autant qu’il reste fidèle à son projet artistique énoncé en 1694 : « La diversité des Génies des plus savants en l’art de composer, le choix des belles paroles et la beauté des Airs, seront toujours la règle que je suivrai pour rendre ces recueils recommandables et agréables au public ». En 1724, la maison Ballard mettra un terme à cette collection et la remplacera par une nouvelle : Meslanges de musique latine, françoise et italienne, divisez par saisons. Celle-ci s’éteindra en 1731 et ne connaîtra pas de suite. Il est vrai que les airs sérieux n’ont plus la faveur du public, relégués par une nouvelle génération : les airs d’opéra.
Du côté de la fabrique des Airs, la préoccupation est identique. Aussi, une sorte de « pacte » est-il noué entre le musicien et l’imprimeur. A une époque qui ne pratique pas encore « les droits d’auteurs », une diffusion aussi large que possible des airs a pour fonction principale d’assurer une publicité permettant d’attirer à eux de nouveaux élèves. Jean Sicard y est très attentif. Jugeant nécessaire de corriger son image de marque, il fait « connaître au public, ou à ceux qui croient que mon génie n’est borné que pour faire des Airs à boire, que je puis faire l’un et l’autre ». Aussi ajoute-t-il des Airs sérieux au sommaire de son Troisième livre d’airs à boire et sérieux à trois parties avec basse continue (1668). Entrepreneur avisé, il veille très tôt à sa succession. Pour cela, il dédie son Douzième livre… à sa fille. Précisant que ses Airs « lui serviront de leçon pour se perfectionner dans un talent auquel elle a du génie et de l’inclination… Il ne tiendra qu’à vous de vous rendre capable dans ce bel art, afin qu’on puisse dire un jour en voyant vos ouvrages : C’est la fille de Sicard ». Avec le Treizième livre… (1679), il franchit une marche supplémentaire. Il y promeut son entreprise familiale dans une préface dont il reconnaît la « grande utilité… (moins pour flatter que) pour instruire le public du mérite de l’auteur (et) pour lui apprendre qu’on a des neveux et des enfants qui composent ». Et d’ajouter aussitôt trois Airs de la main de la demoiselle pour démontrer qu’elle est déjà en bonne voie. En parallèle, d’autres veulent se démarquer en imposant leur griffe. Comme l’ambitionne un certain M. de Lalo (16…-16…) : « Voicy les premières Productions de mon petit génie. Car il n’y a qu’un an que je me mesle de faire des Airs ». Dans son Premier livre d’airs sérieux et à boire à 2 et à 3 parties (1684), il se présente comme le continuateur de Jean Sicard dans la mesure où il joint « le Sérieux au Bachique ». Pour autant, il affirme la singularité de sa marque en soulignant que « comme toutes les paroles de mes Airs sont de ma façon, on dira, sans doute, que je suis fol doublement, puisque je suis également Poëte et Musicien ».
Pour réussir, rien de tel qu’un bon mécène. Entre la personnalité d’influence et le musicien en mal de notoriété se construit alors « un échange, une relation de don et de contre-don », dans les mêmes termes que celle qui lie un auteur dramatique à sa/ son dédicataire (Véronique Lochert, Les femmes aussi vont au théâtre- Les spectatrices dans l’Europe de la première modernité, Presses Universitaires de Rennes, 2023 – voir notre chronique). En faisant don de son ouvrage, le compositeur se place (humblement, comme il se doit) sous la protection du dédicataire. Servais Bertin (1687-1759), maître de chapelle à Versailles et Paris, ne dissimule pas qu’il est « moins flatté du plaisir de donner mes ouvrages au Public, que celui de vous marquer mon attachement en vous les consacrant » (Airs sérieux et à boire à une et deux voix, airs pour la vielle et la musette et vaudevilles (1736) dédicacés à Monsieur Fauze, capitaine chef de la Grande fauconnerie de France). En retour, « le dédicataire garantit la valeur et la qualité de l’œuvre » ainsi que la renommée de son auteur. Ce que confirme Julie Pinel ( ?-1737) dans son Nouveau recueil d’airs sérieux et à boire à une et deux voix (1737) dédié au prince de Soubise, Charles de Rohan (1715-1787) : « votre auguste nom, à la tête de ce livre, suffit pour le rendre recommandable ». Ce type de compliments sucrés occupe la majorité des dédicaces que nous avons consultées.
Passons sur les onctueux topos humilitatis (modestie affectée) que nous illustrerons simplement par quatre vers que, dans la dédicace de son IIIème Recueil d’airs sérieux, tendres et à boire (1720), Jean-Baptiste Prunier ( ?- ?) adresse au duc Adrien Maurice de Noailles (1678-1766) : « Je vous présente Monseigneur/ Ces Airs qui ne font que naître/ Et qui n’attendent pour paraître/ Qu’un si glorieux protecteur ». Et que dire de l’hallucination de Jean Sicard, visité par une mystérieuse Muse. Elle lui dicte une Epistre célébrant les vertus d’un certain Monsieur de Saint-Aubin (nous ne sommes pas parvenus à identifier ce dédicataire) au moment de lui offrir son Onzième livre d’Airs sérieux et à boire à 2 et à 3 parties (1677).
Plus sérieusement, le don peut être lié à des circonstances particulières. Jean-Baptiste Drouard du Bousset offre son IIIIème recueil d’airs nouveaux sérieux et à boire (1705) à Marie-Adelaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne (1685-1712) en remerciement du « présent que vous avez fait à la France dans l’année qui vient de finir et qu’elle a reçu avec une joie si éclatante ». A savoir la naissance de Louis de France (qui décédera quelques semaines à peine après la parution du recueil). Jean Sicard fait cadeau de son Quatrième livre d’Airs, à boire, et sérieux, à trois parties, avec la basse continue (1669) à Maria Anna Antoinette de Glymes de Berghe (1650-1714) à l’occasion de son mariage avec Ferdinand-Gaston de Croÿ (1641-1720). Un tel présent peut également apporter une consolation après la perte d’un proche. Le même Jean Sicard dédicace son Dixième livre d’airs sérieux et à boire à deux et à trois parties (1676) à Françoise-Scholastique-Geneviève d’Anglure (1661-1717), dite Mademoiselle de Bourlémont, dont l’un des « illustres frères » a « arrosé de son sang » les lauriers récoltés lors de la campagne de Hollande (1672-1678). Il lui dédie un « petit ouvrage composé de quantité d’Airs à qui vous avez donné votre approbation, que vous aimez, et j’ose dire, que vous chantez quelquefois avec plaisir ».
La dédicace est d’autant plus enthousiaste qu’elle s’adresse à un mécène mélomane. Telle l’Epistre ouvrant le Premier livre d’airs sérieux et à boire à 2 et 3 parties (1686) dans laquelle Jacques Dubuisson (1650 ?-1710) exprime sa gratitude envers Gaston-Jean-Baptiste 1er de Lévis et de Lomagne (1636-1687) : « Vous chantez d’une manière si aisée, si naturelle et si cavalière, que vous m’avez fait remarquer des agrémens que je ne pouvais pas leur donner. Il n’est pas extraordinaire que je vous les offre ensemble après vous les avoir dédiés chacun en particulier ». Il arrive même que le mécène prenne l’initiative de promouvoir personnellement les compositions de son protégé. Tel Jean-Jacques Gaudart (1627-1717), conseiller du roi au Parlement de Paris. Dans le Huitième livre d’airs sérieux et à boire à 2 et à 3 parties (1674), Jean Sicard s’interroge sur les « mille raisons pressantes » qui lui feraient « naître l’envie » d’offrir son recueil à son protecteur : « je m’y sentais encore obligé pour vous remercier de la protection que vous avez donné par avance à mes Airs en les faisant valoir dans le monde ».
Ces dédicaces contiennent toutes les mêmes promesses : amuser, divertir, délasser. Définissant distinctement la vocation intrinsèque de ce genre musical. C’est donc au délassement du conseiller du roi que Jean Sicard entend s’attacher : « Vous avez un goût fin et délicat, qui vous fait aimer tout ce qui peut contribuer agréablement à vous délasser du travail assidu où vous engage une charge que vous exercez si dignement » (Huitième livre…). Estimant que « la Musique vous sert de délassement dans vos exercices », un certain C. de La Serre (16..-17..) offre un Recueil d’airs nouveaux sérieux et à boire à une, deux ou trois voix avec symphonie (1724) aux membres de l’Académie Royale des Beaux-Arts, Sciences et des Belles Lettres de Bordeaux. Mais pour Jean-Baptiste Drouard du Bousset, les airs débordent du strict cadre privé. Ils remplissent une fonction sociale. Aussi, dans sa dédicace au Régent Philippe d’Orléans (1674-1723), établit-il un lien entre chant et tranquillité publique. Son « recueil de chansons » sera donc « le signe naturel de la joie publique qui vous est si précieuse ». « Pour moi, Monseigneur, je me mêlerai à leurs fêtes, j’ornerai de mes faibles chants les vers que le plaisir leur inspirera et je les apporterai aux pieds de Votre Altesse Royale comme le tribut de la félicité publique » (XVIIIème recueil d’airs nouveaux sérieux et à boire, 1720).
Bien qu’appréciés, les Airs ne font pourtant pas l’unanimité. Moins encore du côté des Moralistes. Pierre-Jacques Brillon (1671-1736) ne mâche pas ses mots dans son Ouvrage nouveau dans le goût des Caractères de Théophraste et des Pensées de Pascal (1697). Observant un spectacle de baladins, il admet que, à première vue, leur spectacle ne représente rien de répréhensible. Sauf au moment de l’apparition des démons et furies : « On y chante des airs tendres qui enlèvent, qui transportent, qui donnent du plaisir ; mais un plaisir que les anciens Philosophes avec toute leur indulgence ne laissèrent pas d’appeler l’intempérance des oreilles ». Antoine Arnauld (1612-1694) nuance le propos mais sans en renier le fond : « Rien ne touche et ne remue davantage l’imagination que des chansons bien faites et bien chantées. Est-ce une raison de regarder l’imagination comme une faculté bien dangereuse ? C’en pourrait être une si toutes les chansons ressemblaient à celles de l’Opera, qui roulent toujours sur l’amour et présentent à l’esprit une morale lubrique, que des airs efféminés y font entrer agréablement… D’autres chants ne pourraient-ils pas être cause que l’imagination put avoir occasionnellement des effets tout contraires, aidant la vérité et la piété à entrer dans l’esprit et dans le cœur ? » (François Lamy (1636-1711) et Antoine Arnauld, Réflexions sur l’éloquence, 1700). Par anticipation, à partir de son Premier livre d’airs spirituels sur les stances de l’abbé Jacques Testu (1672), Bertrand de Bacilly répondra à cette demande d’expérience spirituelle par le chant.
Parmi les milliers d’airs en suspension, Stéphane Fuget en a prélevé vingt-neuf. Tous de la main de Marc-Antoine Charpentier. Tout comme une écoute au fil des plages peut susciter, à la longue, une certaine lassitude, un examen des airs au fil de l’eau nous exposerait au risque de la répétition. Aussi, maintenant que nous les avons replacés dans leur galaxie, nous les regrouperons par catégories.

Bal à la Françoise, Estampe illustrant L’Almanach royal pour l’an 1682, P. Landry (graveur), 1682, Gallica, BnF
Airs pour le roi
La soumission de la ville de Strasbourg à Louis XIV (1638-1715), le 23 octobre 1681, l’illustre à merveille : l’actualité militaire constitue l’une des sources d’inspiration des faiseurs d’airs. En l’occurrence, le plus empressé d’entre eux sera Bertrand de Bacilly. Alors même que le numéro d’octobre 1681 du Mercure galant venait de rendre compte des faits, son correspondant signale déjà deux poèmes nouveaux célébrant l’événement mis aussitôt en chanson par le compositeur.
Cette victoire a donné lieu à de multiples réjouissances dont témoigne l’estampe représentant un Bal à la Françoise sous-titré : Réjouissances de l’heureux retour de leurs Majestés. Au centre, le roi danse avec la reine. Dans le coin, en bas à gauche, deux personnages tiennent une partition. La dame serait Marie de Guise (1615-1688) et l’homme, nul autre que Marc-Antoine Charpentier. Il s’agirait d’ailleurs de l’unique portrait connu du musicien. Un portrait qui peut revendiquer un certain degré authenticité si l’on se souvient que le graveur et la famille Charpentier habitaient à quelques pas les uns des autres (Patricia M. Ranum, 1662 : Marc-Antoine Charpentier et les siens in Société Marc Antoine Charpentier, Bulletin janvier 1990). La partition qu’ils tiennent est celle d’un air titré : Le menuet de Strasbourg.
Sur cette danse de cour, Charpentier greffe un air de cour à la gloire du conquérant de l’Alsace : Que Louis par sa vaillance (H 459bis). Danse et chanson se conjuguent gaillardement. L’estampe de Pierre Landry (1630 ?-1701) laisse imaginer la scène (réelle ou fantasmée) : les invités de Marie de Guise dansent le menuet au rythme d’un clavecin enjoué secoué par de discrètes percussions tandis que Charpentier entonne un hommage enthousiaste à celui qui, « en se faisant ouvrir les Portes de Strasbourg,… a fermé celles de la Guerre » (Mercure galant, novembre 1681). Nul accent martial. Que le plaisir de la paix. Et l’espoir que le roi « puisse vivre toujours » pour « le bonheur de la France ». Un message ardent ciselé par une diction exemplaire.
Quand il n’est pas à la guerre, le roi visite ses princes. François Michel Le Tellier de Louvois (1641-1691) à Meudon, le 2 juillet 1685. Mais « le Ministre fut averti si peu de temps auparavant, de la grâce que le roi voulait lui faire, qu’il n’en eut pas assez pour le recevoir d’une manière qui pût répondre à la grandeur de son zèle » (Mercure galant, juillet 1685). Jean-Baptiste Colbert de Seignelay (1651-1690) à Sceaux, le 16 juillet. Il reçut le roi aux sons de L’Idylle sur la Paix de Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Armand-Jean de Vignerot du Plessis de Richelieu (1629-1715) s’attendait manifestement « d’avoir l’honneur de recevoir le roi à Ruel (Reuil) » (Mercure galant, octobre 1685). Deux anniversaires justifiaient l’éclat qu’il entendait donner à cette réception : la Trêve de Ratisbonne (15 août 1684) et le premier centenaire de la naissance de son grand-oncle, le cardinal Jean du Plessis de Richelieu (1585-1642). Il fit sculpter une statue équestre représentant Louis XIV. « Une figure d’un caractère le plus extraordinaire qui ait jamais été », croit savoir le Mercure galant dans son numéro d’octobre. En parallèle, il commande une Pastorale à Charpentier. Bergers et bergères y célébreront la trêve récente offerte à l’Europe par le roi de France. Son titre : La fête de Reuil (H 485). Mais ce projet tourne court car la sculpture colossale n’avait pas été livrée à temps et le roi était reparti à Chambord pour la chasse. La partition de Charpentier s’assoupira dans ses Mélanges autographes (volume 22). Pourtant, quelques vers d’une « personne de qualité qui a toute la délicatesse d’esprit que l’on peut avoir » seront imprimés dans le Mercure galant (octobre 1685). Particulièrement deux compliments adressés au roi : l’un par « La nymphe de Ruel », l’autre, intitulé « La France au Roi ». Charpentier met des notes sur ce second texte et consigne la partition de cet air de circonstance en appendice du chœur final de sa Fête de Rueil sous le titre « air pour le Roy ». Il y rend hommage A ta haute valeur (H 440). Saluant à la fois les grandes actions et la piété qui caractérisent le « Monarque tout parfait ». Exactement les qualités (« choses nouvelles » dit le correspondant du Mercure galant d’octobre) que l’abbé Cappeau avait, cette année-là, mises en valeur lors de son sermon prêché au Louvre pour la Saint Louis. Evoquant « la Grandeur et les Vertus Morales et Politiques de cet Auguste Monarque ». L’interprétation figurant sur cet enregistrement nous laisse réservé. Certes, nous saluons la parfaite diction à la française de la soliste. De même, le registre laudatif est déployé de façon convaincante. Mais pourquoi charger la mélodie d’inflexions vocales glissando que Charpentier n’indique pas, nous semble-t-il, dans sa partition ? Et pourquoi modifier le texte (« paraître » au lieu de « atteindre ») ?
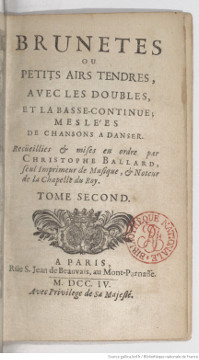
Brunettes ou Petits airs tendres avec les doubles et la basse continue, mêlés de chansons à danser Christophe Ballard, 1704, Tome 2, Gallica, BnF
Airs sérieux
Dans les années 1650, les airs de cour s’installent en ville et s’insinuent dans les salons. Dans l’ouvrage posthume du jésuite toulousain Michel Mourgues (1642 ?-1713), ces airs (ou chansons) sont ainsi définis : « ce qu’on appelle Chanson est un petit ouvrage en Vers faits pour être chanté. Il y a des chansons sérieuses, c’est-à-dire dont l’air et le tour de Vers ont quelque chose de grave ; le sujet doit y répondre. Il y en a de badines, et pour le tour et pour l’air ; c’est surtout en celles-là que les Français excellent. Enfin, il en est de tendres et de galantes » (Traité de la poésie française, 1724). Charpentier réserve la badinerie aux airs à boire. Aussi, les airs qu’il nous propose maintenant seront essentiellement sérieux, tendres et galants.
Airs sérieux publiés dans le Mercure galant
Qu’ils en portent la mention ou qu’ils en revêtent la forme, ils constituent la cohorte la plus imposante des airs inscrits au programme. Leur datation nous conduit à les regrouper en trois catégories.
Les trois plus anciens (hormis les « airs à danser » sur lesquels nous reviendrons) ont été publiés dans le Mercure galant avec un objectif clairement énoncé dès l’Epistre à Monseigneur le Dauphin en exergue du numéro de janvier 1678 : « Quand vous daignerez descendre jusqu’aux Muses du Mercure (nota : les Airs occupent généralement la dernière partie d’un numéro), elles tâcheront à vous délasser l’esprit dans ces heures que vous ne donnez pas à des Muses plus sérieuses ».
En janvier 1678 paraît Quoi ! Rien ne peut vous arrêter (H 462). Un « air nouveau » lancé à grand renfort de publicité (comme nous dirions aujourd’hui). L’article du Mercure loue un compositeur dont l’excellence n’a d’égal que sa notoriété (« fameux par mille ouvrages qui ont été le charme de toute la France »). Elles résultent autant de sa contribution à l’actualité théâtrale (« fameux… par l’Air des Maures du Malade imaginaire (1673) et par tous ceux de Circé (1675) et de l’Inconnu (1675) ») que de la formation qu’il a reçue de maîtres prestigieux (« il a demeuré longtemps en Italie où il voyait souvent Charissimi qui était le plus grand Maître de Musique que nous ayons eus depuis longtemps »). L’Air plaira (« je prétends que vous me ferez un fort grand remerciement pour cet Air ») et n’attend qu’à être chanté (« vous avez lu les Paroles de l’Air de Mr Charpentier, voyez-les notées »). Le texte met en compétition la soif de gloire et la tendresse d’une maîtresse. Une dialectique de l’amour et du mérite à laquelle est attachée l’autrice du texte : Antoinette du Ligier de la Garde (1638 ?-1694), dite Madame Deshoulières. Surnommée la « Dixième Muse » par ses contemporains, assidue des salons de Madeleine de Scudéry, cette philosophe et militante de la cause libertine a mérité un compliment posthume de la part de Charles-Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869) : « Elle semble plus moraliste qu’il ne convient à une bergère ; il y a de la pensée sous ses rubans et ses fleurs » (Portraits de femmes, 1844). Et d’ajouter que son maître, Jean Hesnault (1611-1682), un ami de Molière, lui aurait, dans l’Epitre à Sapho (vers 1650), « déconseillé la gloire et à l’édifier sur l’amour ». Schéma que Charpentier reprend complètement à son compte en découpant le poème en deux strophes. La première, dédiée à la guerre, est secouée par des sauts de quinte ou de sixte et sa conclusion, criblée d’altérations. Dans la seconde, plus lisse et caressante, le chanteur exprime merveilleusement la sensation de légèreté que procure la douceur prodiguée par une maîtresse. Dans le conflit entre le héros tragique et le héros galant, le compositeur prend manifestement parti pour le second.
Dans le numéro paru le mois suivant, un second air de Charpentier est proposé aux lecteurs du Mercure : En vain, rivaux assidus (H 452). Mais avant d’en venir à la chanson, l’avis Au lecteur nous apportera de précieuses informations sur l’engouement que suscitent les Airs à chanter et sur l’art de les composer. « On prie ceux qui envoient des Chansons qui ont un second couplet, d’observer qu’il ait la même mesure et des césures dans les mêmes endroits que le premier. Comme ces sortes d’Ouvrages sont courts, ils doivent être polis et n’avoir pas de mots trop rudes pour être chantés… On donnera tout cela noté par les meilleurs Maîtres… On recevra ce que les Maîtres de Province enverront noté. Ils sont priés seulement de ne rien envoyer que de très correct, afin qu’on puisse graver sans embarras. Ils savent que le Mercure allant partout, leurs Ouvrages seront vus en un mois dans toute l’Europe, et cela les devant animer à travailler avec plus de soin ». Comme si Jean Donneau de Visée entendait illustrer son propos par un exemple, il place pratiquement en tête de son numéro les « Paroles de M. Vaumorières notées par M. Charpentier ». Au préalable, il tient à s’excuser car le second air publié le mois précédent n’était pas « nouveau », contrairement à ce qui lui avait été déclaré. En revanche, « celui que vous allez trouver ici noté n’a encore été vu de personne. Je vous laisse juger des Paroles. L’Air est de Mr. Charpentier, dont vous me dites que les Ouvrages sont si estimés dans votre Province ». L’auteur des paroles, Pierre Ortigue de Vaumorières (1610 ?-1693), un disciple de Madeleine de Scudéry (1607-1701), est réputé pour ses romans héroïques. Inconditionnel des salons littéraires, il publiera bientôt son Art de plaire dans la conversation (1690). Dans un style galant qui procède en ligne directe des airs de cour, Pierre Ortigue de Vaumorires avertit les prétendants de Climène : ne perdez pas votre temps car elle « n’aimera ni vous ni moi ». Cette fille du roi de Crète est le personnage-titre d’un conte de Jean de La Fontaine (1621-1695) publié en 1671. Climène y exprime sa relation à l’amour : « L’amour, je le confesse, a traversé ma vie/ C’est ce qui, malgré moi, me rend son ennemie ». Le tranchant du chanteur assène deux strophes en forme de double avertissement. Dans le premier, il s’apitoie sur les soupirants inconscients de leur sort, enveloppant « peine » et « Climène » dans les filets de notes tenues. Comme, dans la seconde strophe où il associera « belle » et « cruelle ». Révélant merveilleusement le double langage d’un air : ce que dit le poète et ce qu’enchérit l’interprète.
Neuf mois plus tard, paraît un troisième air de Charpentier : Ah ! Qu’on est malheureux d’avoir eu des désirs (H 443). Le texte de présentation qui l’accompagne éclaire le chemin parcouru dans l’esprit des lecteurs mélomanes du Mercure. Nul besoin d’un long préambule : « Vous ne serez pas fâchée de voir pour la seconde fois un Madrigal que vous avez déjà lu avec plaisir, puisque je vous le renvoie mis en Air par Mr. Charpentier. Comme ces sortes d’ouvrages parlent d’eux-mêmes, je vous laisserai juger à l’avenir de leur bonté, et me contenterai de vous en nommer les Autheurs ». Le texte auquel il est fait référence a été publié dans le numéro d’octobre. Il participe du grand débat qui agite la société au lendemain de la parution (sous couvert d’anonymat) de la Princesse de Clèves (1678) de Marie-Magdëlaine Pioche de La Vergne, comtesse de La Fayette (1633-1693). Dans ce numéro, un long développement discute méthodiquement la « question galante » suggérée par « la confidence que la Princesse de Clèves fait de sa passion à son Mari ». Devait-elle se taire ou parler ? D’autant que ses aveux eurent une issue fatale pour le Prince de Clèves. La Princesse culpabilise, finit par avouer son amour à Monsieur de Nemours mais le prévient : « Cet aveu n’aura pas de suite, et je suivrai les règles austères que mon devoir m’impose ». Pour illustrer l’analyse méthodique de la « question galante », le Mercure imprime trois « madrigaux » (c’est-à-dire « une sorte de poésie… qui renferme dans un petit nombre de vers une pensée galante et ingénieuse », selon le Dictionnaire de l’Académie françoise de 1694). Le second, celui que Charpentier met en musique, illustre l’idée selon laquelle « on n’a jamais regardé la nécessité de cesser d’aimer, que comme un fort grand supplice ». Une quasi paraphrase des dernières réflexions de la Princesse qui « voyait aussi qu’elle entreprenait une chose impossible que de résister en présence au plus aimable homme du monde qu’elle aimait, et qui l’aimait ». Dans cette élégie en forme de ténébreux lamento, la soprano nous entraîne dans les tréfonds de la pathologie amoureuse. Suivant en cela les règles de la rhétorique, Charpentier répartit les sept vers du poème en trois parties. L’exorde mesure la souffrance provoquée par le renoncement « à l’ardeur qui nous presse ». La narration constate qu’on « ne gouverne pas comme on veut la tendresse ». La péroraison déclare « heureux qui peut haïr ce qu’il a aimé ». L’exorde et la péroraison étant soumis au jeu de la répétition. Cordes plaintives et clavecin larmoyant. Rythme tourmenté. Notes maintenues puis relâchées, secouées par les sanglots. Prononciation distendue par l’affliction mais sincérité dans l’expression d’une douleur enviant ceux qui parviennent à oublier ce qu’ils ont aimé. Dans un siècle et un milieu où le mariage d’amour fait exception, cet air, à forte densité émotionnelle, a certainement fait battre le cœur de bien des auditrices.
Airs sérieux publiés par Christophe Ballard
Dans un climat d’explosion éditoriale, Christophe Ballard conçoit une nouvelle collection qu’il met lui-même « en ordre ». Effaçant, au passage, le nom des auteurs. Dans son premier tome de Brunettes ou Petits airs tendres avec les Doubles et la Basse continue mêlées de chansons à danser (1703), il clarifie son projet éditorial. D’abord, dans sa dédicace à Marie-Anne de Bourbon (une fille légitimée de louis XIV et de Louise de La Vallière (1644-1710)), princesse douairière (à l’âge de 19 ans) de Louis-Armand de Bourbon-Conti (1666-1739) : ce recueil « contient ce qu’il y a d’Airs François les plus parfaits dans le caractère Tendre et Naturel ; Hé qui peut mieux sentir que Votre Altesse ces grâces naïves et touchantes ? ». Un projet qu’il précise dans l’Avertissement. Il y explique d’abord le choix du titre : « Les Airs dont il est composé ont été appelés BRUNETTES, par rapport à celui qui commence Le beau Berger Tircis, et qui finit par ces paroles : « Hélas, Brunete, mes amours ». Il justifie ensuite le choix des airs : « Une preuve de la bonté de ces Airs, c’est que malgré leur ancienneté, on ne laisse pas de les apprendre et de les chanter encore tous les jours ; ceux même qui possèdent la Musique dans toute son étendue, se font un plaisir d’y goûter ce caractère Tendre, Aisé, Naturel, qui flatte toujours, sans lasser jamais, et qui va beaucoup plus au cœur qu’à l’esprit ».
Un seul air de Charpentier figure dans le premier tome : Au bord d’une fontaine (H 443bis). Taillé en forme de rondeau, il consigne les plaintes de Tircis, trompé par l’infidèle Annette qu’un « autre amour appelle/ Loin de ces lieux charmants » (strophe 6). Le texte comporte six couplets publiés dans le recueil de 1703. Mais seuls les quatre premiers sont notés. Laissant probablement à l’interprète le soin de personnaliser les agréments. Instruments et voix communient dans une même douleur. C’est au clavecin qu’il revient d’abord de décrire Tircis avant même que celui-ci ne s’exprime. Trilles, tremblements et gammes accablées font couler ses larmes tandis que son visage s’assombrit, endolori par la mélancolie. Les strophes se souviennent des adieux quand le refrain exprime le sentiment de détresse qui étreint celui qui ne parvient pas à oublier la félicité passée. L’éditeur livre cet air et l’accompagne de ses doubles. Par conséquent, après la première strophe (le « simple ») exposant la ligne mélodique, les suivantes (les « doubles ») se parent progressivement d’ornements. Les cordes renforcent le clavecin. Le tempo s’enfièvre et la douleur lancinante qu’exsude la voix de soprano nous attendrit.
Charpentier avait quitté ce monde depuis près d’un quart de siècle lorsque quatre de ses airs (auxquels s’ajoute un air à danser) paraissent dans une collection lancée en 1725 par la maison Ballard : Meslanges de musique latine, françoise et italienne divisés par saisons. A la veille de la sortie du premier volume, dans l’Avertissement ouvrant son dernier Recueil d’airs sérieux et à boire (1724), l’éditeur se revendiquait comme le conservateur national du patrimoine vocal : « je n’ai omis d’y insérer aucun des airs approuvés par le public ; mais encore, j’en ai fait revivre quantité qui étaient inconnus, ou tout à fait oubliés ». Statut qu’il entend consolider en publiant ses Meslanges.
Trois airs de Charpentier paraissent dans l’édition 1728. Mais aucun d’eux n’est qualifié « d’air sérieux ». D’abord un tendre « Duo » associant la taille et la basse : Tout renaît, tout fleurit (H 468). Observant le retour du printemps, le soupirant abandonne à regret l’idée d’un réveil simultané de l’amour qu’il porte à « ma cruelle ». Certes, les lignes mélodiques sont enchantées. Mais la basse continue, tirée vers le grave, aspire vers le vide du désespoir. Les chanteurs effilent avec délicatesse la désespérance pour la sublimer dans un émouvant duo consolateur.
Voici maintenant un « récit ». En musique, ce terme précède celui du « récitatif », terme qui ne s’imposera qu’au début des années 1690. Selon le Dictionnaire de l’Académie françoise (1694), il désigne « tout ce qui est chanté par une voix seule qui se détache d’un grand chœur de musique ». Du « récitatif », l’air Tristes déserts, sombre retraite (H 469) tire sa partie médiane. Une section dans laquelle le soupirant raconte la douloureuse métamorphose du bonheur amoureux en terrible trahison. Dans les deux parties encadrantes, l’amant délaissé ouvre son cœur à la Nature. Une Nature confidente, elle-même tourmentée (« tristes déserts »). Une thématique générale, préromantique, mais qui fait écho à ce vers de Pierre de Ronsard (1524-1585) : « Et vous, rochers, les hôtes de mes vers » (« Ciel, air et vents » in Premier livre des Amours, 1552). Dans ce monologue lyrique, le chanteur exploite remarquablement le registre de la narration (un parfait recitar cantando - dire en chantant – imité des Italiens). Le texte prime et le continuo donne de la profondeur à l’émotion. Aucune fluidité. Pauses et accélérations parlent la langue des passions contrariées. Ajoutons à cela une écriture musicale hautement figurative : longue tenue de note pour matérialiser l’immensité des déserts ; ligne descendante chargée d’altérations symbolisant la course vers la mort ; animation soudaine du tempo qui révèle l’intensité du souvenir du bonheur perdu. Un joyau d’écriture et une merveille d’interprétation.
Pour finir sur une note plus gaie, voici une « pastorelle en duo ». Sans doute une « pastourelle » que Sébastien de Brossard définit ainsi : « Chant qui imite celui des Bergers, qui a la douceur, la tendresse, le naturel » (Dictionnaire de musique, 1703). Pour « passer la chaleur du jour », un berger invite une bergère à se réfugier à l’ombre : Allons sous ce vert feuillage (H 444). Elle y consent tellement volontiers qu’ils font chorus et convertissent cette invitation en refrain. Dans deux couplets chantés en soliste, l’une voit s’égayer leurs moutons qui « bondiront tour à tour sur l’herbette fleurie » tandis que l’autre entend le « pinson amoureux » relayer l’invitation. Une charmante bluette dont le refrain aurait pu être chanté sur un ton plus badin.
Le volume paru l’année suivante contient un nouvel air de Charpentier. Un « air sérieux », cette fois. Rendez-moi mes plaisirs (H 463), adjure une âme en peine. L’architecture du texte mérite un instant d’attention. Deux supplications (« Rendez-moi mes plaisirs ») encadrent une remontrance à l’égard des « dieux cruels » et jaloux qui lui ont ravi « ma Sylvie ». Mais l’équilibre du texte est rompu lorsque la reprise de la supplication se transforme en ultimatum : rendez-moi Sylvie ou « me donnez la mort ». Une dynamique narrative qui se confond avec la dynamique de la musique. Si, dans la première section, la plainte s’écoule douloureusement, la seconde est animée par la volonté d’affronter les dieux ravisseurs. Cependant, l’ultimatum final s’évanouit dans les graves, entérinant la disproportion dans le rapport de force.
Certains airs remportent un succès tel qu’ils inspirent une parodie. Le numéro d’octobre 1689 du Mercure galant promeut un air à succès : « Quoi que la chanson que je vous envoie ne soit pas nouvelle, elle a présentement un si grand cours à Paris, qu’elle ne peut être que favorablement reçue en Province. Les paroles sont de l’illustre Mr de la Fontaine et l’air du fameux Mr Charpentier, qui a une si grande connaissance de toutes les beautés de la Musique ». En effet, la Galatée de Jean de La Fontaine (1621-1695) s’ouvre (Acte I, scène 1) sur l’air Brillantes fleurs, naissez (H 449). Le succès entraînant la parodie, Charpentier conçoit quelques variantes qu’il apporte au texte (quelques mots, ici ou là, et l’inversion de la seconde et de la troisième strophe) et à la musique (bien peu, en réalité) pour créer un nouvel air bucolique : Feuillages verts, naissez (H 449a). Stéphane Fuget accorde sa préférence à la parodie publiée dans le recueil de Brunettes ou petits airs tendres avec les doubles et la basse continue, mêlées de chansons à danser (Tome 2 - 1703-1711) et la confie à un duo éminent. Le délicieux cliquetis du clavecin, le suave pincement du théorbe et l’envoûtant mariage des tessitures de Claire Lefilliâtre et de Gwendoline Blondeel ont pour vertu d’éloigner toute pensée morose tant la musique et ses interprètes font danser nos coeurs. Une beauté magnifiée par sa simplicité. Une beauté obsédante qui a plu en son temps et qui continuera de plaire pour la douceur et la légèreté de cette confondante ode au Printemps.
Airs sérieux (autres sources)
Pour clore le chapitre des airs sérieux ou tendres, intéressons-nous à quatre des cinq airs (Quoi ! je ne verrai plus, H 461, n’a pas été retenu par Stéphane Fuget) de Charpentier figurant dans une anthologie proposée, sous la forme de musique manuscrite, dans le Recüil d’airs à voix seule, à deux ou trois parties, composez par différents autheurs (1700-1725). Trois d’entre eux sont baignés dans la tonalité en la mineur. Un affect « tendre et plaintif », particulièrement indiqué pour exprimer « tous les mouvements de l’âme », écrit le musicien dans ses Règles de composition (1690). De fait, l’air pour voix seule Rentrez, trop indiscrets soupirs (H 464) met en scène le dur combat qui oppose l’âme et le corps. Cette thématique est centrale dans le discours galant qui admet l’amour ardent mais exclut le sexe. Un cœur brûlant dans un corps placide ? Une torture, proteste le texte dont le sens s’éclaire à la lumière d’Il Pastor fido (1602) de Giovan Battista Guarini (1538-1612). Plus précisément de l’épisode dans lequel Amaryllis (citée dans le texte de l’air), secrètement éprise de Mirtillo, lui témoigne la plus grande froideur car elle sait qu’elle doit épouser Silvio. L’interprétation excellemment expressive met en valeur l’écriture figurative de Charpentier. A commencer par cette ligne mélodique descendante qui enfouit les soupirs « dans le fond de mon âme ». Puis, par la nervosité du rythme suscitée par la crainte d’offenser Amaryllis. Enfin, par la souffrance (altérations) et l’épuisement (ralentissement du tempo) que provoquent l’inéluctable : « puisque mes yeux pleins de langueur/ Disent malgré moi que j’expire ».
Autre mouvement de l’âme. Celui de l’ultime confidence qu’un amoureux trahi confie au Ruisseau qui nourrit dans ce bois (H 466). Le clavecin représente le ruisseau, faisant s’écouler ses notes vives et étincelantes. En surimpression, la voix se plaint de la déloyauté de « ma volage ». Une effusion rythmée par la colère. Jusqu’aux adieux et à l’anéantissement : « puisque je meurs ».
Du moins, une mort sociale que chante l’élégie Ah ! Laissez-moi rêver (H 441). Un saisissant hymne à la solitude volontaire afin de cicatriser les plaies de l’absence « de mon fidèle amant ». Le texte n’évoque manifestement pas un accident de la vie sentimentale. Plutôt un deuil, nous semble-t-il. Rappelons que « la figure de la femme seule » recouvre un quart de la population féminine d’alors (Scarlett Beauvalet-Boutouyris, La solitude XVIIème-XVIIIème siècles, Belin, 2008). Construite en forme de rondeau, cette touchante mélancolie se dissipe dans de longues tenues de notes. A peine un cri déplorant le vide laissé par le manque. Le frottement des cordes exsude la souffrance de l’âme tandis que la voix, possédée par la douleur, se liquéfie et s’abandonne au désespoir. Aux dernières notes, nous sommes médusés et admiratifs.
Un dernier air figure dans ce manuscrit : Non, non, je ne l’aime plus (H 455). Une forme d’air en rondeau dans lequel les strophes apparaissent comme une succession de récitatifs musicalement indépendants. Le texte et la musique nous font assister à un exercice de purgation de l’âme. Trahi par la « volage Philis » et courtisé par Climène, deux figures littéraires de la femme fatale, Cyril Auvity tente de retrouver la maîtrise de ses passions. Dans un refrain volontariste, il pense avoir tourné la page : je ne l’aime plus, « mes liens sont rompus ». La première strophe parle à son cœur. Le ton est grave, posé : Laisse-moi aimer Climène pour oublier Philis. La seconde met en scène le phénomène d’attraction-répulsion : « je la fuis et voudrais la rencontrer toujours ». D’abord, place au regret. Caresses musicales réveillant le souvenir des bons moments. Basse de viole sombre rappelant l’épisode de la séparation. Atmosphère placide, propice à l’introspection. Soudain, l’amant prend la mesure du terrible paradoxe : « On ne hait pas ainsi ». Poussée de tension. La ligne mélodique escalade l’échelle chromatique. La prise de conscience est totale. Elle s’exprime dans un refrain inchangé sur le plan mélodique mais dont le texte est remanié. Non, je ne l’aime plus, disait-il au départ. Je suis trop lâche pour rompre, conclut-il maintenant. Est-ce un hasard si Charpentier choisit la tonalité en ré mineur pour cette effusion lyrique ? « Tonalité des choses d’église et dans la vie commune, de la tranquillité de l’âme », écrit-il dans ses Règles de composition. Alors : confession ou examen de conscience ?

Claudine Bouzonnet-Stella (1641-1697) – Le branle, Bibliothèque municipale de Lyon
« Chansons à danser »
Divertissement sérieux, la danse, au XVIIème siècle, est également un levier de la réussite sociale de toute personne de qualité. Nul n’ignore le rôle politique des ballets de cour. A l’autre extrémité du spectre, les airs à danser. Souvent des airs en vogue sur lesquels sont greffés des vers.
1679. Le Mercure ne publie aucun air attribué à Charpentier. Il est vrai que, depuis la fin des années 1670, le compositeur est chargé de composer la musique du Dauphin, Louis de France, « lorsque ce Prince avait tous les jours une Messe particulière, ses exercices l’empêchant de se trouver à celles du Roi » (Mercure galant, mars 1688). Le 7 mars 1680, le Dauphin épouse Marie-Anne de Bavière (1660-1690). « Une des plus grandes Princesses de la Terre », carillonne le Mercure dans son numéro de mars 1680 (2ème partie). Pour se détendre ou pour participer à la liesse nationale, le musicien compose « une fort agréable Chaconne dont je vous fais part », écrit le Mercure (mars 1680, 1ère partie). « Elle est de Mr Charpentier. Son nom vous la doit faire recevoir avec plaisir », conclut-il, en guise de présentation de l’Air : Sans frayeur dans ce bois (H 467). La « chacconne » d’alors est « une espèce de sarabande par couplet avec le même refrain » (Dictionnaire de l’Académie françoise, 1694). Un air dansé dont l’âme joyeuse de l’ostinato (« basse obligée » sur les indications de Charpentier) chante une forme de refrain et diffuse un sentiment d’insouciance. Insouciance d’une bergère qui s’aventure seule dans un bois à la rencontre du berger Tircis. Les cordes pincées déclenchent un agréable mouvement de balancement tandis que l’ascendant de la soprano nous fait murmurer sa mélodie ample et ondoyante. Avec une parfaite technique vocale mais peut-être un peu trop de sérieux pour exprimer la frivolité en embuscade derrière les mots de la poésie. Au moins en termes d’inventivité, nous pencherions davantage vers l’euphorique mise en scène lors du concert Let Us Dance donné le 17 mai 2021 au Montgomery Hall australien (air chanté par Bonnie de la Hunty). Voire la version jazzy proposée le 1er novembre 2018 dans le cadre du Music for a while : Live in Potsdam (air chanté par Tora Augestad). L’une et l’autre de ces interprétations étant, nous semble-t-il, traversé par l’esprit de fraîcheur qu’y insuffle un Charpentier badin. Mais, il est vrai, s’éloignent, au contraire de notre soprano, de la gravité caractérisant une sarabande.
Plus de quinze ans séparent cet air sur fond de chaconne avec le dernier air de Charpentier paru dans le Mercure : Celle qui fait mon tourment (H 450). Dans son numéro de juillet 1695, nulle mention dans le sommaire. Les airs ont-ils fait leur temps ? Cela dit, ils conservent leur public : « Voici les paroles qui ont été faites sur une gavote de Mr. Charpentier, si connu pour ses Ouvrages. Comme elle a grand cours, vous serez bien aise d’en avoir tous les couplets ». Cette brève accroche nous livre une information intéressante sur une autre manière de composer des airs. Si, d’une manière générale, le compositeur créé une mélodie à partir d’une poésie qui lui a été soumise, c’est le poète qui rédige ici un texte à partir d’une musique préexistante. Une « gavote », c’est-à-dire un air sur lequel on danse « une espèce de danse gaie » (Dictionnaire de l’Académie françoise, 1694). Pourtant, ce n’est pas la gaieté qu’exhale le texte. Davantage, cette sorte de folie qui conduit un galant à aimer celle qui le tourmente. Une folie éruptive qui débute a cappella, grossit au fur et à mesure de l’entrée des instruments et finit par jaillir dans un dernier couplet au rythme incandescent. La structure en rondeau glisse sur un texte en forme de complainte (« j’ai tout tenté pour attirer ses faveurs ») mais impose un refrain obsessionnel exprimant, sur une courbe croissante d’intensité, la blessure d’injustice dont souffre le soupirant. L’interprétation qu’en donne la soprano incarne cette poussée de fièvre amoureuse avec davantage de réalisme que ne le fait, nous semble-t-il, Anne Sofie von Otter (Ombre de mon amant, Les Arts Florissants, Archiv Produktion, 2010).
Voici, enfin, une « chansonnette » parue dans l’édition 1728 des Meslanges de musique Latine, françoise et italienne : Auprès du feu l’on fait l’amour (H 446). Elle ouvre le programme mitonné par Stéphane Fuget en même temps qu’elle imprime un titre racoleur sur la jaquette du coffret. N’y voyons cependant aucune grivoiserie. Car, à cette époque, « faire l’amour » est synonyme de « courtiser ». Le Dictionnaire de l’Académie françoise (1694) définit d’ailleurs fort joliment cette expression : « c’est aimer d’une passion déclarée et connue à la personne que l’on aime, à laquelle on continue de la témoigner par les assiduités et les autres complaisances ». Tout, dans ce jeu de séduction, est gracieux. Surtout son rythme imité de la canzonetta (musique de danse instrumentale italienne) pour célébrer la légèreté de l’amour galant. Deux personnages : un berger et une bergère. N’attendons pas le printemps (« la fougère »), dit-il à la belle, alors que tu peux « choisir un berger sincère » dès cet hiver (« auprès du feu »). Un thème cher à Pierre Ronsard, notamment dans sa chanson Quand vous serez bien vieille qui s’achève sur le célèbre conseil : « Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie » (Sonnets pour Hélène, 1578). Guitare et cordes font danser nos sens avant même que la voix ne nous invite au badinage. Cette courte ballade d’amour s’achève sur un concert de sifflements inattendu mais astucieux pour lui donner une allure populaire tout à fait bienvenue. Bien plus ingénieux que l’interprétation qu’en ont donné, jadis, Les Arts Florissants (Erato, 1998) dans un style plus proche des airs à boire que des subtils jeux de l’amour.

Nicolas Poussin (1594-1665) – Enfants buvant et mangeant du raisin, Gallica, BnF
Airs à boire
A la table des Français, le vin constituait « un aliment à part entière, nourrissant et fortifiant », assure Florent Quellier (La table des Français. Une histoire culturelle (XVème-XIXème siècle), PUR, 2013). Dans la balance commerciale, il tient même la seconde place, « venant immédiatement après les céréales » note l’historien Ernest Labrousse (1895-1988). « Des cabarets populaires aux aristocratiques collations, il est surtout indissociable de la sociabilité des Français », conclut Florent Quellier. Jusqu’à l’enivrement ?
Sûrement pas, fulminent les moralistes. Tel Jean Deslyons (vers 1615-vers 1700), ancien doyen de la cathédrale de Senlis, plus connu pour sa charge contre l’utilisation des instruments de musique durant l’Office des Ténèbres : seule « la louange de Dieu chasse les détractions (= action de dénigrer), les impuretés de la bouche, les chansons à boire, les cris de l’ivrognerie » (Discours ecclésiastique contre le paganisme de la fève et du roi-boit (fête de l’Epiphanie), 1664).
Evidemment, objecte le néerlandais Albert-Henri de Sallengre (1694-1723) dans son Eloge de l’yvresse (1715). A condition de respecter certaines règles. Parmi celles-ci : « ne pas s’enivrer souvent », toujours le faire « en bonne compagnie, c’est-à-dire avec ses bons amis, qui soient gens d’esprit et qui n’aient pas le vin mauvais » et seulement « avec de bon vin ». Et que fait-on en bonne compagnie ? On chante. D’autant que, applaudit Jean Prévost, curé de Saint-Séverin, « les chansons délectables/ Réjouissent les tables/ Des hommes et des Dieux » (Ode pindarique à Mgr le Prince de Condé sur son heureux retour de Flandres, 1610).
Le répertoire des airs à boire est nourri et composite. Franchement grivoises ou joliment allusives. Entraînantes par vocation. Surtout destinées à un public masculin, comme le suggère Philippe-Emmanuel de Coulanges (1633 ?-1716), cousin et ami de Marie de Rabutin-Chantal (1626-1696), marquise de Sévigné : « Quand à table l’on veut chanter/ Fumer et boire avec licence/ La Femme doit se retirer/ Et faire une humble révérence/ Pour éviter certains propos/ Enfants des pintes et des pots » (Recueil de chansons choisies, 1694).
Pour alimenter en textes et musiques ces moments de convivialité, des poètes et des musiciens composent des chansons pour boire (pour une voix accompagnée par le luth), puis des airs à boire entraînant la tablée tout entière dans divers épanchements bachiques. Aussi appréciée que « le vin clairet », cette musique est faite « pour se réjouir à la table et se provoquer à boire », écrit Antoine Furetière (1619-1688) dans son Dictionnaire Universel (1690).
Accommodés en cabinet, avec ou sans le concours de la dive bouteille, ils peuvent également être composés sur le vif, ainsi que l’indique Bertrand de Bacilly dans sa dédicace au maréchal Henri de la Ferté-Senneterre (1599-1681). Après avoir loué « l’amitié que vous avez pour la Musique et pour les beaux Airs dont vous connaissez le fin avec un discernement tout à fait singulier », il le remercie de lui permettre « de manger quelquefois à votre table. C’est là, Monseigneur, où j’ai pris la liberté de vous chanter ces Airs que vous avez écouté avec joie ; et c’est cette table qui m’a animé pour le faire, et qui m’a donné l’art d’y réussir, ni plus ni moins que ferait une maîtresse à l’égard d’un poète, ou d’un musicien amoureux » (Second livre d’airs bachiques, 1677).
Jusque dans les années 1660, les airs bachiques étaient imprimés dans des recueils spécifiques. A la fin de cette décennie, ils commencent à côtoyer les airs sérieux. Notamment à partir du Troisième livre d’Airs que Jean Sicard publie en 1668 et dans lequel il entend convaincre que son talent ne se limite pas à la composition d’airs bachiques. Cette cohabitation constitue une véritable consécration pour ces derniers. Qui pensait que les airs à boire étaient à classer dans la catégorie des arts mineurs ?
Comment un grand maître de la musique sacrée et un auteur de grandes tragédies lyriques tel que Charpentier a-t-il pu se commettre avec la chanson bachique ? Tout simplement parce que la gravité n’entrave pas la truculence. Dans sa pièce à la façon d’une cantate, l’Epitaphium Carpentarii (H 474), ne rêve-t-il pas ainsi à l’outre-tombe : « Car, après la mort, il goûtera les joies de la vie éternelle et boira le nectar du concert des anges dans la fontaine de volupté ». Si musiques et liqueurs animent les convives invités à la table des dieux, pourquoi ne pas faire de même à la table des hommes ?
Cinq pièces sont inscrites au programme. Suivons l’ordre chronologique de leur publication.
En pleine période de récolte du raisin, le numéro d’octobre du Mercure galant propose à ses lecteurs le texte et « l’air de la nouvelle Chanson… (qui) est de Mr. Charpentier » : « Consolez-vous, chers enfants de Bacchus » (H 451). Chanté a cappella, le texte réalise le bilan mitigé des vendanges de l’année 1680 : faibles quantités (« En voyant de votre vendange/ Couler si peu de jus ») mais d’excellente qualité (« sera si fin, si divin, si fort, si puissant/ si bon, si charmant, si brillant, si pétillant »). Un niveau de récolte qui résulte, nous informe Emmanuel Le Roy Ladurie, d’une « période d’étés chauds et secs » (Histoire du climat depuis l’An mil, tome 1, 1983). « Vendangé sans eau », confirme le texte de l’air. La voix assurée, la note juste et ce qu’il faut de conviction pour décliner les qualités du vin de l’année 1680, Geoffroy Buffière entretient l’espoir d’une tablée de convives craignant pour leurs futures agapes.
Un nouvel air à boire figure au sommaire du Recueil d’airs sérieux et à boire de différents auteurs pour l’année 1702. Bien moins délicat que le réconfortant message aux « enfants de Bacchus », Veux-tu, compère Grégoire (H470) joue une saynète truculente sur un mode rabelaisien. Compère Grégoire dort. D’abord a cappella, un trio (haute-contre, taille et basse) le secoue pour faire participer « ce gros cochon » aux libations. L’essentiel n’est-il pas « de rire et de boire/ De ce bon vin » ? Pour cela, rien de mieux que de « faire bruire à son oreille » la douce mélodie du vin qui s’écoule du goulot de la bouteille (glougloutage). Aussitôt, le tempo s’emballe, le texte se charge d’onomatopées et une guitare échauffe les buveurs.

Gravure extraite de la Mode par l’image du XIIème au XVIIIème siècle (1905) – Lingère coiffée d’un bavolet
Autre saynète en 1704 : Ayant bu du vin clairet (H 447). Ecrit pour deux dessus, basse et continuo, elle met en scène Colin et sa bergère. Tous deux se réveillent « sur la fougère » après une nuit arrosée. Depuis le tourdion (danse de couple rapide et légèrement sautée) de Pierre Attaignant (1494-1552), on savait que le « vin clairet » faisait tourner les têtes (Quand je bois du vin clairet). Dans l’air de Charpentier, il invite à la bagatelle. Dans un langage galamment équivoque, le texte raconte le réveil du couple. En premier, Colin, en levant le bavolet (« coiffure de paysanne des environs de Paris, qui est de toile et qui pend en queue de morue sur le dos de la paysanne » selon le Dictionnaire françois de Pierre Richelet (1626-1698)), reconnaît sa partenaire d’une nuit. Craignant sa réaction, il lui demande pardon. Accommodante, celle-ci met l’épisode sur le compte du vin. Ce duo au texte leste et au rythme léger est également une divertissante peinture de caractère. Particulièrement en opposant le rythme affligé du repentir masculin et l’allure guillerette de la mansuétude féminine.
Bien plus scabreux sont les deux derniers airs à boire. Le premier, véritable chanson de tréteaux, est paru dans les Meslanges de musique latine, française et italienne (1726). Cruel selon nos critères, il excelle dans l’art du contre-pied. En effet, Beaux petits yeux d’écarlate (H 448) semble promettre à l’auditeur le portrait d’une nymphette. Pourtant, au fil du texte, c’est une femme âgée que le trio (haute-contre, taille et basse) dévoile sans la moindre pudeur. Ce type de poésie s’inscrit dans la tradition satirique de la description anatomique et physiologique du corps féminin vieillissant. Même l’avant-gardiste Encyclopédie de Denis Diderot (1713-1784) accrédite cette vision misogyne des ravages de l’âge. Ainsi, dans son article « Vieillesse » (Tome 17, 1751), Louis de Jaucourt (1704-1780), esquisse-t-il le portrait d’une « Vieille » (= c’est le sous-titre donné à notre air) : « impitoyablement flétrie, reconnaissez-vous dans cet état cette beauté ravissante à qui tous les cœurs adressaient autrefois leurs vœux ? ». De fait, la description de l’encyclopédiste ne diffère du texte de notre air que par la délicatesse de son vocabulaire. Exploitant magistralement le registre du grotesque, le trio s’amuse à la façon du trio La, la, la, bonjour des intermèdes nouveaux du Mariage forcé (1672) de Molière-Charpentier. Mots chargés de ridicule (« chevelure de filasse ») ou expressions de dégoût chantées le nez pincé. Accélérations évoquant une débandade devant le spectacle de la déchéance ou inventaire méthodique et désobligeant des maux liés à l’âge. En somme, une satire rigolarde et crue.
Le second air a été publié en 1734 dans le Premier recueil d’airs à boire en duo et trio choisis de différents autheurs. Son style madrigalesque italianisant lui donne, a priori, une mine plus présentable. Pourtant, à lire son texte, il se range incontestablement dans la tradition des chansons paillardes de la Renaissance. Fenchon, la gentille Fenchon (H 454) use du procédé du double sens pour créer un lien de complicité avec l’auditeur. En apparence, le tableau est gentillet : la jeune Fenchon se cache dans son manchon ; ses trois galants se rêvent en bichon. Pour la traduction, ouvrons le Dictionnaire Unversel (1702) d’Antoine Furetière. Le manchon, est « une fourrure qu’on porte en hiver, propre pour y mettre ses mains, afin de les tenir chaudement… Une femme met le nez dans son manchon pour se cacher ». Le bichon est un « chien de manchon », sa petite taille permettant de l’y glisser. De fait, un troisième objet nous entraîne sur un terrain licencieux : la « queue aussi longue qu’une rave ». Sachant, toujours selon Furetière, qu’il « s’élève (de certaines raves) une tige à la hauteur d’un homme ». Bien loin de celle d’un bichon ! Aussitôt le discours s’installe dans l’équivoque. D’autant plus manifestement que le trio vocal souligne, par des mots postillonnés (« queue » »), des étirements languissants (« manchon » et « queue aussi longue ») et des répétitions insistantes (« on te prendrait »), que les galants ne songent qu’à croquer la pomme.

Portrait de Thomas Corneille, en buste – Etienne Jahandier Desroches (1668-1741), Gallica, BnF
Airs de musique de théâtre
Au printemps 1672, Molière (1622-1673) décide de cesser toute collaboration avec un Jean-Baptiste Lully (1632-1687) enivré par sa volonté de dominer la musique au théâtre depuis que le roi lui en a accordé le monopole (13 mars 1672). Le comédien est donc à la recherche d’un nouveau partenaire pour composer le peu de musique qui reste toléré sur un plateau.
Il se tourne « vers un jeune créateur qui n’avait jusque-là abordé que le répertoire religieux » (Catherine Cessac, Marc-Antoine Charpentier, Fayard, 2004). Leur collaboration débute avec le Mariage forcé « dans lequel les intermèdes de Charpentier (H 494) remplacèrent ceux que Lully avait composé en 1664 ».
Chronologiquement, notre enregistrement retient d’abord une parodie de la sérénade Notte e di v’amo e v’adoro (Nuit et jour je vous aime et vous adore) que chante Polichinelle à sa maîtresse dans le premier intermède du Malade imaginaire (10 février 1673). Sérénade mélancolique qui « porte mes plaintes amoureuses jusque dans le lit de mon inflexible », dit-il avant de chanter. En 1732, cette parodie est publiée dans le Livre quatrième des Concerts parodiques, sous le titre des Oiseaux de ces bocages (H 456). Cet « air sérieux de M. Charpentier » adopte la forme d’un rondeau. La première section, la plus développée, appelle les oiseaux à faire silence. Car un amant délaissé attend qu’ils partagent « les maux que je ressens ». Au gré des répétitions, le texte se resserre pour s’attarder sur la doléance. La seconde section est rythmée par la colère : « une inhumaine/cause ma peine ». La reprise finit par sombrer dans la désespérance tandis que la mélodie s’enfonce dans un silence de mort. Quelle beauté sombre se dégage de la voix feutrée de soprano.
Molière décède le 17 février 1673. Sa troupe s’effiloche. Colbert fusionne ce qu’il en reste avec celle qui se produisait au théâtre du Marais. La nouvelle compagnie s’installe dans le théâtre de Guénégaud. Deux remarquables savoir-faire vont désormais se conjuguer. Celui de la comédie et celui des pièces à grand spectacle appelées « pièces à machines » à la française. « Peu importait la qualité des vers ou des airs, (leur) principal attrait résidait dans les décors somptueux et les merveilleux effets des machines », explique Catherine Cessac. Deux poètes (Thomas Corneille et Jean Donneau de Visé) et un compositeur (Charpentier) vont réunir leurs talents pour proposer des spectacles rentables tout en s’efforçant de ne pas perdre les faveurs du roi.
Le 17 mars 1675, Circé (H 496) fait un triomphe. Une « tragédie, ornée de machines, de changements de théâtre, et de musique », annonce le titre du livret consacré à ce « Spectacle le plus pompeux qui ait paru jusqu’ici sur nos Théâtres » (livret, 1675). Devant le succès remporté par la pièce, la maison Ballard finit par céder à la demande pressante du public. Sans attendre la prochaine édition annuelle du Recueil d’Airs sérieux de différens Autheurs, le libraire publie en 1676 « les Airs de la comédie de Circé que l’on m’a tant de fois demandez et que l’on a attendus avec tant d’impatience » (avis Au Lecteur). Son titre : Airs de la comédie de Circé avec la basse continue (H 496). Dans le sommaire figure le duo (soprano et taille) : Il n’est point de plaisir véritable. Un air chanté à la scène XI de l’Acte V lorsque Scylla, jadis transformée en rocher, émerge des flots pour prendre place auprès de la nymphe Galatée. Danses accompagnées de chansons célèbrent cette délivrance. Parmi celles-ci, le duo d’un Sylvain et d’une Dryade exalte le triomphe inéluctable de l’amour. Dans un plaisant mouvement d’oscillation, distique après distique (strophe composée de deux vers), les deux esprits sylvestres prônent d’abord l’amour partagé, seul à pouvoir procurer un « plaisir véritable ». Dans un second temps, ils constatent l’inutilité de lui résister : « A l’amour il faut rendre les armes/ Tôt ou tard il triomphe de nous ». Un rythme proche d’un branle de village (danse en deux temps) anime cette conversation fort avenante.
La même année, le 17 novembre 1675 exactement, une nouvelle pièce tente de séduire le public : L’Inconnu (musique perdue). Circé « avait fait paraître… une partie de ce que le théâtre a de plus pompeux pour la beauté des machines », explique Thomas Corneille à son lecteur. Avec L’Inconnu, il entend le divertir « par les agréments qu’une matière galante est capable de recevoir ». Il y a glissé une « quantité de choses agréables qui forment les divertissements que l’Inconnu donne à sa maîtresse ». De la version originelle de la pièce, un premier air avait été prélevé : Il faut aimer, c’est un mal nécessaire (H 454bis). A l’ouverture de la scène VI de l’Acte III, une troupe de Bohémiens entend égayer la maîtresse de l’Inconnu. Dans la troupe, une petite bohémienne propose de danser la sarabande sur l’air Il faut aimer. Un air microscopique, rythmé par le pincement des cordes de la guitare et du théorbe. Un air simple, qui concède la primauté au texte chanté. Un texte d’inspiration ronsardienne sur la fuite du temps : « Pour la tendresse/ Il n’est qu’un temps/ Et les beaux ans/ S’en vont sans cesse ». Mais que de mélancolie pour clore le programme de l’enregistrement !
Vers 1679, deux airs à boire prolongeront le dénouement de L’Inconnu. Sans doute au moment où tous les acteurs ayant contribué à l’intrigue sont présents sur la scène, l’un d’entre eux entonne a cappella Si Claudine ma voisine (499bis). Avec de faux airs de naïf présomptueux, Geoffray Buffière prévient : que Claudine se méfie des apparences car, en cachette, je serai capable de lui conter fleurette. Cet air paraîtra en 1703 dans le Recueil d’airs sérieux et à boire de différents auteurs. Au même moment, le Vicomte se fait éconduire par une paysanne coiffée d’un bavolet. « Voicy le Bavolet de Mr Charpentier, que vous avez tant d’envie de voir noté et que la troupe de Guénégaud a ajouté l’année dernière à la galante pièce de L’Inconnu. Comme on en doit donner quelque représentation incontinent après la Toussaint, ceux de votre Province qui s’y trouveront pourront vous dire combien cette chanson est aimée » (Mercure galant, octobre 1680). Ne fripez pas mon bavolet (H 499bis) est chanté sur un ton d’opérette parfaitement accordé à l’esprit de cette saynète populaire. Une jeune paysanne défend son bavolet en promettant de malmener quiconque osera y toucher. Car « c’est aujourd’hui dimanche ». Pour lundi, « je ne suis pas si difficile », précise-t-elle sur un ton de confidence. Amusante chanson burlesque et sémillante, interprétée avec beaucoup d’authenticité et un grand sens de l’humour.
Sur un registre bien plus sérieux, voici les Stances du Cid. Les trois opus regroupés sous ce titre générique diffèrent des autres airs sur un point essentiel : ce n’est pas la musique qui va au théâtre mais le théâtre qui fait cadeau de sa matière littéraire à la musique. Durant le premier trimestre de l’année 1681, le Mercure galant publie trois airs composés sur trois des six stances (« sorte d’ouvrage de poésie composé de plusieurs couplets » dit le Dictionnaire de l’Académie françoise, 1694) du monologue de Rodrigue à l’Acte I, scène VII du Cid de Pierre Corneille (1606-1684). Plus de quarante ans séparent la tragi-comédie des airs de Charpentier. Sur scène, déjà, ces stances faisaient figure de curiosité car leur structure répond davantage aux règles de la poésie qu’à celles du langage théâtral versifié. En revanche, leur rythme et leur dynamique plus proches d’une chanson constituent une aubaine pour un musicien. Dans l’article qu’elle consacre aux Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier, Sarah Nancy note que « les stances du Cid se présentent comme un ensemble de six dizains remarquables à la fois par leur hétérométrie (avec une alternance de quatre mètres différents), et par l’effet de refrain formé par les deux derniers vers… les stances apparaissent donc comme un objet en quelque sorte prêt à chanter, et c’est ce à quoi Charpentier semble avoir été sensible. » (Publications numériques du CEREdl, n°26, 2020).
Dans son numéro de janvier 1681, le Mercure publie la première stance notée : « Je vous envoie une chose fort ancienne, et pourtant toute nouvelle. Elle est ancienne par les Vers et nouvelle pour l’Air. Mr. Charpentier dont vous connaissez les capacités et le mérite, travaille sur les Stances du Cid dont chaque mois il donnera un couplet. Voici le premier noté ». Un premier quatrain frémit d’indignation. L’art éprouvé de Cyril Auvity nous a Percés jusques au fond du cœur (H 457). Dans cette forme de récitatif, la tension dramatique est à vif et le sentiment d’injustice criant. La suite se décompose en trois distiques. Le premier, efficacement expressif, matérialise l’immobilité d’une « force abattue », prête à céder. Dans le second, le chanteur se tourne vers Dieu pour lui adresser une douloureuse supplication. Celle d’un amant qui, si près de son but, voit son destin réduit en lambeaux. Le distique final adopte le ton de la dénonciation : l’offenseur est le père de Chimène.
En février, la partition notée de la seconde Stance est égarée au milieu d’un épigramme galant composé par Mr le Président de la Tournelle de Lyon. Si l’air de Charpentier a bien été annoncé, c’est surtout à propos de la participation du compositeur à l’animation musicale du carnaval à Saint-Germain : « la Musique y fut charmante. Vous savez que c’est en quoi les Italiens excellent. Mr Charpentier qui a demeuré trois ans à Rome, en a tiré de grands avantages. Tous ses ouvrages en sont une preuve. Je vous envoie la suite de ce qu’il a commencé ». Dans cette stance balancée à la manière d’une chaconne, une même énergie sombre enveloppe les dix vers de cette délibération intérieure. Expression emblématique du dilemme cornélien. Que je sens de rudes combats (H 459) met en scène la lutte sans merci entre l’honneur et l’amour. Rendant le choix humainement impossible entre « venger un père ou perdre une maîtresse ». Par sa voix et ses intonations, Cyril Auvity traduit admirablement l’oppressant chaos intérieur qui ébranle Rodrigue. Une détermination teintée de désespoir s’en dégage, s’apitoyant sur des souvenirs heureux (répétition de « mon amour »), criant son désarroi (« Ô dieux, l’étrange peine »), chargeant le reste du poids de sa détresse morale (« L’un m’anime le cœur, l’autre retient mon bras »).
En mars, la Stance promise ne figure pas au sommaire du Mercure. Il faut feuilleter le périodique pour découvrir le troisième couplet mis en vers : « Voici encore une suite de ce que Mr Charpentier a commencé ». Propos laconique qui, en quelque sorte, présage une fin prématurée de la série. Charpentier a-t-il mis en musique les trois dernières Stances ? Si tel était le cas, le Mercure aura décidé de déprogrammer leur publication. Laissant ainsi la délibération en suspens alors que, dans la sixième Stance, Rodrigue décide de courir « à la vengeance ». Selon toute vraisemblance, Charpentier pourrait, de lui-même, avoir mis un terme à son projet. Si l’on en juge par le contenu du volume 11 de ses Mélanges autographes (1681-1683), il consacrait l’essentiel de son temps et de son énergie à la composition de pièces sacrées pour le Dauphin et à quelques commandes royales (tels Les plaisirs de Versailles, H 480). Pathétique, la troisième Stance tremble de douleur. Dissonances et silences disloquent une ligne mélodique dolente tandis que des glissandos chargés d’émotion la déstabilisent. Père, maîtresse, honneur, amour (H 458) : deux manières de formuler le terrible dilemme. Un chant poignant. Un théâtre intime submergé par les passions. Lorsque l’honneur réveille le tempo, aussitôt l’amour l’éteint. Le temps est suspendu pendant ce lamento que Cyril Auvity charge de sensations sonores qui font taire la raison.
Une raison engourdie par l’audition de vingt-neuf éclats de musique. Mais une raison qui s’éveille pour s’enthousiasmer pour ces airs méconnus. Des airs agréables à écouter et que les interprètes donnent même envie de chanter.
Certes, une écoute en continu peut susciter un effet de saturation. Mais, si l’ensemble fait figure de document sonore (témoignage d’une facette de l’œuvre de Charpentier), c’est l’unité qui en fait la beauté. Ces airs doivent donc être dégustés grain après grain.
Chacun d’eux parle de ceux qui l’ont composé (poète et musicien) et du goût de leurs destinataires. Il faut donc s’y attarder. Et suivre les conseils des contemporains. D’abord s’imprégner du texte. Puis se laisser porter par la mélodie. Enfin, s’insinuer dans les lieux et les esprits de ceux qui les écoutés pour la première fois. Et pour nous guider, éclairer leur exploration à la lumière de la notice de Catherine Cessac. Et, nous l’espérons, un peu à celle de notre humble contribution.
Sérieux et fantaisie. Sensibilité et sensualité. Larmes et rires. Le talent des chanteurs, l’art des instrumentistes, le goût de la perfection qui anime Vincent Fuget transforment cette effervescence de sensations en un panier aux couleurs vives. Alors croquons, dévorons et savourons chacun des fruits de son génie qu’y a déposé Marc-Antoine Charpentier.
Publié le 22 nov. 2023 par Michel Boesch
 © Gerard von Honthorst : La Marieuse - 1625
© Gerard von Honthorst : La Marieuse - 1625